NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
Avec son résumé succinct, The Mastermind, qui est venu clore la compétition du 78e Festival de Cannes vendredi, avait l’heur d’intriguer. On y promettait, en termes juste assez vagues pour piquer la curiosité, le récit d’un homme qui prépare un vol d’œuvres d’art. Or, sachant qu’il s’agit d’un film de la scénariste-réalisatrice-monteuse Kelly Reichardt, il était certain qu’il ne s’agirait pas d’un thriller d’action ou à gadgets, mais de quelque chose de plus singulier. Joie : c’est le cas. La cinéaste fait montre de brio autant dans sa manière de conter le destin pathétique d’un petit escroc au début des années 1970, que dans sa capacité à convoquer l’esthétique et l’esprit du cinéma de cette époque-là.
Le protagoniste, c’est-à-dire le « cerveau » du titre à prendre avec ironie, se prénomme James, et il est incarné par le très doué Josh O’Connor (Challengers ; The History of Sound). La trentaine, James vit dans un coin tranquille du Massachusetts auprès de sa conjointe, Terri, et leurs deux jeunes garçons. Elle travaille, lui pas.
On rencontre James au musée local où il compte voler des tableaux. La réalisatrice de Certain Women, First Cow et Showing Up, aurait-elle imaginé une version banlieusarde, en beige et brun, du classique The Thomas Crown Affair (L’affaire Thomas Crown), voire de son remake ? Pas du tout.
Un des partis pris les plus brillants de Reichardt consiste à avoir fait dudit braquage un simple préambule. En effet, ce n’est qu’ensuite, que le film commence réellement et se révèle pour ce qu’il est vraiment. À savoir, un road-movie, une errance, que n’auraient pas renié Jerry Schatzberg (Scarecrow / L’épouvantail ; 1973) ou Hal Ashby (The Last Detail / La dernière corvée ; 1973), deux cinéastes phares de la décennie revisitée par Reichardt.
Josh O’Connor formidable
À ce propos, la reconstitution d’époque minimaliste, jamais tape-à-l’œil, est parfaite, de l’architecture des lieux filmés, aux coloris terreux privilégiés. Complice de longue date de la cinéaste, le directeur photo Christopher Blauvelt dit s’être inspiré de la palette du film de Wim Wenders The American Friend (L’ami américain ; 1977), autre aventure criminelle patiente et à teneur inusitée touchant au monde de l’art.
Il en résulte une facture automnale puis hivernale un peu fanée, qui transit autant qu’elle séduit.
Même si le ton est doux-amer et pince-sans-rire, c’est parfois franchement drôle. Au gré des pérégrinations imprévisibles de James, on rit, on se désole…
Car tout autour, on manifeste contre la guerre du Vietnam, la lutte féministe est en marche également… Et il y a James, qui ne pense qu’à ses petites combines et à sa petite personne. Une fable sur l’individualisme galopant actuel ? Assurément.
James a beau jouer de malchance à chacune de ses décisions malavisées, il est le contraire d’un « perdant magnifique ». Pour autant, un Josh O’Connor formidable en fait un antihéros mémorable.
François Lévesque est à Cannes à l’invitation du festival et grâce au soutien de Téléfilm Canada.


 1 month_ago
4
1 month_ago
4













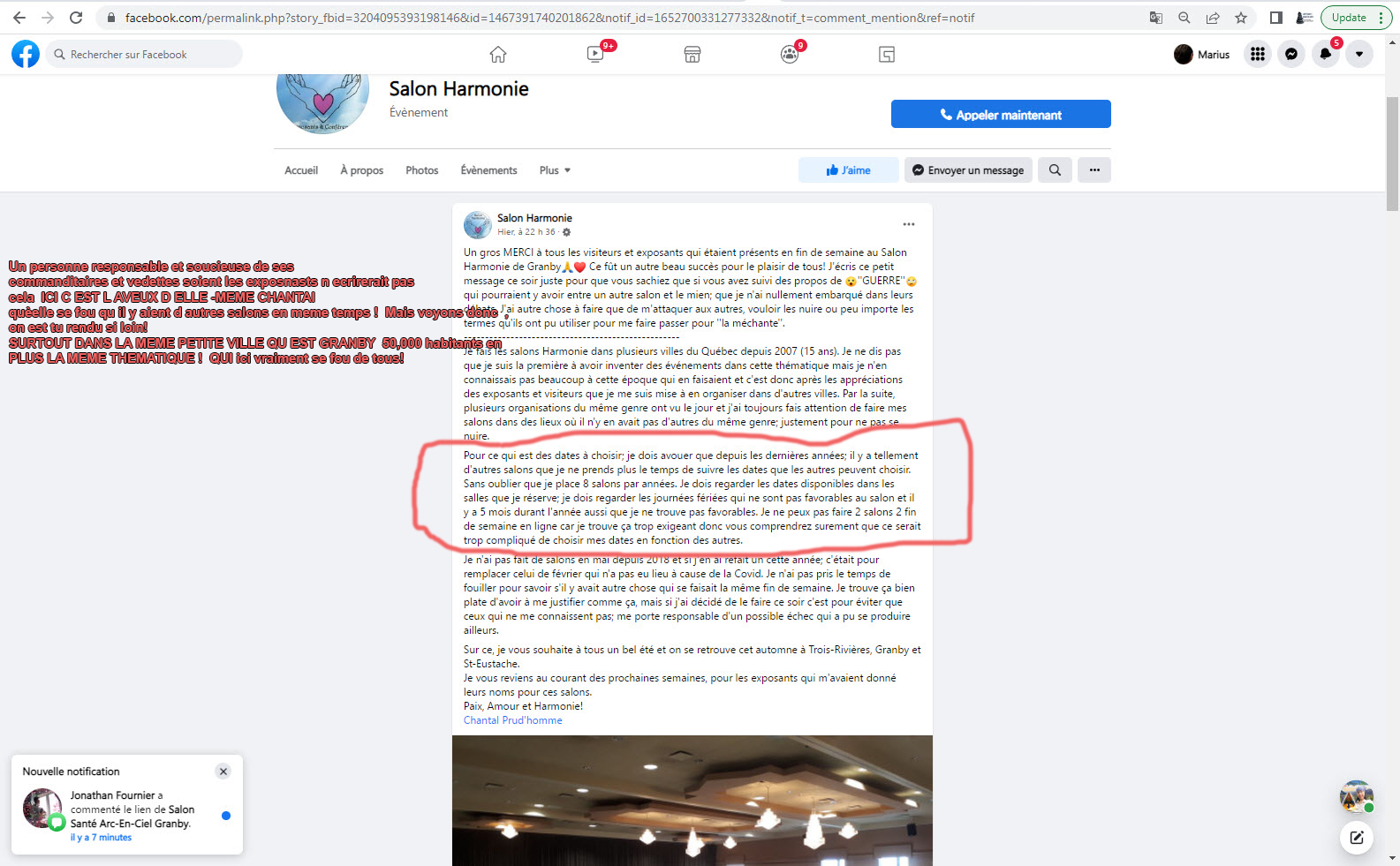

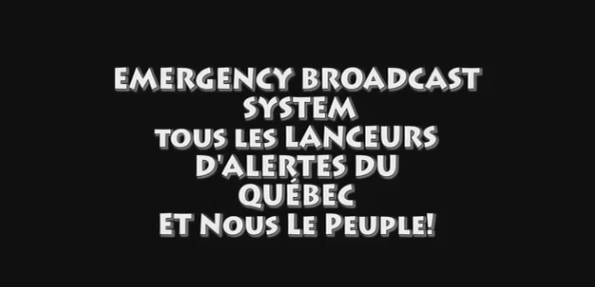
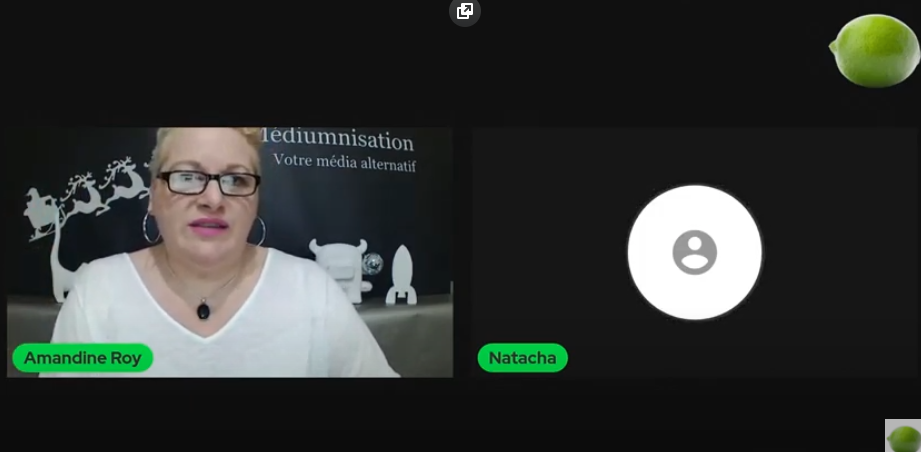





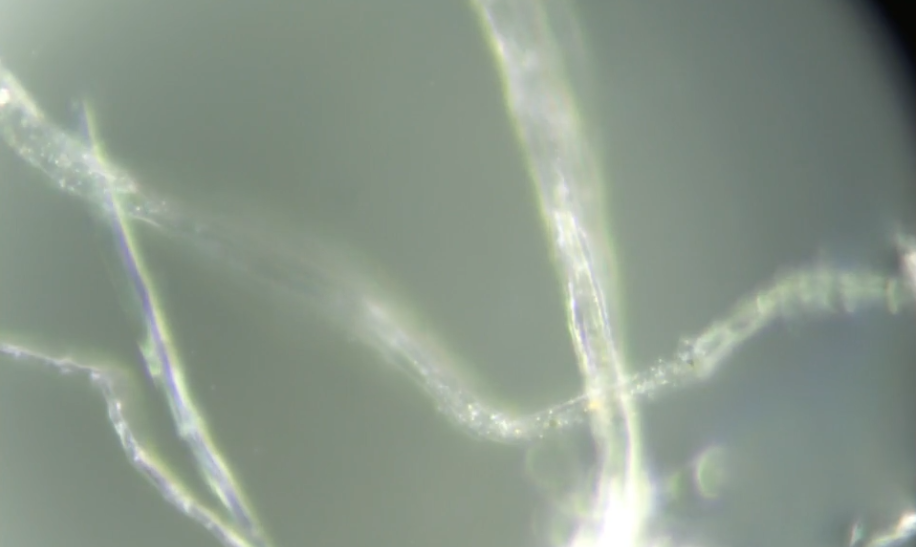


 French (CA)
French (CA)