NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
1er juillet 1867, 10 h du matin. Un nouveau pays naît officiellement sur le continent nord-américain : le Dominion du Canada. À Ottawa, une salve de canons tonne en l’honneur de la Reine. Les cloches des églises sonnent. Dans les rues de Montréal, de Québec ou de Halifax, quelques officiels arborent des cocardes, mais la population demeure en grande partie indifférente, ou du moins incertaine de ce que cette Confédération signifie. Car derrière l’acte solennel se cachent des décennies de tensions, de luttes, d’humiliations, et de marchandages. Pour les Canadiens français, ce 1er juillet ne sera jamais un anniversaire naïf. C’est un fait politique, né d’un compromis impérial, d’un calcul stratégique… et d’un passé douloureux qu’il faut comprendre.
Avant de s’arrêter sur cette journée fondatrice, il faut d’abord remonter aux régimes qui l’ont rendue possible — ou nécessaire. Car la Confédération ne naît pas dans un vide, mais dans une succession de chocs.
Les régimes coloniaux précédents (1760–1848)
L’histoire du Canada commence dans la défaite. Après la Conquête de 1759-1760, la Nouvelle-France devient colonie britannique. Dès lors, les Canadiens — on dira plus tard les Canadiens français — passent du statut de peuple fondateur à celui de population conquise. Les lois anglaises s’imposent, l’administration coloniale est hostile, et les catholiques se voient immédiatement exclus des fonctions publiques par le serment du Test, qui les force à renier l’autorité du pape. On exige d’eux qu’ils abandonnent leur foi pour participer à la vie publique. Cette exigence, maintenue jusqu’en 1774, cristallise l’humiliation d’un peuple obligé de choisir entre sa conscience et ses droits.
L’Acte de Québec, imposé cette année-là pour s’assurer de la loyauté des Canadiens face aux colonies américaines en rébellion, restaure temporairement une certaine autonomie religieuse et juridique : le droit civil français est maintenu, la dîme est protégée, et les catholiques sont de nouveau admissibles à des fonctions officielles. Ce compromis, purement stratégique pour Londres, jette pourtant les bases d’une dualité culturelle et juridique qui perdure jusqu’à aujourd’hui. Mais cette tolérance n’empêche pas l’imposition du joug britannique. En 1791, l’Acte constitutionnel divise le territoire en Haut-Canada (anglophone) et Bas-Canada (francophone), chacun doté d’une assemblée élue. Cette division entérine le clivage linguistique et ouvre la voie à une série de conflits politiques.
Au Bas-Canada, les députés francophones, bien que majoritaires à l’Assemblée, se heurtent continuellement au Conseil législatif nommé par Londres. Les projets de réforme sont bloqués, les taxes imposées sans consultation, et les inégalités se creusent. Le ressentiment grandit, jusqu’à éclater en révolte. En 1837-1838, les Patriotes prennent les armes. Ils réclament un gouvernement responsable, la fin de l’arbitraire, et la reconnaissance de leur nation. La répression est brutale. Les troupes britanniques incendient les villages, fusillent les insurgés, et condamnent à mort ou à l’exil les meneurs. François-Marie-Thomas Chevalier de Lorimier, juste avant d’être pendu, écrit : « Je meurs sans remords ; le seul crime de votre père a été son échec. »
En 1839, le rapport Durham, commandé pour comprendre les causes des rébellions, propose une solution radicale : assimiler les Canadiens français. Il les décrit comme « un peuple sans histoire et sans littérature », incapable de progresser sans l’aide des Britanniques. Il recommande l’union du Haut et du Bas-Canada pour les noyer dans une majorité anglophone. Ce sera chose faite en 1840, avec l’Acte d’Union. Une seule Assemblée est créée, où les deux régions, malgré leur population inégale, ont un nombre égal de députés. Le Bas-Canada perd sa majorité, son nom, et son pouvoir. Pire encore, les dettes sont fusionnées — alors que celles du Haut-Canada sont bien plus lourdes. Pour beaucoup, c’est un pillage organisé, une tentative d’effacement identitaire.
Malgré tout, une lueur démocratique finit par percer. En 1848, le gouvernement responsable est finalement accordé : le pouvoir exécutif doit désormais avoir la confiance de la majorité élue. C’est une victoire importante. Mais l’instabilité demeure. Les clivages linguistiques, religieux et régionaux continuent de miner la gouvernance. Le Canada-Uni devient ingouvernable. À chaque élection, les coalitions se font et se défont. Il devient évident que l’Union de 1840 n’a pas réglé les tensions : elle les a figées dans un carcan.
Vers la Confédération : conférences et alliances (1864–1867)
C’est dans ce contexte d’impasse politique qu’émerge, dans les années 1860, le projet d’une Confédération. L’idée ne naît pas d’un grand élan populaire, mais d’un pragmatisme froid. Il faut réformer les institutions, mais aussi répondre à une série de pressions extérieures : la guerre de Sécession a transformé les États-Unis en puissance militaire redoutable, et certains politiciens américains parlent d’annexer tout le Nord. Le traité de réciprocité commerciale avec les États-Unis a expiré, menaçant l’économie des colonies. Et le projet d’un chemin de fer transcontinental ne peut se réaliser sans un cadre politique plus large.
En 1864, une coalition improbable naît entre les ennemis politiques de toujours. John A. Macdonald, George Brown et George-Étienne Cartier forment ce qu’on appelle la Grande Coalition. Ensemble, ils proposent une réforme majeure : créer un système fédéral, dans lequel les provinces auraient leurs compétences, tout en étant unies par un gouvernement central. Ce modèle permettrait à la fois d’assurer une représentation proportionnelle (réclamée par l’Ontario) et de garantir l’autonomie provinciale (réclamée par le Québec). Ce double jeu sera au cœur des débats.
La première conférence a lieu à Charlottetown en septembre 1864. Elle devait porter sur une union des provinces maritimes, mais la délégation du Canada y prend le contrôle, convainquant les participants de viser plus grand. Suivra la conférence de Québec, en octobre. On y adopte les fameuses 72 Résolutions, qui fixent les grandes lignes de la future Constitution : bicaméralisme, séparation des pouvoirs, autonomie provinciale, représentation par la population à la Chambre des communes. À Londres, en 1866, une dernière conférence finalise le tout. Le 1er juillet 1867, la Confédération est proclamée. Le Canada est né.
Mais il faut bien le dire : cette naissance s’est faite sans véritable consultation populaire. Au Québec, les oppositions sont nombreuses. Antoine-Aimé Dorion, chef des Rouges, s’y oppose farouchement, dénonçant une union précipitée et déséquilibrée. Plusieurs journaux, comme Le Canadien, dénoncent un pacte dont les conséquences sont floues. Le projet est adopté par l’Assemblée sans référendum, ni campagne publique d’envergure. La Confédération est un fait accompli, non une œuvre collective.
Le Canada en 1867 : portrait d’une nouvelle nation
Le Canada de 1867 est un pays partiel. Il comprend seulement l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Le reste viendra plus tard, dans une logique d’expansion territoriale qui répond autant à des ambitions politiques qu’à une volonté de contrer l’influence américaine. En 1870, le Manitoba est créé à la suite de la révolte des Métis dirigée par Louis Riel, dont les revendications seront trahies presque immédiatement. En 1871, la Colombie-Britannique accepte d’entrer dans la fédération, à condition qu’un chemin de fer la relie rapidement à l’Est. Ce sera le Canadian Pacific, terminé en 1885, au prix d’efforts colossaux et de conditions inhumaines imposées aux travailleurs chinois.
Dans les décennies suivantes, l’Île-du-Prince-Édouard, les territoires du Nord-Ouest, la Saskatchewan et l’Alberta s’ajouteront au puzzle. Terre-Neuve ne joindra le Canada qu’en 1949, à la suite d’un vote extrêmement serré. À chaque fois, l’intégration se fait au nom de l’unité, mais les tensions locales, linguistiques ou culturelles ne sont jamais bien loin. Le Canada grandit, mais les blessures fondatrices restent.
L’équilibre entre Ottawa et les provinces devient un champ de bataille permanent. Le Québec, en particulier, lutte pour protéger ses compétences en éducation, en langue et en culture. Chaque tentative de centralisation — réelle ou perçue — est vécue comme une menace. De là naîtra, plus tard, le mouvement souverainiste, qui trouvera ses racines non pas dans une rupture brutale, mais dans cette accumulation de frustrations depuis la Conquête.
Un regard lucide sur notre histoire
Alors que l’on souligne aujourd’hui le 1er juillet, il importe de suspendre le réflexe partisan. Comprendre la Confédération ne signifie pas la célébrer. Cela signifie d’abord en reconnaître les racines : une suite de décisions politiques prises dans un contexte de tension, d’isolement, de peur. Une réponse imparfaite à des problèmes réels. Ce projet a permis de stabiliser le gouvernement, d’assurer une certaine autonomie provinciale, et d’éviter l’annexion américaine. Mais il s’est aussi bâti sur des injustices : l’effacement temporaire du Bas-Canada, la fusion des dettes, l’exclusion des francophones des débats, la violence coloniale contre les Autochtones et les Métis.
On peut, à juste titre, éprouver de l’ambivalence. Mais cette ambivalence n’interdit pas la connaissance. Elle la commande. Il ne s’agit pas de « fêter le Canada » en fermant les yeux, ni de le rejeter en bloc : il s’agit de savoir d’où l’on vient, et comment les structures qui nous entourent aujourd’hui ont été créées.
Le 1er juillet 1867 n’est pas un miracle. C’est un compromis. Et comme tous les compromis, il mérite d’être compris avant d’être jugé.


 1 week_ago
4
1 week_ago
4













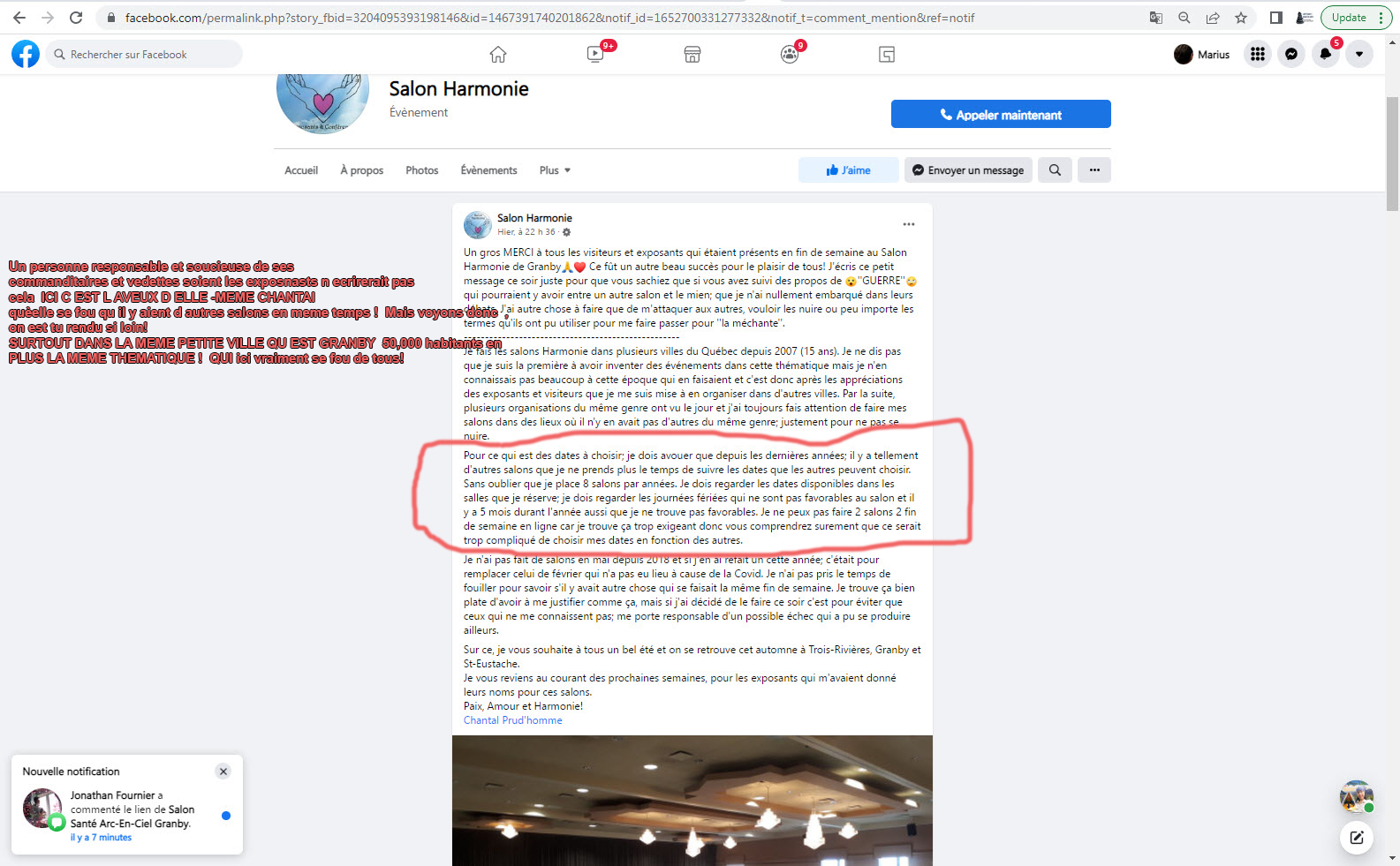

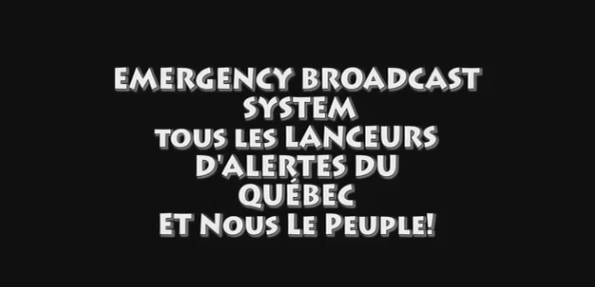
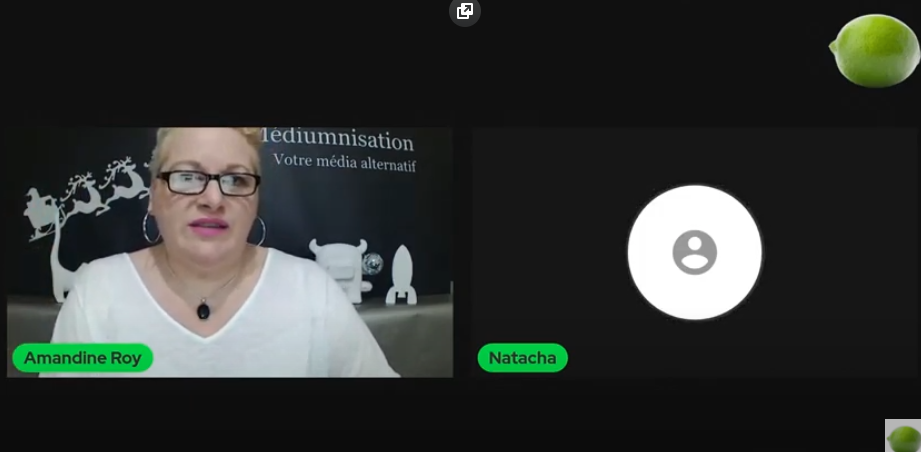





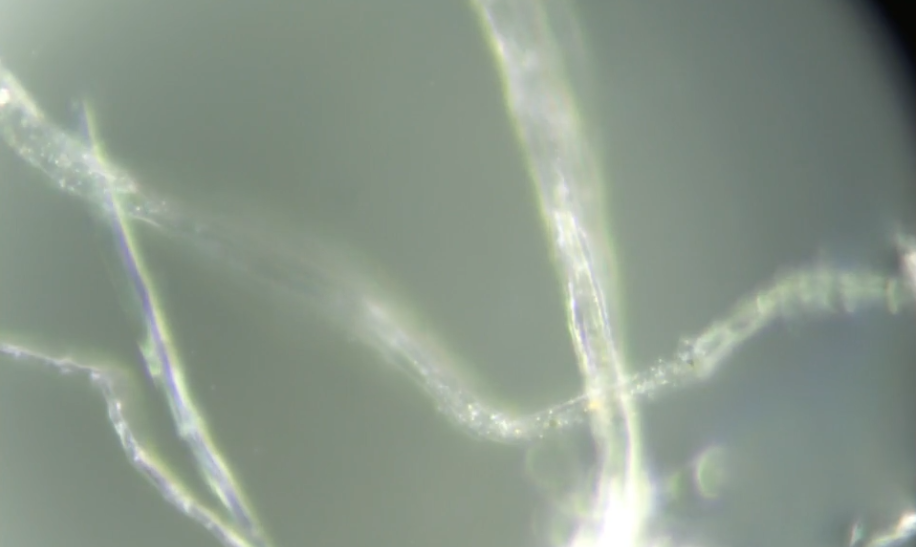


 French (CA)
French (CA)