NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
Cofondateurs du Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités, Laurent Frémont, enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po Paris, et Emmanuel Hirsch, professeur en éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay, se questionnent sur l'éthique médicale ainsi que la définition de la mort dans notre société à la suite de la proposition de loi concernant l'accompagnement et l'aide à la fin de vie.
À travers le projet de loi sur l’aide à mourir, ce sont les principes fondamentaux de la pratique médicale et de l’éthique du soin qui se trouvent redéfinis. Il ne s’agit plus seulement d’ajuster notre droit aux réalités de la fin de vie, mais de reconfigurer profondément les finalités du soin. Ce changement s’opère au nom de la liberté individuelle, mais il engage bien au-delà de la seule autonomie personnelle : il modifie les responsabilités du médecin, redéfinit le cadre du soin, et interpelle notre conception même de l’éthique médicale.
À LIRE AUSSI : Aide à mourir : "L'argument économique instrumentalise une souffrance réelle à des fins idéologiques"
Depuis les lois de 2005 et 2016, notre pays s’est doté d’un cadre respectueux de la personne malade, visant à éviter l’obstination déraisonnable et à permettre un accompagnement digne jusqu’à la mort. Ces textes ont reposé sur un équilibre subtil : reconnaître la volonté du patient tout en réaffirmant la vocation protectrice du médecin. La sédation profonde et continue, dans certaines conditions, témoignait de cette volonté de répondre à la souffrance sans rompre le lien fondamental du soin.
La proposition actuelle introduit une inflexion majeure. Elle institue, dans certaines circonstances, un droit à demander une assistance médicalisée à mourir. Cela implique que la médecine ne se limite plus à soulager ou accompagner, mais puisse répondre à une demande de mort par un acte intentionnel, reconnu et encadré. Il ne s’agit plus ici d’une évolution de la pratique, mais d’une rupture de ses fondements.
Protéger ou interrompre ?
Cette mutation soulève plusieurs questions éthiques majeures. D’abord, celle de la finalité du soin. Depuis Hippocrate, la médecine s’est construite autour du refus de nuire et de la préservation de la vie, même lorsque celle-ci arrive à son terme. Si la loi consacre la possibilité pour un médecin de provoquer la mort dans certaines conditions, il devient nécessaire de redéfinir ce que l’on attend du soignant : accompagner, protéger ou intervenir pour interrompre la vie à la demande ?
Ensuite, la question des repères : peut-on assimiler une mort provoquée à une mort naturelle, comme le prévoit le texte ? Cela engage une redéfinition des catégories mêmes qui structurent notre rapport juridique, social et médical à la mort. Une telle décision appelle une réflexion sur les mots que nous utilisons, leur portée symbolique et leur effet sur la manière dont la société envisage les derniers instants de l’existence.
À LIRE AUSSI : "Faire des économies" : la crainte d'une dérive de l'aide à mourir
Autre ligne de rupture : la temporalité et les conditions de la décision. Le projet prévoit un délai de quinze jours maximums pour instruire une demande orale, sans validation systématique par une instance tierce, ni recours obligatoire à un avis psychiatrique. Or, décider de mettre fin à sa vie est un acte irréversible, qui suppose un discernement éclairé, une stabilité psychique, et des conditions de réflexion favorisant la liberté réelle du choix. Comment garantir que la demande s’inscrit dans une temporalité respectueuse de la complexité humaine, et non dans l’urgence ou l’isolement ?
Repenser l'éthique médicale
Ces transformations interrogent enfin le contrat de confiance entre la société et les soignants. La médecine s’exerce au sein de vulnérabilités extrêmes : douleur, peur, perte d’autonomie. C’est justement dans ces situations que l’éthique médicale offre un cadre protecteur. L’introduction d’un droit à la mort dans la pratique clinique implique de repenser ce cadre. La clause de conscience, bien qu’inscrite dans la loi, ne suffit pas à dissiper les tensions éthiques auxquelles seront confrontés les professionnels.
Loin de rejeter en bloc le principe de l’aide à mourir, il s’agit ici de poser des questions fondamentales : quel est le rôle du soin ? Comment préserver l’autonomie sans fragiliser les personnes les plus vulnérables ? Et surtout, comment éviter que la mort ne devienne une réponse sociale à l’épreuve de la maladie ou de la solitude, là où la solidarité, la présence et l’accompagnement auraient encore un sens ?
À LIRE AUSSI : Vers une sélection darwinienne ? La fin de vie ou la crainte d'une dérive gestionnaire
L’éthique médicale n’est pas une position figée, mais un dialogue permanent entre principes, situations concrètes et responsabilité collective. Ce que révèle le débat actuel, c’est moins une opposition de valeurs qu’un besoin urgent de repenser, sans précipitation, les équilibres qui ont permis à notre démocratie de construire une médecine attentive à l’humain, jusque dans les derniers instants de la vie. Ce que révèle cette loi, ce n’est pas un progrès éthique, mais une capitulation : une société lasse d’assumer la complexité de l’humain face à la mort délègue au droit un pouvoir qu’elle n’a pas su exercer par le soin, la solidarité et l’écoute. Au nom de l’autonomie, on risque d’isoler davantage celles et ceux qui auraient besoin d’être entourés.
Un oubli de la dignité humaine
Le soin ne se résume pas à répondre à une demande. Il engage, il questionne, il résiste parfois – dans le respect de la personne, précisément. C’est à cette hauteur-là que se joue l’éthique médicale. L’oublier serait, à terme, perdre ce qui fait du soin autre chose qu’un service, de la médecine autre chose qu’un métier.
À LIRE AUSSI : Emmanuel Hirsch : "Je respecterai la loi sur l'aide à mourir… même si elle nous fera sacrifier une part de fraternité"
Dans un monde qui valorise la maîtrise, y compris celle de la mort, il est temps de rappeler que la dignité humaine ne se mesure pas à la capacité de décider seul, mais à la qualité du lien qui nous relie, jusqu’au dernier instant.


 1 month_ago
5
1 month_ago
5













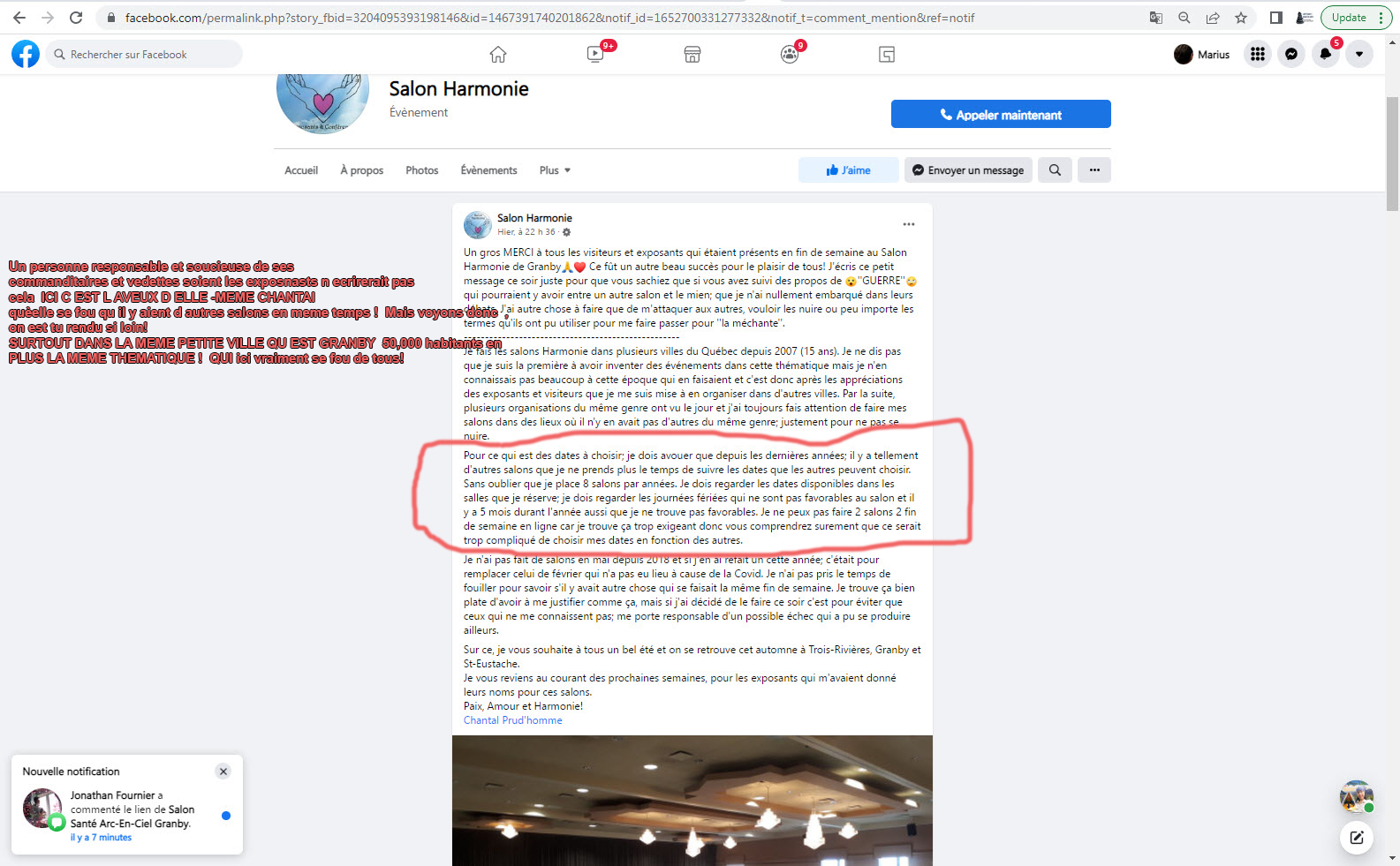

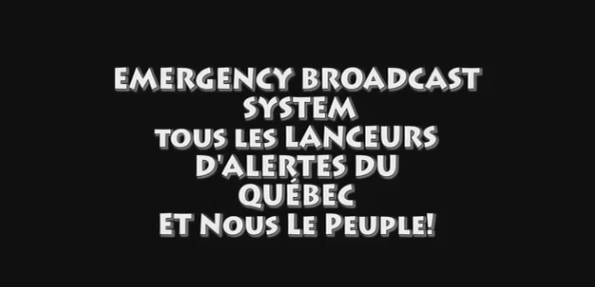
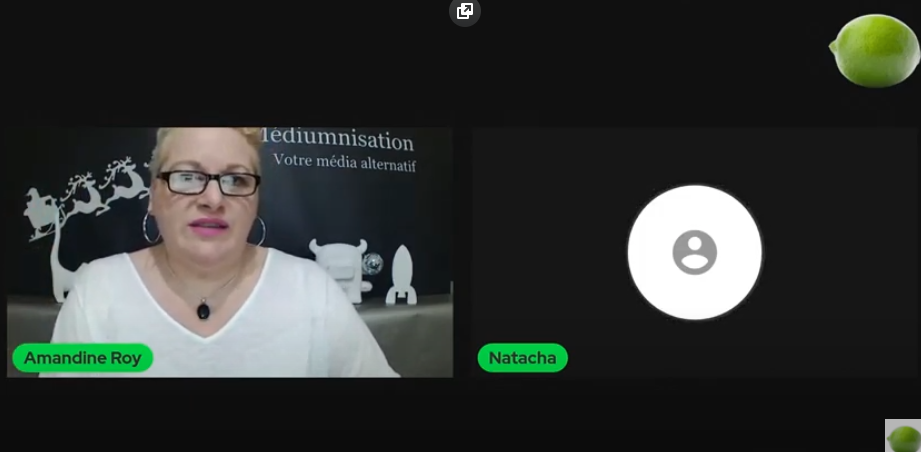





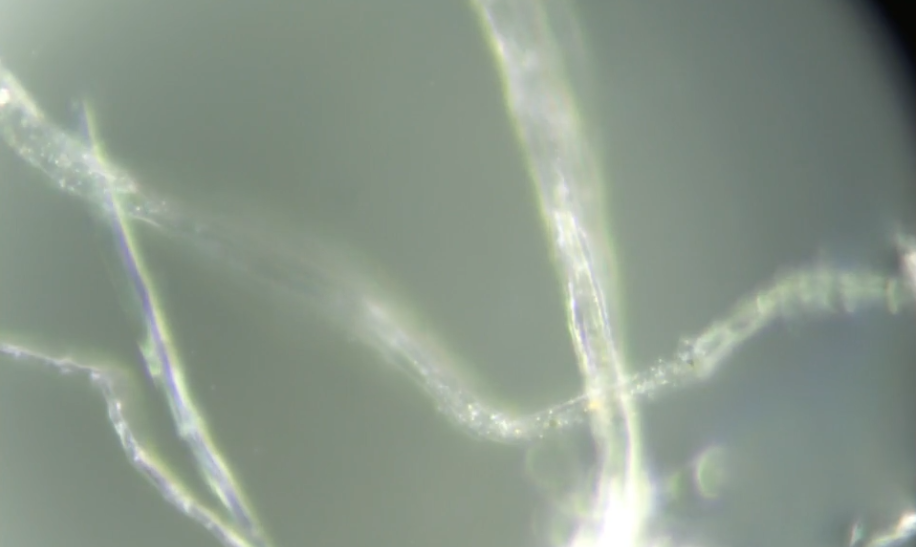


 French (CA)
French (CA)