NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
En avril dernier, j’écrivais mon amour du jardinage dans les pages de ce journal. Chaque printemps, je ressens une immense joie à voir le lilas fleurir et le framboisier effronté repartir à la conquête de mon petit lopin de terre urbain. J’enfile alors mes vêtements les plus élimés, je ressors une affreuse casquette et je plonge mes mains dans la terre.
Cette année encore, dès qu’il a fait beau, j’ai accompli mon rituel. Retourner la terre, ajouter du compost et des fertilisants naturels, arracher les mauvaises herbes, semer les légumes en feuille, diviser les vivaces pour les repiquer ailleurs, ce sont autant de gestes qui me font du bien à l’esprit en me sortant de mon hibernation mentale.
Le bruit des vélos auxquels on a ajouté de petites roues et les encouragements de parents à leurs apprentis cyclistes recommencent à emplir la ruelle restée silencieuse durant l’hiver. Le chant du cardinal et les cris des bernaches s’ajoutent à cette mélodie printanière. Cette scène, je la décrivais quasi à l’identique, il y a environ un an, dans une chronique dédiée à la fabuleuse Caroline Dawson, qui nous a quittés le 19 mai 2024. Je prévoyais que cette période de l’année serait pour ceux qui l’aimaient un lancinant rappel de son départ. C’est précisément en observant la lumière du soleil sur les clochettes du muguet que j’ai repensé à elle.
En ce mois de mai 2025, il n’y a pas que le souvenir du décès de Caroline qui me fracasse le cœur. L’état du monde qui m’entoure me désole. « Selon les agences des Nations unies et les ONG présentes dans l’enclave, 1,5 million des 2,1 millions d’habitants de Gaza sont aux stades 4 et 5 de l’échelle des crises alimentaires qui en compte cinq », pouvait-on lire dans l’édition du 12 mai du journal Le Monde. Depuis le 2 mars et jusqu’à ce lundi, aucune aide humanitaire n’avait pu entrer en territoire palestinien, ce qui a privé la population de ressources vitales. Lundi, le gouvernement de Benjamin Nétanyahou a finalement autorisé l’entrée de quelques camions transportant de la nourriture pour bébés. C’est trop tard, et c’est surtout trop peu.
On ne s’entend pas sur les mots à utiliser pour décrire ce qui se passe à Gaza. « Génocide » paraît trop fort à certains. Plus le temps passe, plus il me semble juste de ne pas l’écarter. Combien de Ben Cohen en colère faudra-t-il pour comprendre que vouloir protéger les Gazaouis de la violence et de la faim, ce n’est pas de l’antisémitisme ? L’homme d’affaires américain juif, cofondateur de la glace Ben & Jerry’s, a jugé crucial de perturber les délibérations du Congrès pour faire entendre sa voix. « Le Congrès finance des bombes pour tuer des enfants à Gaza », a-t-il lancé avant d’être expulsé de la salle.
Je doute que cette courageuse sortie ait une influence quelconque sur les politiques étrangères américaines. Comme je doute que la déclaration commune de Mark Carney, d’Emmanuel Macron et de Keir Starmer lundi devant les « actions scandaleuses » du gouvernement israélien ait le moindre effet sur Nétanyahou.
Par ailleurs, le samedi 10 mai à Paris, on a autorisé le défilé d’un rassemblement d’un millier de néofascistes. On a pu voir des gestes et des symboles qui faisaient directement référence au régime hitlérien. Toute la classe politique, même le Rassemblement national de Marine Le Pen, s’est inquiété de voir une telle expression de haine s’exercer librement dans les rues de la Ville Lumière. Il ne s’agit plus d’atteindre le point Godwin, c’est forcer un point de bascule grave. Serions-nous plongés dans le « paradoxe de la tolérance » du philosophe autrichien Karl Popper ?
Ici, lorsqu’un artiste québécois affiche sur sa page Facebook, en pleine Journée mondiale contre l’homophobie, le drapeau de la fierté LGBTQ+ en affirmant être fier de qui il est, des dizaines de personnes trouvent pertinent d’écrire leur dégoût sur sa page en ajoutant qu’elles ne le suivront plus désormais. Comme si être homophobe était une posture morale qui non seulement se défend, mais qui mérite d’être vue et entendue de tous.
Permettez-moi de citer ici en anglais des mots sans détour de Morgan Freeman : « I hate the word homophobia. It’s not a phobia. You are not scared. You are an asshole. » Même si je reste convaincue qu’il est contre-productif d’insulter les gens qui ne pensent pas comme nous, vient un temps où je n’ai plus aucune compassion pour ceux qui nourrissent la haine librement. Encore une fois, Popper nous rappelle qu’arrive un moment où cela revient à tolérer l’intolérance, un paradoxe qui conduit inévitablement à la victoire de la haine.
Je ne suis qu’une petite madame qui vit dans un vieux triplex de Montréal. J’ai quelques petits soucis quotidiens, dont certains me réveillent la nuit. Vais-je avoir assez de sous pour réparer le plafond de la cuisine et la vieille céramique du corridor ? Est-ce que la fracture de la cheville de ma cadette va guérir comme il faut, elle qui rentre dans un programme de danse intensif en septembre ? Bref, de petits tracas ordinaires.
Alors, pourquoi suis-je aussi inquiète en regardant mes plants de tomates se gorger de soleil ?
Tous simplement parce que je croyais candidement que notre monde devenait meilleur avec le temps, que les erreurs du passé ne seraient plus jamais commises. Parce qu’on aurait appris, on aurait compris. Or, ce printemps, ce qui semble renaître à côté des pivoines, c’est notre incapacité à vivre ensemble, à gérer les conflits sans faire mourir de faim des enfants et à protéger nos ressources naturelles.
Et au moment où tout me semble perdu ou déprimant, j’entends le rire d’un enfant qui cascade dans la ruelle. Je relève alors mes manches et je mesure ma chance d’avoir cette tribune pour vous rappeler, au nom de ces enfants, que nous avons le devoir de faire barrage à la haine. Nous avons l’obligation de nous indigner et de continuer de lutter contre l’intolérance, et ce, sous toutes ses formes.
Ce texte fait partie de notre section Opinion, qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.


 1 month_ago
1
1 month_ago
1













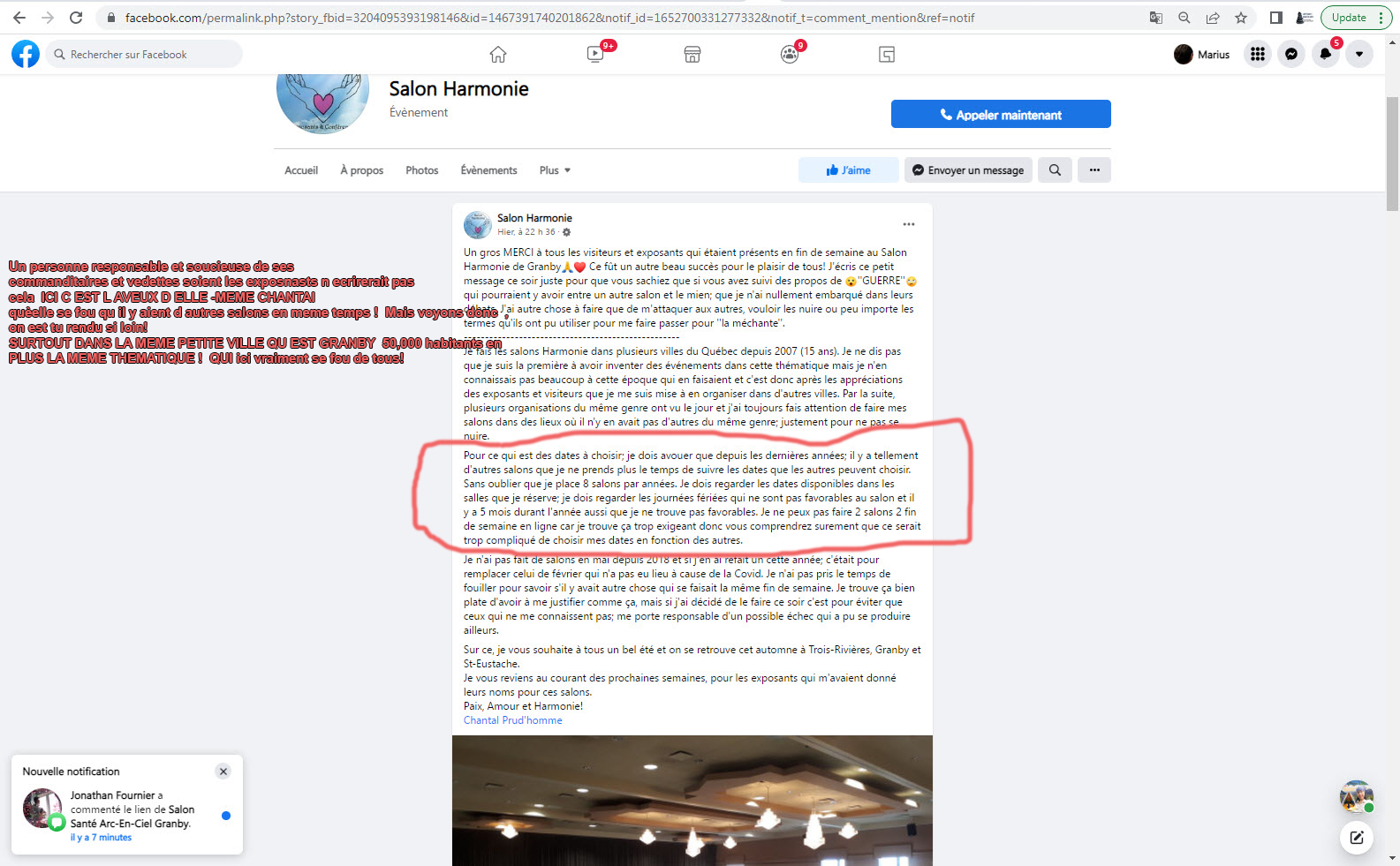

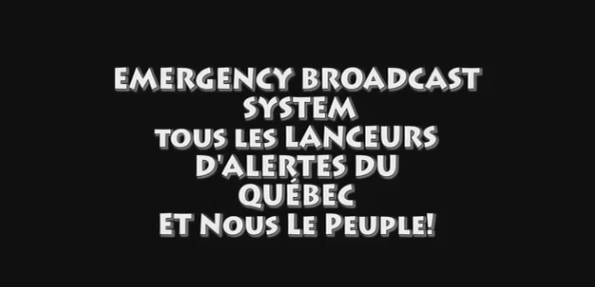
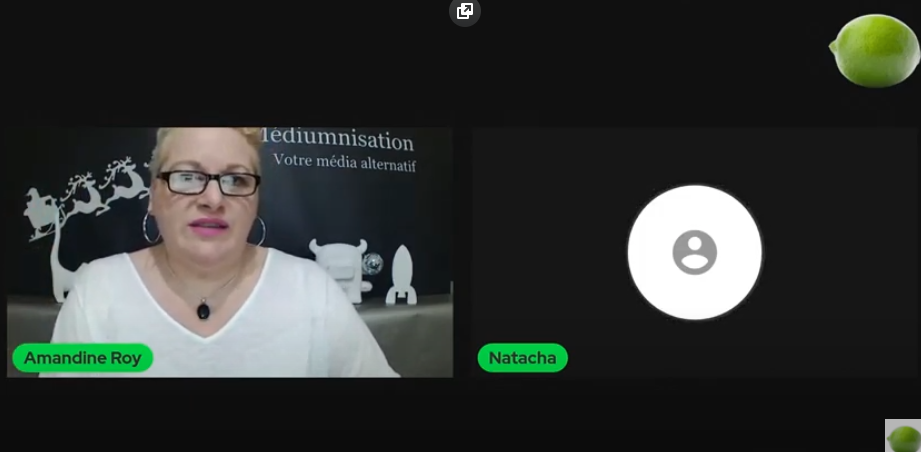





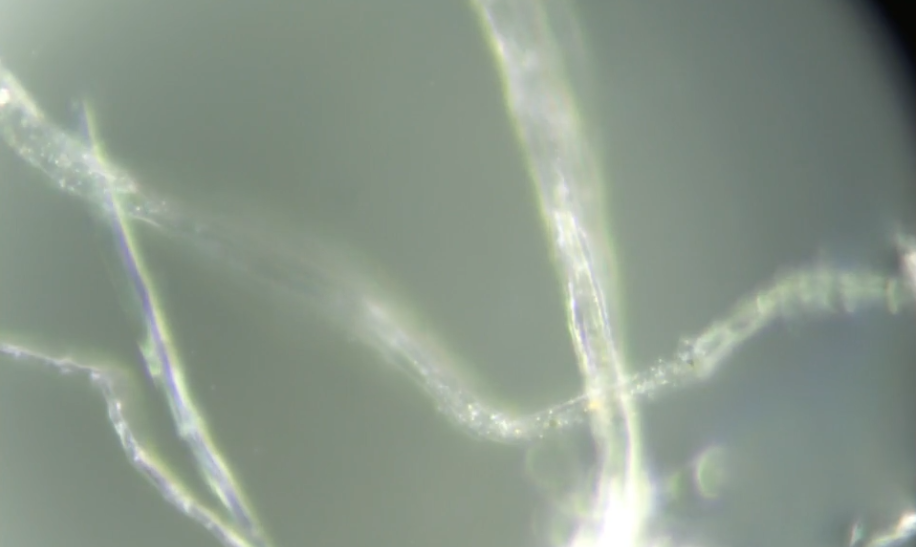


 French (CA)
French (CA)