NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
Au-delà des vitrines et du pavé, les rues commerciales sont au cœur de l’évolution de nos villes. Entre transformations urbaines, changements d’habitudes de consommation et pressions économiques, ces artères principales cherchent un nouvel équilibre.
Quand Liliane Jodoin franchit les portes du Fou-Bar, institution bien connue de la rue Saint-Jean, à Québec, tout le monde la reconnaît. Lili, comme tout le monde l'appelle ici, a été pendant plus de vingt ans copropriétaire de ce lieu emblématique.
Tu sais, à un moment donné, il faut penser à vendre! Mais on est vraiment contents d’avoir trouvé quelqu’un, une vraie personne du quartier, confie-t-elle.
Aujourd’hui, elle revient en cliente. Derrière le comptoir, le nouveau propriétaire, Sébastien Dorval, lui sert un verre. Mes parents habitent dans Saint-Jean-Baptiste, ils y sont même nés. Mon père avait une quincaillerie fondée par mon arrière-grand-père, raconte-t-il, fier de perpétuer l’attachement familial au quartier.

Liliane Jodoin assise au Fou-Bar.
Photo : Radio-Canada / Benoit Livernoche
La transition s’est faite en douceur. Mais Liliane Jodoin le sait : vendre un commerce, ce n’est pas juste signer des papiers. C’est laisser une part de soi, dans un quartier en pleine transformation.
Avant, il y avait plus de diversité, des petits commerces fins ont disparu. Aujourd’hui, on voit plusieurs restos. J’espère juste qu’ils vont tous réussir à survivre.
On va avoir de belles coupes de cheveux!, lance Sébastien Dorval en riant, en parlant des nombreux salons de coiffure installés sur la rue.
La rue Saint-Jean, à Québec, est bien plus qu’un simple axe commercial : c’est une artère historique qui incarne l’identité de la ville. Sur moins de deux kilomètres, elle relie deux univers bien distincts – le Vieux-Québec et le faubourg Saint-Jean-Baptiste.
Le reportage audio de Benoit Livernoche est diffusé sur ICI PREMIÈRE à compter de 10 h.
Dans le Vieux-Québec, on a beaucoup moins d’habitants permanents, ce sont surtout les touristes qui fréquentent la rue, explique Pierre Lanthier, directeur général de la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean. Dans Saint-Jean-Baptiste, on retrouve une forte densité résidentielle, ce qui crée une belle synergie et favorise les rencontres.
Mais lorsqu’on lui demande comment se porte la rue, le ton se fait plus préoccupé. Comme beaucoup de rues commerciales, on assiste à de nombreuses fermetures. Et ces fermetures sont souvent liées aux coûts d’exploitation, qui deviennent difficilement soutenables pour plusieurs commerçants, constate-t-il.
Taxation et coût du loyer
Nous marchons avec Pierre Lanthier devant la maison J.A. Moisan, un édifice emblématique de la rue Saint-Jean. Il s’arrête et regarde l’immeuble. J.A. Moisan, c’était un épicier, une véritable institution du quartier depuis 1871. Mais aujourd'hui, c’est fermé!, déplore-t-il.

La maison J.A. Moisan est une adresse bien connue de la rue Saint-Jean.
Photo : Radio-Canada / Benoit Livernoche
Pour lui, ce cas illustre bien la réalité de nombreux commerces de la rue. Une vente, l’augmentation des coûts… tout ça a mené à sa fermeture en janvier 2025, explique-t-il.
Un peu plus loin, il s’arrête devant un immeuble à condos plus récent, où les fenêtres du rez-de-chaussée sont recouvertes de grandes feuilles de papier. Ce local commercial est vacant depuis cinq, six, voire sept ans. C’est neuf, mais il reste inutilisé dans la communauté, se désole Pierre Lanthier.
Tant qu'on suit la logique du marché, on va avoir de plus en plus de fermetures dans le commerce de proximité.
Pour Pierre Lanthier, une partie du problème vient des taux de taxation commerciale jugés trop élevés. Les propriétaires d'édifices refilent cette facture aux commerçants, ce qui augmente le coût des loyers, explique-t-il.

Pierre Lanthier est directeur général de la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean.
Photo : Radio-Canada / Benoit Livernoche
Les coûts de location commerciale mensuels varient en moyenne de 12 $ à 18 $ du pied carré. Les revenus municipaux reposent strictement sur la taxation immobilière. Tant que cette philosophie perdurera au gouvernement, les problèmes de location persisteront, ajoute-t-il.
La rue Saint-Jean n’est pas un cas isolé. À Québec, à Montréal et ailleurs en Amérique du Nord, les artères commerciales font face à des défis similaires depuis des décennies.
À Montréal, par exemple, ça fait des années qu’on réduit progressivement le taux de taxation commerciale pour aider les commerces, indique François William Croteau, ancien maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, rencontré sur la rue Saint-Hubert.
Mais il nuance : Oui, la Ville peut agir sur la taxation, mais elle ne peut pas contrôler la flambée des loyers commerciaux.

François William Croteau est l'ancien maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal.
Photo : Radio-Canada / Benoit Livernoche
Selon lui, le problème vient en partie de l’absence d’encadrement. On a un mécanisme pour le résidentiel avec le Tribunal administratif du logement, mais rien de comparable pour les commerces. Plusieurs villes ont fait des demandes en ce sens, mais jusqu’à maintenant, aucun gouvernement n’a été réceptif, déplore-t-il.
Un changement d'habitude des consommateurs
Au-delà des loyers et de la taxation, d'autres facteurs influencent la vitalité d'une rue commerciale, comme le type de commerces, les habitudes de consommation et l’évolution du tissu urbain. La rue Saint-Hubert en est un bon exemple.
La Plaza St-Hubert, à une époque, c’était l'une des rues commerciales les plus populaires à Montréal. Dans les années 1970, avec les néons et le nightlife, c’était une rue très dynamique, qui a perdu beaucoup de son lustre dans les années 1980, raconte François William Croteau, qui réside tout près. Les gens venaient des banlieues pour trouver certains biens qu'ils n'avaient pas près de chez eux, ajoute-t-il.

La Plaza Saint-Hubert a vécu son premier été de piétonnisation complète en 2024.
Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis
Mais les temps ont changé. La multiplication des commerces, petits et grands, dans les villes comme dans les banlieues, a modifié les habitudes d’achat. Les gens n’ont plus besoin de venir à Montréal pour se procurer des produits fins. Ce n’est plus vrai qu’on va faire des kilomètres pour certains achats, fait-il remarquer. Avec la montée du commerce en ligne, la rue commerciale doit se réinventer, d'après lui.
Il faut recentrer l’expérience autour de la déambulation en milieu urbain, créer un lieu vivant, animé, où il se passe quelque chose – pour et par les gens du quartier.
On devrait voir la rue comme un espace communautaire, à l’image des gens qui y vivent et qui l’animent, affirme Anne-Sophie Trottier, membre du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Ce groupe de résidents milite depuis des années pour rendre la rue Saint-Jean, à Québec, plus conviviale et accessible à tous.
Comme bien d'autres artères principales, cette rue est aujourd'hui conçue avant tout pour la voiture : elle est à sens unique sur trois voies – deux réservées à la circulation et une au stationnement.
Il y a énormément de circulation de transit sur la rue Saint-Jean – des fonctionnaires, des travailleurs qui l’utilisent pour accéder ou quitter la colline Parlementaire, observe-t-elle. Aux heures de pointe, la rue est envahie par les voitures. Il est devenu pratiquement impossible d’y prendre un café en toute tranquillité. C’est beaucoup trop achalandé par l’automobile.

La rue Saint-Jean à Québec, une artère très achalandée, est notamment fréquentée par les résidents du quartier.
Photo : Radio-Canada / Benoit Livernoche
Pierre Lanthier, directeur général de la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean, partage son avis. La rue Saint-Jean est clairement engorgée. Et si on ne prend pas des mesures fortes rapidement, la situation ne fera que se détériorer dans les prochaines années, estime-t-il.
Pour lui, une refonte de l’aménagement est devenue incontournable. Il faut repenser l’accès, revoir entièrement la configuration de la rue. Et surtout, se poser une vraie question collective : qu’est-ce qu’on veut pour cette rue dans dix ans?
Ces réflexions s’inscrivent dans un débat plus large, qui dépasse les frontières du quartier Saint-Jean-Baptiste : comment redistribuer équitablement l’espace public entre automobilistes, cyclistes et piétons?
À Montréal, par exemple, l’aménagement du Réseau express vélo (REV) sur la rue Saint-Denis a suscité de vives tensions. Plusieurs commerçants redoutaient une baisse de fréquentation. Aujourd’hui, après de longs travaux, la piste cyclable fait désormais partie intégrante du paysage urbain.

Des cyclistes empruntant le Réseau express vélo de la rue Saint-Denis à Montréal.
Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas
Une piétonnisation complète?
L'idée n'est pas nouvelle. Importé d'Europe, le concept de rues piétonnes a été adopté dans plusieurs villes nord-américaines dans les années 1970 et 1980 dans le but de revitaliser les artères commerciales des centres-villes. Cependant, les résultats ont souvent été mitigés.
Le modèle européen, appliqué tel quel, n’a pas bien fonctionné ici, observe Stephen Schmidt, professeur en urbanisme à l’Université Cornell, située à Ithaca, dans l’État de New York. Ce spécialiste a étudié l’évolution des rues commerciales piétonnes aux États-Unis.
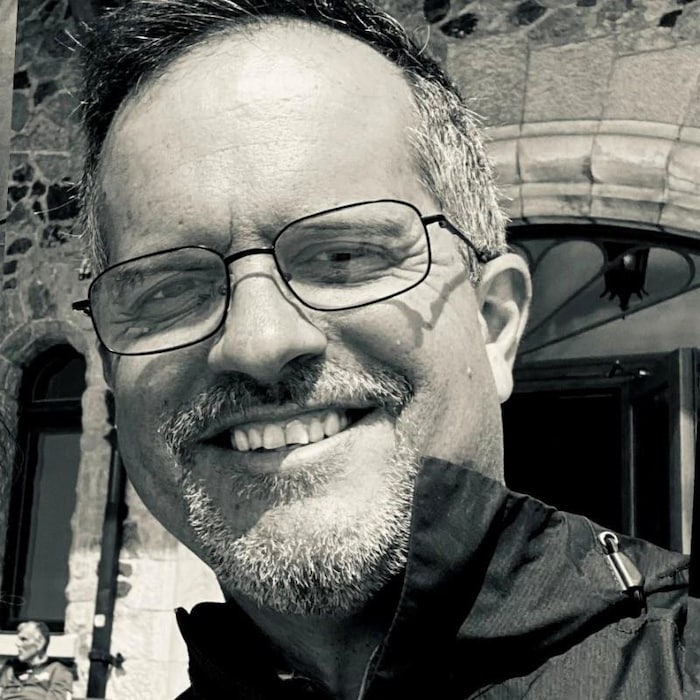
Stephen Schmidt est professeur en urbanisme à l’Université Cornell, située à Ithaca.
Photo : LinkedIn
Il y a eu jusqu’à 200 rues piétonnes au pays. Aujourd’hui, il en reste à peine une quarantaine – la plupart ont été rouvertes à la circulation automobile, ajoute-t-il.
À Montréal, la Ville expérimente depuis plusieurs années la piétonnisation estivale de certains tronçons de la rue Sainte-Catherine. Elle caresse toujours l’idée de rendre l’artère piétonne à long terme, mais elle a dû faire marche arrière face aux inquiétudes des commerçants. À l’été 2024, elle a aussi tenté l’expérience sur la rue Saint-Hubert, avant de renoncer à la reconduire cette année.

La rue Sainte-Catherine est piétonne sur certains tronçons l'été à Montréal.
Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz
Même scénario à Québec, où des projets pilotes ont été lancés sur l’avenue Cartier et la rue Saint-Jean durant quelques saisons estivales. La piétonnisation de Cartier a été abandonnée l’an dernier. La rue Saint-Jean, elle, demeure piétonne les fins de semaine durant l’été.
Pour Stephen Schmidt, le succès d’une rue piétonne dépend de conditions bien précises. Il faut une forte densité résidentielle ou une attraction naturelle, comme une université ou un site touristique. Il doit déjà exister une vie de quartier, un flux piéton régulier, souligne-t-il.
Une rue piétonne ne crée pas à elle seule du passage suffisant pour soutenir les commerces de détail.
Les rues partagées?
Une option plus souple, selon lui, s’impose peu à peu, celle des rues partagées. Ce n’est pas un modèle unique. Ce sont des aménagements flexibles, adaptés aux réalités locales de chaque quartier. C’est ce qui fait leur force, explique-t-il.
La rue Saint-Hubert a adopté cette approche depuis quelques années. Le principe est simple : les piétons peuvent circuler librement sur la voie publique et ils ont priorité en tout temps. En conséquence, la vitesse des véhicules motorisés y est limitée à 20 km/h.
On est justement dans une formule intermédiaire, un équilibre, avise François William Croteau. Peut-être qu’une rue entièrement piétonne ne convient pas partout, mais ralentir la circulation permet de redécouvrir la rue autrement. Les voitures font moins de bruit, c’est moins agressant et ça rehausse l’expérience commerciale.

La vitesse maximale des véhicules est réduite dans les rues partagées.
Photo : Radio-Canada / Benoit Livernoche
L’ancien élu municipal reste toutefois convaincu du potentiel d’une piétonnisation complète à long terme, même si cela fait débat.
Un jour, nous aurons notre Rambla sur la rue Sainte-Catherine, lance-t-il, en évoquant la célèbre promenade piétonne du centre-ville de Barcelone. Mais d’ici là, la rue partagée est sans doute la meilleure étape de transition.
Une rue, ses hauts et ses bas
L’idée des rues partagées gagne du terrain, même à Québec. La Ville est en voie d’aménager plusieurs nouvelles rues de ce type dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, à quelques pas de la rue Saint-Jean.
Une rue partagée complètement sur Saint-Jean, ce serait un rêve, mais on est déjà dans cette lignée-là, affirme Pierre Lanthier. Ça viendra peut-être dans cinq, dix, quinze ou vingt ans.

Sébastien Dorval est le nouveau propriétaire du Fou-Bar.
Photo : Radio-Canada / Benoit Livernoche
De retour au Fou-Bar, l’ancienne propriétaire Liliane Jodoin échange avec le nouveau propriétaire Sébastien Dorval sur l’avenir de cette artère emblématique. Rues piétonnes ou rues partagées : tous les concepts font jaser, mais avec nuance.
J’ai toujours circulé à pied, je n’ai pas de voiture. Mais j’ai quand même besoin d’appeler un taxi ou de recevoir des livraisons. On ne peut pas simplement fermer la rue complètement, souligne Liliane Jodoin.
Sébastien Dorval partage son point de vue. On est en Amérique du Nord, avec six mois d’hiver. Une rue 100 % piétonne, 100 % du temps, ce n’est pas réaliste, croit-il.
Liliane Jodoin, témoin de l’évolution du quartier depuis des décennies, reste confiante dans le rythme naturel des choses.
Je la vois faire son petit bonhomme de chemin, la rue. Je suis une fille au jour le jour, alors je la laisse aller. La rue est en mouvance, comme tout le monde. Y’a des hauts, y’a des bas… mais là, c’est pas pire , conclut-elle avec le sourire.


.png) 1 month_ago
10
1 month_ago
10

























 French (CA)
French (CA)