NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
Malgré certaines avancées encourageantes, les préjugés entourant le consentement et les agressions demeurent très forts au Québec, stipule une étude de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ils varient notamment selon l'âge et le genre des répondants.
On peut constater certaines avancées encourageantes, mais il y a des enjeux qui demeurent préoccupants, explique d’emblée Sandrine Ricci, en entrevue à l'émission C'est encore mieux l'après-midi. La chercheure doctorante en sociologie et études féministes est une des co-autrices de l’étude L’adhésion aux mythes et préjugés sur l’agression sexuelle chez les Québécoises et Québécois de 15 ans (nouvelle fenêtre).
La crédibilité des femmes victimes est encore mise à mal par des préjugés persistants. Les croyances qui remettent en question la crédibilité des femmes victimes recueillent les niveaux d’adhésion les plus élevés, mentionne l’étude.
Méthodologie :
L'étude s'est servie d'un sondage mené par la firme Advantis, spécialisée en enquêtes populationnelles dans le domaine social, pour la collecte de ses données. Il s'est déroulé du 11 novembre au 8 décembre 2024. La marge d'erreur est évaluée à moins de 5 %.
Sur les 1222 personnes interrogées par la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles de l’UQAM, par exemple, près du quart se montre en accord avec le fait que le consentement n’est pas toujours nécessaire lors d’une relation sexuelle.
On est encore en train de convaincre les gens que le fait que la femme porte une mini-jupe n’est complètement pas un indicateur de quoi que ce soit, se désole l’universitaire.
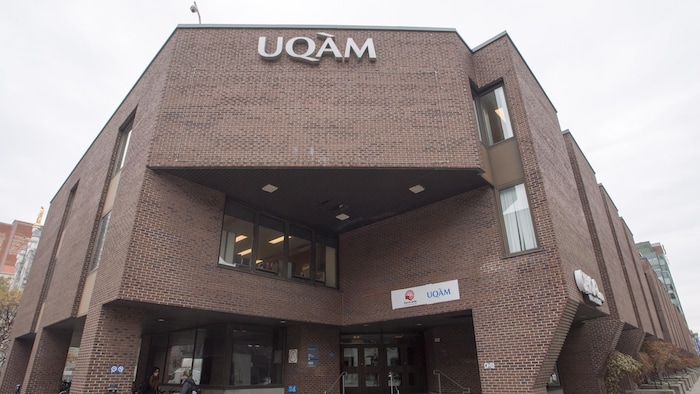
L'étude a été réalisée par la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles de l’UQAM. (Photo d'archives)
Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz
Des différences notables ont également été remarquées selon le genre, relate l’étude.
Les femmes sont plus nombreuses à exprimer des attitudes positives par rapport à cette question de consentement, c’est la même chose concernant les mythes et préjugés sur les agressions sexuelles. [...] Les hommes sont un groupe social qui a tendance à plus endosser les mythes et préjugés qui sont problématiques, explique Sandrine Ricci.
Elle l’a cherché, elle a menti, il n’en avait pas l’intention ou encore ce n’était pas vraiment une agression sexuelle font partie des mythes auxquels les hommes adhèrent davantage.
Reflet de la culture du viol
Les résultats du rapport témoignent de la persistance de la culture du viol dans la population québécoise. Selon les chercheures, cette culture peut être résumée à un ensemble de croyances, de pratiques et de normes qui banalisent ou encore excusent les violences sexuelles.
L’adhésion, mais aussi le rejet partiel à ces mythes, indique que la culture du viol demeure un système de représentation actif dans la société québécoise, expliquent les chercheures.
Les jeunes et les aînés aussi
Les jeunes adultes entre 15 et 25 ans ainsi que les personnes âgées de 66 ans ou plus sont aussi portés à croire les différents stéréotypes liés au consentement.
[Elles] présentent des niveaux d’adhésion plus élevés que les autres tranches d’âge à plusieurs catégories de mythes sur l’agression sexuelle, notamment ceux qui tendent à déresponsabiliser l’agresseur et à ceux qui remettent en question la crédibilité des femmes victimes d’agression sexuelle, fait état l’étude.

Les jeunes entre 15 et 25 ans ont tendance à adhérer davantage à certains stéréotypes. (Photo d'archives)
Photo : getty images/istockphoto / Chinnapong
Signe que l’on doit redoubler d’ardeur pour sensibiliser les prochaines générations, selon Sandrine Ricci. Si les jeunes endossent des mythes et préjugés, ça démontre bien que c’est un éternel recommencement, affirme-t-elle sans détour.
Il y a besoin d’intensifier les efforts de sensibilisation et d’éducation sur le consentement, sur la violence sexuelle et ça suppose que l’on commence avant l’université, ajoute-t-elle.
Le constat est le même chez les personnes qui n’ont pas effectué d’études postsecondaires. Le niveau de scolarité influence l’accès à des outils d’analyse critique, la capacité à déconstruire les stéréotypes sociaux, et l’exposition à des discours féministes, juridiques ou médiatiques sur les violences sexuelles, peut-on également lire dans l’étude.
Avec les informations de Guillaume Dumas et Julien Fontaine-Doray


.png) 1 month_ago
11
1 month_ago
11

























 French (CA)
French (CA)