NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
L’augmentation des gaz à effet de serre, en particulier le CO2 libéré par la combustion des énergies fossiles, a des conséquences climatiques qui menacent de devenir plus persistantes et néfastes dans un avenir proche. Stopper ces émissions serait la solution idéale, mais cela est loin d’être le cas. Même si cela était réalisé, la quantité de dioxyde de carbone déjà libérée est telle que ses effets nocifs persisteraient longtemps. Il n’existe pas de solutions miracles, bien sûr, mais des stratégies sont en cours d’élaboration qui, ensemble, pourraient atténuer le problème. L’une de ces solutions intéressantes est la séquestration géologique du carbone, explorée par Víctor Vilarrasa, chercheur principal au Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) à l’Institut méditerranéen d’études avancées (Imedea).
Le principe de la séquestration géologique
Víctor Vilarrasa étudie le stockage géologique du carbone. L’idée de base est simple : collecter le CO2 émis lors des processus industriels et, au lieu de le libérer dans l’atmosphère, l’enfouir sous terre dans des couches profondes. La mise en œuvre, bien sûr, est plus complexe. Pour réaliser cette idée,il est nécessaire d’exécuter une série de processus.
Le saviez-vous ? La séquestration géologique du carbone est une technologie prometteuse pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique.
La première étape consiste à séparer le dioxyde de carbone présent dans les gaz émis par certaines industries, telles que les centrales électriques au charbon ou au gaz, les cimenteries, les raffineries ou les aciéries. Étant donné que les couches profondes appropriées au stockage géologique ne se trouvent généralement pas sous les sites d’émission, le CO2 collecté doit être transporté par des gazoducs jusqu’au lieu choisi et traité, soit en le soumettant à des pressions élevées pour le liquéfier, soit en le transformant en un fluide supercritique, c’est-à-dire un état intermédiaire entre le liquide et le gaz. Dans cet état, le CO2 a une densité plus élevée et un volume moindre et peut être injecté dans des formations géologiques adéquates pour le confinement.
Les conditions idéales pour le stockage
Les caractéristiques géologiques du lieu d’injection doivent être adéquates pour que le dioxyde de carbone injecté soit confiné sur de longues périodes sans fuites qui renvoient le CO2 dans l’atmosphère et sans provoquer de mouvements qui pourraient contaminer les eaux souterraines au fil du temps.En ce sens, explique Víctor Vilarrasa, des couches situées à plus de 800 mètres de profondeur, bien plus profondes que les aquifères d’eau douce, sont recherchées. L’idéal sont les roches très anciennes, formées à partir des sédiments des mers ancestrales et enfouies à de grandes profondeurs. Ces roches sédimentaires contiennent de grandes quantités d’eau salée, une eau qui occupe les pores depuis les temps reculés où le sédiment s’est formé, ce qui donne une idée de sa stabilité sur des millions d’années.
Conseil pratique : La surveillance continue des sites de stockage est essentielle pour détecter et prévenir les fuites de CO2.
Pour éviter le retour du CO2 injecté à la surface, on recherche des formations dans lesquelles les couches poreuses sont situées sous des couches imperméables, qui agissent comme une couverture et empêchent la remontée du dioxyde de carbone vers la surface. L’ensemble ainsi formé est similaire à celui qui stocke les hydrocarbures qui sont généralement forés pour obtenir des combustibles fossiles. De même que le pétrole ou le gaz sont les restes de dioxyde de carbone capturé par les plantes et autres organismes, le stockage profond vise à renvoyer dans les profondeurs le dioxyde de carbone que nous générons actuellement avec la combustion des combustibles fossiles et ainsi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique par effet de serre.
Les risques et les solutions
L’injection de CO2 dans les couches profondes n’est pas exempte de dangers. C’est pourquoi il faut très bien étudier le lieu où l’on a l’intention de le faire et comprendre quels peuvent être les inconvénients. Lorsque du dioxyde de carbone est injecté dans une couche profonde, il y a une augmentation de la pression qui peut avoir des effets négatifs tels que des événements sismiques dus à une accumulation de pression, en particulier lorsque le lieu d’injection est situé à proximité d’une faille chargée, ou des fuites qui peuvent contaminer les aquifères.
Question pour les lecteurs : Quelles sont, selon vous, les mesures les plus importantes à prendre pour garantir la sécurité du stockage géologique du carbone ?
Dans un article récemment publié dans Geophysical Research Letters, signé par le chercheur postdoctoral iranien Iman Rahimzadeh Kivi et Víctor Vilarrasa, entre autres, les chercheurs calculent, via des modèles, la manière dont le gaz stocké évolue, tant dans sa capacité de pénétration entre les différentes couches de roche que dans l’évolution temporelle de ces mouvements. Les chercheurs ont développé un modèle numérique de transport pour comprendre la destination à long terme du CO2 dans le stockage géologique à l’échelle du gigatonne. Les calculs révèlent que l’échappement de CO2 est dominé par la diffusion moléculaire à des vitesses intrinsèquement lentes, approchant à peine un mètre tous les milliers d’années.
Conclusion
La séquestration géologique du carbone représente une avenue prometteuse pour atténuer les effets du changement climatique. Bien que des défis subsistent, la recherche continue d’améliorer notre compréhension des risques et des solutions potentielles. Comme le souligne Víctor Vilarrasa, une approche prudente et basée sur la science est essentielle pour garantir la sécurité et l’efficacité de cette technologie.
FAQ sur la séquestration géologique du carbone
- qu’est-ce que la séquestration géologique du carbone ? C’est le processus de capture du CO2 provenant de sources industrielles et de son stockage souterrain dans des formations géologiques profondes.
- Est-ce une technologie sûre ? Si elle est mise en œuvre correctement, avec une surveillance rigoureuse, elle peut être sûre. Des études approfondies sont nécessaires pour chaque site.
- Quels sont les avantages ? Réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère, contribution à la lutte contre le changement climatique.
- Quels sont les risques potentiels ? Fuites de CO2, contamination des eaux souterraines, déclenchement de séismes (rare).
- Où est-ce pratiqué ? Divers projets pilotes et commerciaux existent dans le monde entier, notamment en Norvège, au Canada et aux États-Unis.
Référence
kivi, I. R., Makhnenko, R. Y., Oldenburg, C.M., Rutqvist, J., & Vilarrasa, V. (2022). multi-layered systems for permanent geologic storage of CO2 at the gigatonne scale. Geophysical Research Letters,49,e2022GL100443.


.png) 1 month_ago
26
1 month_ago
26


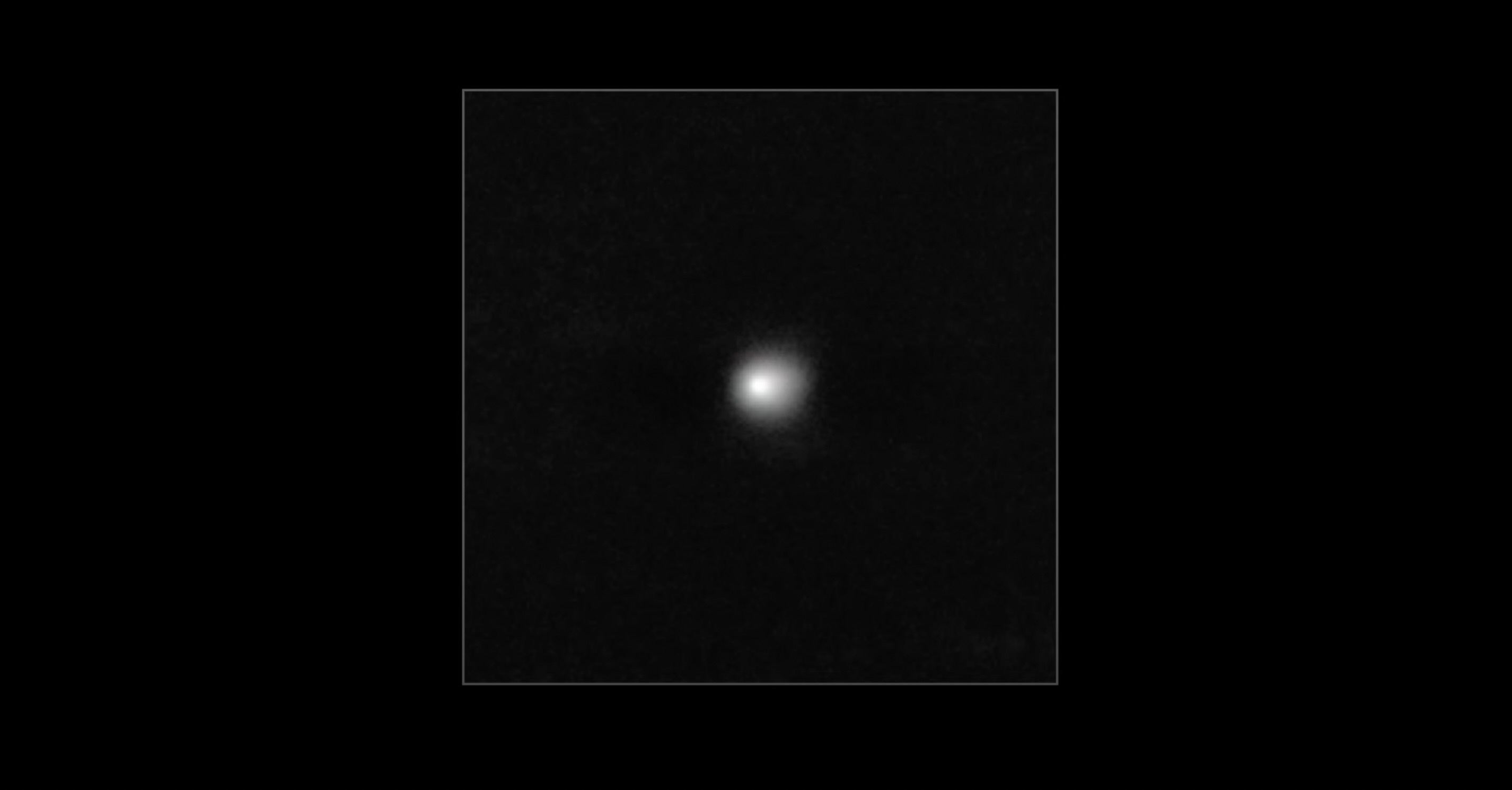






















 French (CA)
French (CA)