NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
FIGAROVOX/ENTRETIEN - Dans son nouveau livre, Celle qui part, Salomé Berlioux pose un regard sensible sur les femmes rurales, invisibilisées parmi les invisibles. Elle décrit leurs défis et plaide pour une valorisation de leurs spécificités au sein des campagnes.
Salomé Berlioux est directrice générale de Rura (ex-Chemins d’avenirs). Auteure de plusieurs livres, elle dirige la collection Raconter les Territoires aux Éditions de l’Aube. Elle publie « Celle qui part » (L’Aube, 208 p., 17 euros).
LE FIGARO. - Vous avez consacré plusieurs ouvrages à la jeunesse des campagnes. Ce dernier livre, qui prend la forme d’un recueil de nouvelles, suit des protagonistes féminines exclusivement. Existe-t-il une spécificité féminine de la ruralité ?
SALOMÉ BERLIOUX. - Il existe bien sûr des différences entre les femmes rurales, dont le quotidien et les paramètres ne sont pas exactement les mêmes lorsqu’elles habitent un hameau dans une zone de montagnes ou bien un village de bord de mer, ou lorsqu’elles évoluent dans le Nord, l’Est ou le Centre de la France avec, par exemple, des bassins d’emplois différents. Mais, au-delà de ces différences, émerge ce qu’on pourrait appeler une condition féminine rurale, avec des marqueurs d’une identité commune entre ces millions de femmes, quels que soient leur âge et le coin de France rurale où elles vivent. Je pense par exemple à la question centrale des kilomètres qui rythment le quotidien de ces femmes quand elles étudient, travaillent ou souhaitent accéder à des opportunités différentes de celles de leur environnement immédiat.
Je pense aussi au fait qu’elles se concentrent surtout dans les métiers du soin et des services à la personne. Ou encore à la manière dont la charge mentale – que les femmes assurent dans la gestion logistique du foyer – est renforcée dans ces territoires ruraux, du fait de l’éloignement des services publics et de l’emploi. Or, cette spécificité de la condition des femmes rurales n’est pas reconnue. Ces dernières souffrent d’une double invisibilisation, liée à leur genre d’une part et à leur ancrage géographique d’autre part.
Qu’apporte, selon vous, ce regard féminin à la représentation du monde rural ?
Quand on parle d’inégalités systémiques, le risque est bien sûr de tomber dans le misérabilisme. C’est pourquoi il est indispensable, en même temps qu’on dénonce les inégalités, de donner aux femmes rurales leurs lettres de noblesse, de pas les placer en situation de victimes. De rappeler l’engagement de ces femmes, entre elles et pour leurs territoires. La façon dont elles participent très souvent aux dynamiques de leur commune, à la solidarité intergénérationnelle.
Dans Des femmes qui tiennent la campagne, Fanny Renard et Sophie Orange mettent notamment en lumière la façon dont les femmes rurales agissent en faveur du lien social, à travers des gestes qui semblent souvent anecdotiques mais sont en réalité transformateurs. Ce sont les femmes qui tiennent par exemple les comités de fêtes, les associations de parents d’élèves, ou qui ajoutent bénévolement l’assistance aux personnes âgées sur les nombreux trajets qui jalonnent leur journée. Les femmes rurales agissent, comme élues, dans des associations ou des syndicats. Elles n’ont pas attendu d’être visibles ou reconnues pour s’engager.
Ce que je souhaite, c’est permettre au lecteur de plonger dans le quotidien, les défis, le ressenti des femmes des campagnes.
Salomé BerliouxLes titres des différentes nouvelles, et leur contenu, évoquent des mouvements qui font de la campagne à la fois un lieu de transition et d’ancrage. Qu’avez-vous voulu mettre en avant par ce choix narratif ?
Ces mouvements montrent toute l’ambivalence du lien à son territoire quand on est une femme rurale, entre, parfois envie d’ailleurs, désir de rester, nécessité de s’arracher, conflits de loyauté avec ses proches… Ambivalences plus ou moins grandes en fonction de son histoire et de paramètres sociaux, économiques et culturels.
Ces dernières années, j’ai particulièrement travaillé autour des jeunes ruraux et de la manière dont l’éloignement géographique des opportunités dicte leur choix de formation puis leur entrée dans l’emploi. Rappelons que 70% des formations se situent dans les métropoles. Les jeunes ruraux sont donc confrontés, très jeunes, au poids des distances. Cette réalité s’impose tout particulièrement aux jeunes filles, à qui des résultats scolaires souvent meilleurs que ceux des garçons du même âge permettent de prétendre à des études supérieures… nécessairement éloignées de leur domicile familial. Que faire alors ? Avec quels moyens ? Et quelles conséquences ?
Par ailleurs, les parcours de mes personnages s’inscrivent aussi dans ce qui m’apparaît être une impérieuse nécessité, à savoir donner la parole aux habitants des campagnes sans les essentialiser, sans les caricaturer ni les réduire à un rôle (en l’espèce, par exemple, la femme de l’agriculteur) ou à une image stéréotypée (la jolie carte postale d’une France éternelle, avec son clocher et ses coquelicots).
Ce que je souhaite, c’est permettre au lecteur de plonger dans le quotidien, les défis, le ressenti des femmes des campagnes. Mais aussi dénoncer le regard urbano-centré encore posé sur ces territoires, par exemple à travers le personnage de Garance qui passe par un territoire rural pour quelques jours et dans une logique de consommation. Ce regard alimente des représentations biaisées et, par effet rebond, un ressentiment rural dont j’ai déjà parlé ici et qui n’est pas sans conséquences sur la montée du vote Rassemblement national.
Que révèlent les trajectoires de vos héroïnes des fractures et des dynamiques de la société ?
Mes héroïnes ont entre 14 et 50 ans et évoluent dans le département de l’Allier, où j’ai grandi. Il y a Mathilde, celle qui part, Louane, celle qui reste, Sophie, celle qui arrive, Ophélie, celle qui revient… À travers leur quotidien, leurs tensions intérieures et les personnages qui gravitent autour d’elle – une mère, un frère, un ex-mari, une amie – j’ai essayé de revenir sur cette puissante dialectique rurale : partir ou rester. Partir, mais vers où et comment ? Rester, mais pour faire quoi ? Revenir, mais dans quelles conditions ?
J’ai aussi souhaité varier les formats – une lettre, les pages d’un journal intime, une séance chez un psychanalyste, un monologue intérieur, et par ce biais aborder différents enjeux qui se posent aux femmes rurales, loin des idées reçues. C’est la raison pour laquelle aucune de mes héroïnes n’est agricultrice… Mais toutes se confrontent à des défis personnels, comme celui d’admettre son homosexualité quand on est une adolescente dans un petit village, celui de revenir après des années à la capitale, ou celui de composer avec ses origines quand on est rurale et issue de l’immigration. Comme dit Joël Giraud, «les territoires ruraux sont l’avenir de notre pays !».
À lire aussi Joël Giraud: «Les territoires ruraux sont l'avenir de notre pays !»
La crise sanitaire de 2019 a fait éclore le terme d’ « exode urbain » pour décrire un phénomène qui reste néanmoins, avec cinq ans de recul, timide. Était-ce, selon vous, un mirage ?
En 2020, j’avais consacré un livre, Nos campagnes suspendues, à ce sujet, un essai qui avait pour objectif de rompre avec le regard urbain sur la crise sanitaire, pour parler des problématiques des territoires ruraux face au Covid et à ses conséquences. J’avais alors l’intuition qu’on allait massivement fantasmer une « revanche des campagnes » post-coronavirus, dans le prolongement des mouvements d’urbains privilégiés qui étaient partis se confiner dans leurs résidences secondaires dans le Perche.
La réalité, c’est qu’il y a évidemment eu différents mouvements de population depuis plusieurs années, et ce avant même la crise sanitaire, avec des départs d’urbains vers les banlieues ou les villes moyennes. En revanche, non, il n’y a pas eu d’ « exode urbain » massif, pour des raisons évidentes, notamment le recul des services publics dans les territoires ruraux, les emplois que l’on y trouve ou non, la connexion ou non aux grandes métropoles via le TGV… Les Parisiens peuvent fantasmer une existence hors de Paris. Mais, bien souvent, cette volonté s’émousse quand elle se confronte à la réalité. Pour ne prendre qu’un exemple lié aux déserts médicaux dans la ruralité et dont les conséquences pèsent directement sur les femmes de ces territoires : 6 femmes rurales sur 10 disent aujourd’hui de pas avoir accès facilement à une offre de soins adaptée.
À l’instar de votre précédent roman, La peau des pêches , ce livre explore la chair et les relations sentimentales. La campagne imprime-t-elle une tonalité particulière à la manière de vivre et de raconter l’intime ?
Peut-être y a-t-il en effet un recours aux cinq sens qui est exacerbé quand on grandit à la campagne et qui se retrouve ensuite dans l’écriture ? Un rapport au temps qui passe différent, aussi. On peut à mon sens retrouver cette sensorialité chez une auteure comme Colette ou, pour citer des auteures plus récentes, comme Maria Pourchet qui vient des Vosges ou Marie-Hélène Lafon qui vient d’Aurignac. Ce qui est certain, c’est que j’avais envie et même besoin que l’on retrouve dans ces récits la brutalité et l’âpreté de certaines conditions rurales. Tout autant que la douceur et la sensualité du lien que l’on peut entretenir, de façon presque viscérale, avec ces lieux. Et qui prennent leur source, j’en suis convaincue, dans l’enfance.



 4 day_ago
20
4 day_ago
20


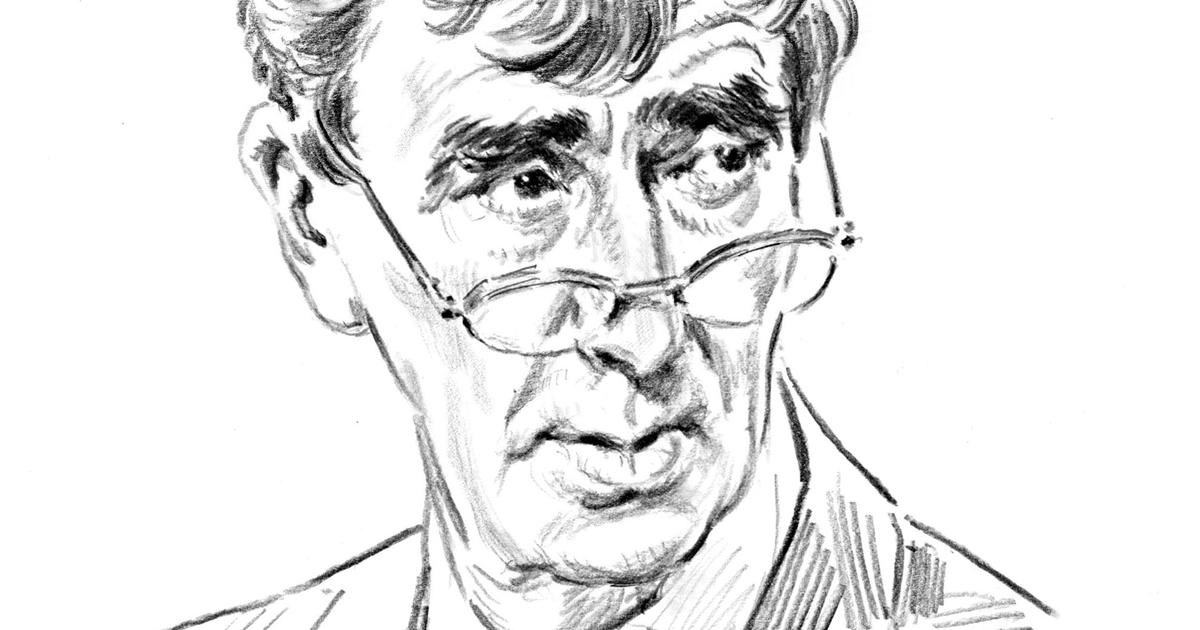






















 French (CA)
French (CA)