NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
Ce livre est au programme du thème de Culture générale et expression en BTS 2025-2026 : « Les animaux et nous : imaginer, connaître, comprendre l’animal ». Je ne l’avais jamais lu, mais il somnolait dans ma bibliothèque. J’aime bien Joseph Kessel (1898-1979), ce juif résistant, co-auteur des paroles du « Chant des partisans » et qui obtint le visa n°1 de l’État d’Israël. Je n’ai lu que trois livres de lui, dont je garde un bon souvenir, L’Armée des ombres, Une balle perdue & Les Cavaliers). Celui-ci, qui se laisse lire, m’a un peu déçu en ce qui concerne mon choix de livre pour mes étudiants de BTS, qui sont des fauves peu assoiffés de feuilles blanches imprimées. J’ai trouvé le style trop littéraire, le récit poussif (il faut atteindre presque la moitié du livre pour la grande scène du II), les personnages peu exaltants, et finalement, l’histoire un peu anecdotique. Le Lion est l’aventure d’une fillette solitaire à qui on a offert un chaton qui lui a servi de jouet, et qui s’étant révélé un lion, fut réinstallé dans le parc animalier dont son père est l’administrateur. Le lion adulte joue double jeu, toujours « Rominet » pour la fillette, mais mâle polygame pour ses deux lionnes, et bête sauvage pour les chasseurs de lions. Je me contenterai pour cette fiche de lecture, de citer de larges extraits utilisables en classe de BTS.
Pour info, j’ai trouvé un site russe où l’on peut lire le livre gratos !
Le Lion a été inspiré par le séjour de l’auteur dans un des parcs nationaux du Kenya, et il remercie son « ami le major Taberer », qui n’a rien à voir avec les personnages névrosés du roman, le directeur Bullit, ancien viandard, et son épouse la délicate Sybil. L’action se déroule « dans la réserve d’Ambolesi » (= Parc national d’Amboseli). Le narrateur, qui n’a pas de nom, arrive seul avec son chauffeur et domestique Bogo, dans cette réserve où il est accueilli sur la recommandation d’une Parisienne, Lise Darbois, ancienne amie de Sybil, la femme du directeur, dont il a fait la connaissance en coup de vent à Paris. Il ne doit rester que 24 h, mais sa fascination pour Patricia, la fillette enfant unique du couple, qui a un rapport direct avec les animaux et même avec les Africains dont elle connaît toutes les langues, le pousse à prolonger son séjour. Attention, Kessel n’est pas Nabokov, et Patricia n’a rien d’une Lolita, vous êtes prévenus ! Mais les deux livres sont contemporains, et je suis persuadé que Kessel a soigneusement évité toute interprétation tendancieuse en montrant explicitement que son narrateur n’est intéressé que par la relation de Patricia avec King, et en inventant une sorte de jalousie improbable de la fillette pour les femelles de King ! Cela dit, une lecture plus fine suggère que derrière la fillette au comportement ambigu avec les animaux, se profile la figure de la déesse-mère Cybèle chevauchant un lion…
Première partie, chapitre II.
Extrait 1. « Patricia continuait de sourire, mais ce sourire n’exprimait plus seulement la moquerie et un sentiment de supériorité. Il reflétait de nouveau la tranquille certitude et la faculté qui étaient siennes de pouvoir communiquer avec les êtres les plus primitifs selon les lois de leur propre univers.
— Les noirs d’ici viennent tout me raconter, reprit Patricia. Je suis au courant de leurs affaires beaucoup plus que mon père lui-même. Il connaît seulement le swahili, et encore, il prononce comme un blanc. Et puis, il est sévère, c’est son métier. Moi, je ne rapporte jamais. Les employés, les gardes, les serviteurs le savent bien. Alors, ils parlent. Thaukou, le clerc, m’a dit que votre passeport était français et que vous habitiez Paris. Le boy des bagages m’a dit que votre valise était très lourde à cause des livres. Le boy de la hutte m’a dit : « Le blanc a refusé que je chauffe son bain et il n’a rien mangé avant de dormir tant il était fatigué. »
Extrait 2. « De quelles courses à travers la Réserve royale et de quelles veilles au fond des fourrés épineux, par quelle inépuisable vigilance et quelle intimité mystérieuse Patricia avait-elle recueilli l’expérience dont elle me faisait part ? Ces troupeaux interdits à tous étaient devenus sa société familière. Elle en connaissait les tribus, les clans, les personnages. Elle y avait ses entrées, ses habitudes, ses ennemis, ses favoris.
Le buffle qui, devant nous, se roulait dans la vase liquide avait un caractère infernal. Le vieil éléphant aux défenses cassées aimait à s’amuser autant que le plus jeune de la horde. Mais sa grande femelle, d’un gris presque noir, celle qui en ce moment poussait de la trompe ses petits vers l’eau, son goût de la propreté devenait une manie.
Parmi les impalas qui portaient sur chacun de leurs flancs dorés une flèche noire, et qui étaient les plus gracieuses des antilopes, et les plus promptes à
l’effroi, Patricia montrait celles qui la recevaient sans crainte. Et chez les tout petits bushbucks aux cornes en vrille, et si courageux malgré leur fragilité, elle était l’amie des plus batailleurs.
Dans les troupeaux de zèbres, il y en avait un, disait-elle, qu’elle avait vu échapper à un incendie de brousse. On le reconnaissait aux traces du feu, semées entre les rayures noires comme des tâches de rousseur.
Elle avait assisté à un combat de rhinocéros, et le mâle énorme, immobile à quelques pas de nous, sa
corne dressée vers le ciel, comme un bloc de la préhistoire, avait été le vainqueur. Mais il gardait
cette longue, profonde et affreuse cicatrice que l’on découvrait soudain quand s’envolait de son dos
l’essaim tourbillonnant des blanches aigrettes qui lui servaient d’oiseaux pilotes.
Et les girafes aussi avaient leur chronique, et les grands gnous bossus, et les adultes, et les petits, génération par génération.
Jeux, luttes, migrations, amours. »
Chapitre V.
« Mais, tout seigneurs qu’ils soient, il ne faut pas qu’ils s’excitent sur mes lions.
Il est des hommes, lorsqu’on les aborde, avec lesquels les approches, les temps morts qu’exigent à l’ordinaire les règles de politesse, n’ont pas de sens, parce que ces hommes vivent en dehors de toute convention dans leur propre univers et qu’ils vous y attirent aussitôt. Je dis à Bullit :
— Vos lions, vos rhinocéros, vos éléphants… Les animaux sauvages semblent pour vous un bien personnel.
— Ils appartiennent à la Couronne, répliqua Bullit. Et je la représente ici.
— Je ne pense pas, dis-je, que ce soit chez vous seulement un effet du devoir.
Bullit reposa brusquement son verre à moitié plein et se mit à marcher à travers la pièce. Il allait à grands pas. Pourtant, son corps si vaste, haut et lourd, n’effleurait pas un meuble. Et sous ses bottes de chasse, le plancher ne faisait aucun bruit. Quand il eut parcouru plusieurs fois le salon et tout en continuant son va-et-vient silencieux, il dit :
— Après les Masaï, j’ai fait un tour de deux heures dans la brousse pour répandre du sel dans les endroits où les bêtes vont souvent. Elles ont du goût pour le sel. Ça les fortifie. Vous me direz que ce n’est pas mon seul devoir qui me pousse à leur en donner.
Bullit marchait plus vite de son grand pas juste, élastique et muet à travers la pièce encombrée.
— Et les barrages de terre que je construis, et les rigoles que je fais creuser pour qu’il y ait partout et en toute saison des abreuvoirs, ce n’est pas davantage l’obligation de mon poste. Et je vide sans pitié les visiteurs quand, avec les trompes de leurs voitures, ils empêchent les bêtes de se sentir chez elles.
Bullit arrêta brusquement la lancée de son corps avec cette facilité que je lui avais déjà vue. Il était alors près de moi et grondait :
— Les bêtes, ici, ont tous les droits. Je les veux tranquilles. À l’abri du besoin. Protégées des hommes. Heureuses. Et dans la mesure de mes forces, il en sera ainsi, vous m’entendez. »
Chapitre V.
« Auriez-vous la bonté de m’expliquer, demanda-t-il brusquement, pourquoi ce chauffeur a passé la nuit dans dans sa voiture alors qu’il avait un lit à sa disposition dans la case des serviteurs du camp ? Ce gentleman de Nairobi répugne peut-être à coucher sous le même toit que les pauvres Noirs de la brousse ?
— Il ne s’agit pas de cela, dis-je. Nous avons fait, Bogo et moi un long circuit jusqu’au lac Kivou. Les hôtels refusaient de loger les Noirs, sinon dans les chenils. Bogo s’est habitué à dormir dans la voiture. C’est un homme très simple, mais il a le sens de la dignité.
— Dignité, répéta Bullit entre ses dents. Dignité. » Son regard se posa sur la longue lanière en cuir de rhinocéros qui pendait au bras d’un fauteuil, puis revint scruter le fond de son verre.
— Je suis né en Rhodésie, dit-il soudain. Mon père y administrait un très grand district. J’avais quatorze ans quand j’ai fait mon premier safari avec un garçon de mon âge. Un jour, dans une brousse à lions, mais où la chasse était interdite, nous avons vu remuer un fourré. Défense ou pas défense, nous tirons. L’un de nous a touché. Mais c’était un Noir, tué raide. Nous sommes allés prévenir le chef du village le plus proche. Un vieux Nègre. (Bullit leva un instant les yeux sur moi.) Très digne. Il nous a dit : « Vous avez eu de la chance que ça n’ait pas été un lion. Votre père ne vous l’aurait pas pardonné. » C’était vrai. Mon père avait la loi dans le sang.
— John, pourquoi racontez-vous des histoires pareilles ! dit Sybil à mi-voix. Vous savez que je les ai en horreur. Et puis vraiment, elles peuvent vous faire prendre pour un sauvage. »
Chapitre VII.
« — Ne me croyez pas complètement fou parce que je laisse Pat courir à son gré dans la brousse et approcher les bêtes comme elle veut. D’abord elle possède le pouvoir sur elles. Ça existe ou ça n’existe pas. On peut connaître les animaux à fond, ça n’a pas de rapport. Ainsi moi, par exemple. J’ai passé toute ma vie au milieu des bêtes et, pourtant, rien à faire. Le pouvoir, c’est de naissance. Comme la petite.
Je suivais le grand corps de Bullit en tâchant de mettre mes pas juste dans les siens afin de ne pas troubler, désaccorder cette voix rauque et lente qui me ramenait au mystérieux domaine de Patricia.
— J’ai connu quelques hommes qui avaient le pouvoir, disait Bullit. Des blancs et des noirs… des noirs surtout. Mais personne autant que Pat. Elle est née avec le don. Et puis, elle a été élevée chez les bêtes. Et puis (Bullit hésita d’une manière à peine perceptible), et puis, elle ne leur a jamais fait de mal. Elle les entend et les bêtes l’entendent.
Je ne pus m’empêcher de demander :
— Cela suffit à sa sécurité ?
— Elle en est certaine, dit Bullit marchant toujours et toujours sans se retourner. Et elle doit savoir mieux que nous. Mais je n’ai pas son innocence. Je la fais garder par Kihoro.
— Le Noir mutilé ? » demandai-je.
Bullit força un peu l’allure et répondit :
— Ne vous y méprenez pas. Kihoro est estropié mais il a une démarche de léopard. Moi, Patricia entendrait tout de suite que je rôde ou guette aux alentours. Et pourtant, je connais le métier. Pour Kihoro, qui est toujours derrière son ombre, elle ne se doute de rien. Et il a beau n’avoir qu’un seul œil, il tire plus juste et plus vite que moi. Et je passe pour un des bons fusils de l’Afrique Orientale.
Bullit se retourna. Il y avait dans son regard un feu étrange et dans sa voix un accent plus jeune.
— Savez-vous que dans le temps, pour aller à n’importe quelle bête dangereuse, lion, éléphant, buffle même, Kihoro ne demandait jamais plus d’une cartouche ? Et que…
— Bullit s’interrompit net, et comme pour se punir d’une faute qui m’échappait, mordit brutalement sa lèvre inférieure.
— Pour garder la petite, soyez tranquille, dit-il, les chargeurs de Kihoro sont pleins.
— Le sentier s’élargissait. Nous fîmes en silence quelques pas côte à côte.
C’est naturellement par Kihoro, demandai-je, que vous avez appris ma rencontre avec Patricia ?
— Oui, dit Bullit. Mais surtout qu’elle ne sache pas qu’il la surveille. Tout son jeu lui serait gâché. Et son jeu est le seul bonheur qu’elle peut avoir ici. »
Chapitre VIII.
« Il y avait dans ses yeux toutes les certitudes que m’avaient tant de fois exprimées les vieux colons et leurs fils : l’excellence naturelle des races blanches, l’infériorité des peuples-enfants qui n’estiment et n’aiment que la force. Je ne partageais pas ces conceptions. Elles avaient été valables tant que les indigènes y avaient cru. Maintenant c’était fini. Quelques hommes, encore, par leur personnalité puissante, par une sorte d’instinct supérieur, semblaient les justifier. Et c’était au fond de régions isolées, perdues, que les grands courants du monde n’avaient pas atteintes. Les jours venaient, les jours étaient venus pour de nouveaux rapports entre les hommes de couleurs différentes. Mais il était vain de perdre du temps, ce temps dont il me restait si peu, à discuter avec Bullit. Il n’écouterait rien. Il avait sa vérité. »
Chapitre IX.
« — En effet, dis-je, ce n’est pas sous ce jour que l’on présente à Nairobi le grand Bull Bullit.
— Bull Bullit, hein ? » dit pesamment le maître du Parc royal.
Son menton s’écrasa davantage sur son poing. Sa figure se ferma.
— Bull Bullit, reprit-il. Je n’avais pas entendu ce surnom depuis longtemps
— Il est pourtant bien fait pour vous », dis-je.
Mon compagnon releva lentement sa large tête rouge.
— Oh ! je sais, dit-il. Et j’ai fait mon possible pour le rendre fameux… Bull Bullit le braconnier en défenses d’éléphants et cornes de rhinocéros, Bull Bullit le chasseur professionnel, le fusil à gages, l’exterminateur de gros gibier dans des provinces entières.
Je dis :
— À travers l’Afrique Orientale, c’est bien votre légende.
— C’est la vérité », dit Bullit.
Il se redressa d’un seul bloc, alla d’un seul pas jusqu’au bord de la véranda et saisit à pleines mains la balustrade. Elle vibra et gémit sous ses doigts.
— Et qu’est-ce que j’y pouvais ? » demanda Bullit.
Il s’adressait moins à moi qu’à la clairière, à l’abreuvoir et au Kilimandjaro immobile et livide sous l’immobile et livide lumière.
Il revint s’asseoir à la table et dit :
— Pour m’encourager à l’alphabet, on m’a donné une carabine. Je n’avais pas dix ans que mon père m’emmenait en safari. On m’a bercé, on m’a nourri, on m’a gavé, bon Dieu, d’histoires de chasse et de fusils célèbres. On m’a enseigné à pister les bêtes comme un indigène, à placer une balle entre les deux yeux, juste au défaut de l’épaule, droit au cœur. Et puis, quand j’ai voulu faire métier de ma carabine, mon père, tout à coup, est devenu enragé. Il a exigé, parfaitement, il a exigé de m’envoyer en Angleterre en pension.
Jusque-là. Bullit avait parlé surtout à lui-même. Dès lors, il me prit à témoin.
— Vous pouvez imaginer ça, vous ? Le dortoir, le réfectoire, les classes, les études au lieu des feux de camp, du soleil sur la brousse, des bêtes libres… Je n’avais qu’un parti à prendre et je l’ai pris. J’ai quitté la maison avec ma carabine et des cartouches pour en vivre. Et j’en ai vécu, et même bien vécu.
La voix de Bullit, à ces dernières paroles, avait pris une sourde mélancolie. Il garda le silence, avec sur le visage cette expression de songe, d’indulgence et d’incrédulité que prend un vieil homme – mais Bullit n’avait pas quarante ans – lorsqu’il revoit, comme si c’étaient celles d’un autre, les joies et les folies de sa jeunesse.
Il ne m’était pas difficile de suivre dans ses souvenirs mon rude compagnon. Son passé de coureur et d’écumeur de brousse était connu depuis la côte de l’océan Indien jusqu’aux grands lacs d’Afrique. On trouvait toujours, dans les bars de Nairobi, les hôtels de l’Ouganda, les plantations du Tanganyika et du Kivou, des hommes pour vous parler de Bull Bullit à sa grande époque. L’un disait sa force et son endurance ; un autre son incroyable opiniâtreté ; un autre son audace ; un autre encore la sûreté de son flair et de son tir. Chacun appuyait son propos au moins d’un exemple étonnant.
Hardes d’éléphants décimées pour l’ivoire destiné aux trafiquants indiens, troupeaux de buffles massacrés afin de vendre la viande boucanée aux indigènes, fauves abattus pour le prix de leur peau. Missions que le gouvernement donnait à Bullit d’exterminer les bêtes sauvages dans certaines régions qu’elles infestaient. Affûts sans nombre qui délivraient des mangeurs de bétail et d’hommes les villages hantés par la terreur des lions sorciers et des léopards magiques. Années de marches et de guets, de patience et de risques toutes mêlées à la vie animale, à la brousse infinie, aux constellations de la nuit africaine… Voilà les images, me semblait-il, qui devaient passer dans la mémoire de Bullit. J’en fus assuré quand il dit comme en rêve :
— Kihoro se souvient de tout ça.
Le son de sa propre voix le rendit au sentiment du réel et du présent. Mais seulement à demi, car il me demanda :
— Comment est-ce possible ?
Et voyant que je ne comprenais pas ce que sa question supposait, il poursuivit avec impatience :
— C’est pourtant simple. Pour bien tuer les bêtes, il faut les bien connaître. Pour les connaître, il faut les aimer, et plus on les aime et davantage on les tue. C’est même pire que cela en vérité. C’est exactement dans la mesure où on les aime qu’on éprouve le besoin et la joie de les tuer. Et alors, qu’on ait faim ou non, que cela rapporte ou que cela coûte, avec ou sans licence, en terrain permis ou défendu, que l’animal soit dangereux ou sans défense, peu importe. S’il est beau, noble ou charmant, s’il vous touche au plus profond du cœur par sa puissance ou sa grâce, alors on tue, on tue… Pourquoi ?
— Je ne sais pas, dis-je. Peut-être l’instant où vous allez l’abattre est-il le seul où vous pouvez sentir que la bête est vraiment à vous.
— Peut-être », dit Bullit en haussant les épaules. Une troupe de gazelles passa au milieu de la clairière, sur le fond du Kilimandjaro. Leurs cornes très minces et rejetées loin en arrière, presque à l’horizontale, avaient la courbure d’une aile.
Bullit les accompagna du regard et dit :
— Aujourd’hui, j’ai l’âme pleine de joie à les voir, simplement à les voir. Mais autrefois, j’aurais choisi la plus grande, la plus légère, avec la plus belle robe, et je ne l’aurais pas manquée.
— C’est votre mariage qui a tout changé ? Demandai-je.
— Non, dit Bullit. C’est arrivé avant que je ne rencontre Sybil. Et ça ne peut pas s’expliquer davantage. Un beau jour le coup part et l’animal tombe comme à l’ordinaire. Mais on se rend compte subitement que ça vous laisse indifférent. La joie du sang qui était plus forte que toutes les autres, eh bien, elle n’est plus là. (Bullit promena sa large paume sur la toison rouge qui couvrait son poitrail dénudé.) On continue par habitude jusqu’à un autre jour où l’on ne peut plus continuer. On aime les bêtes pour les voir vivre et non plus pour les faire mourir.
Bullit alla jusqu’au perron, contempla le paysage immense tout imprégné de brume de chaleur.
— Je ne suis pas le seul dans mon cas, dit-il. Les chefs des Parcs royaux sont tous d’anciens chasseurs de métier, tous des tueurs convertis. (Il eut un sourire sans gaieté.) Mais comme j’ai été plus loin qu’eux dans le massacre, je vais aussi plus loin en sens contraire. Question de nature, je pense… Et puis… »
Chapitre XI.
« Le morane s’appuya des deux mains sur la sienne. Comme il l’avait gardée contre son flanc, ce mouvement lui fit infléchir mollement le torse et le cou. Entendait-il prouver de la sorte que là où même un vieux chef masaï avait à se montrer courtois, le privilège de sa chevelure lui donnait à l’insolence droit et devoir ? Ou savait-il d’instinct que son attitude était celle qui convenait le mieux à son étonnante beauté ?
Ce jeune corps d’éphèbe et d’athlète, sur lequel une peau noire et lustrée moulait des muscles longs, fins et doux, mais d’une vigueur extrême, rien ne pouvait en faire autant valoir la moelleuse puissance et l’éclat charnel que cette nonchalante et légère torsion. Quant au visage qui semblait illuminé du dedans par des reflets d’or, avec sa bouche forte et vermeille, son nez droit et dur, ses vastes yeux tout brillants de langueur, tout brûlants de violence, et la masse enfin, d’un métal vivant et rouge qui le coiffait, il prenait, reposant sur un bras nu, noir et ployé à demi, la tendresse du sommeil et la cruauté d’un masque.
À tant de beauté et dans sa sève la plus riche, dans sa plus vive fleur, tout était permis, tout était dû. Le morane se laissait admirer, innocent, subtil et féroce comme une panthère noire qui étire au soleil ses membres de meurtre et de velours. Que pouvait-on vouloir davantage ?
— Comment s’appelle-t-il ? » fis-je demander par Bogo. »
Chapitre XIII.
« — Je suis navrée, maman, croyez-moi, dit Patricia très doucement. Tout à fait navrée. Mais King est venu très tard aujourd’hui. Et il a voulu me raccompagner à toute force. Vous l’avez entendu sans doute.
– Bien sûr, dit Bullit, on reconnaît…
Sybil l’empêcha de poursuivre.
— Assez, assez, cria-t-elle. Je ne veux plus, je ne peux plus vivre dans cette folie.
Elle se tourna vers moi et, toute secouée par un rire qui n’avait ni son ni sens, une sorte de rire blanc, elle s’écria :
— Savez-vous qui est ce King que ma fille attend jusqu’au soir et par qui elle se fait reconduire, et de qui son père reconnaît la voix ? Le savez-vous ?
Sybil reprit son souffle pour achever d’une voix stridente, hystérique :
— Un lion ! Oui, un lion ! Un fauve ! Un monstre !
Elle était arrivée à la limite d’une crise de nerfs, et dut en avoir conscience. La honte et le désespoir de se montrer dans cet état effacèrent toute autre expression sur sa figure. Elle quitta la pièce en courant. »

« El Cid, tête de lion » (1879), Rosa Bonheur.
© Rosa Bonheur / Wikicommons
Deuxième partie, chapitre I.
Extrait 1. « Je voudrais savoir pourquoi vous êtes resté », dit à mi-voix Patricia.
Ce que je m’étais refusé jusque-là d’admettre à moi-même, il me parut tout simple soudain de l’avouer.
— À cause de King, dis-je. Du lion.
Patricia approuva de la tête à plusieurs reprises, rapidement, vigoureusement, ce qui fit bouger le singe minuscule accroché à son épaule et dit :
— Ni mon père ni maman n’ont pensé à King. Mais moi je savais bien.
Je demandai :
— Nous sommes de nouveau amis ?
— Vous êtes resté pour King, le lion. C’est à lui de répondre », dit sérieusement Patricia. »
Extrait 2 « — Les Blancs n’ont pas le droit. Je ne veux pas qu’ils tuent les bêtes », dit Patricia.
Sa voix était étouffée, haletante.
— Les Noirs, c’est autre chose. C’est juste. Ils vivent avec les bêtes. Ils ressemblent aux bêtes. Ils n’ont pas plus d’armes que les bêtes. Mais les Blancs… Avec leurs gros fusils, leurs centaines de cartouches ! Et c’est pour rien. C’est pour s’amuser. Pour compter les cadavres.
La voix de la petite fille s’éleva brusquement jusqu’au cri hystérique.
— Je déteste, je maudis tous les chasseurs blancs.
Les yeux de Patricia étaient fixés sur les miens. Elle comprit le sens de mon regard. Son cri se changea en murmure effrayé.
— Non… Pas mon père. Il n’y a pas d’homme meilleur. Il ne fait que du bien aux animaux. Je ne veux pas qu’on parle de tous ceux qu’il a pu tuer.
— Mais comment le savez-vous ? Demandai-je.
— Il racontait à maman, à ses amis, quand j’étais très petite. Il pensait que je ne comprenais pas. Maintenant je ne veux pas, je ne supporte pas… Je l’aime trop. »
Chapitre II.
« Au-delà du mur végétal, il y avait un ample espace d’herbe rase. Sur le seuil de cette savane, un seul
arbre s’élevait, il n’était pas très haut, mais de son tronc noueux et trapu partaient comme les rayons
d’une roue de longues, fortes et denses branches qui formaient un parasol géant. Dans son ombre, la tête tournée de mon côté, un lion était couché sur le flanc. Un lion dans toute la force terrible de l’espèce et dans sa robe superbe. Le flot de la crinière se répandait sur le mufle, allongé contre le sol.
Et entre les pattes de devant, énormes, qui jouaient à sortir et à rentrer leurs griffes, je vis Patricia. Son dos était serré contre le poitrail du grand fauve, son cou se trouvait à portée de la gueule entrouverte. Une de ses mains fourrageait dans la monstrueuse toison.
— King, le bien nommé. King, le Roi. Telle fut ma première pensée.
Cela montre combien en cet instant, j’étais mal gardé par la raison, et même par l’instinct.
Le lion releva la tête et gronda. Il m’avait vu. Une étrange torpeur amollissait mes réflexes, mais sa queue balaya l’air immobile et vint claquer comme une lanière de fouet contre son flanc. Alors je cessai de trembler : la peur vulgaire, la peur misérable avait contracté chacun de mes muscles. J’aperçus enfin, et dans le temps d’une seule clarté intérieure, toute la vérité. Patricia était folle et m’avait donné sa folie. Je ne sais quelle grâce la protégeait peut-être, mais pour moi…
Le lion gronda plus haut, sa queue claqua plus fort. Une voix dépourvue de vibrations, de timbre, de tonalité m’ordonna :
— Pas de mouvement… Pas de crainte… Attendez.
D’une main, Patricia tira violemment sur la crinière ; de l’autre, elle se mit à gratter le mufle du fauve entre les yeux. En même temps, elle lui disait en chantonnant un peu :
— Reste tranquille, King. Tu vas rester tranquille. C’est un nouvel ami. Un ami, King, King, un ami… un ami…
Elle parla d’abord en anglais, puis elle usa de dialectes africains. Mais le mot « King » revenait sans cesse.
La queue menaçante retomba lentement sur le sol. Le grondement mourut peu à peu. Le mufle s’aplatit de nouveau contre l’herbe et, de nouveau, la crinière, un instant dressée, le recouvrit à moitié.
— Faites un pas », me dit la voix insonore.
J’obéis. Le lion demeurait immobile. Mais ses yeux, maintenant, ne me quittaient plus.
— Encore, dit la voix sans résonance.
J’avançai.
De commandement en commandement, de pas en pas, je voyais la distance diminuer d’une façon terrifiante entre le lion et ma propre chair dont il me semblait sentir le poids, le goût, le sang.
À quoi n’eus-je pas recours pour m’aider contre l’éclat jaune de ces yeux fixés sur moi ! Je me dis que les chiens les plus sauvages aiment et écoutent les enfants. Je me souvins d’un dompteur de Bohême qui était devenu mon camarade. Il mettait chaque soir sa tête entre les crocs d’un lion colossal. Et son frère, qui soignait les fauves du cirque, quand, en voyage, il avait trop froid la nuit, il allait dormir entre deux tigres. Et enfin, à portée de secours, veillait Kihoro.
Mais j’avais beau m’entêter à ces images rassurantes, elles perdaient toute valeur et tout sens à mesure que la voix clandestine m’attirait, me tirait vers le grand fauve étendu. Il m’était impossible de lui désobéir. Cette voix, je le savais en toute certitude, était ma seule chance de vie, la seule force — et si précaire, si hasardeuse — qui nous tenait, Patricia, le fauve et moi dans un équilibre enchanté.
Mais est-ce que cela pouvait durer ? Je venais de faire un pas de plus. À présent, si je tendais le bras, je touchais le lion.
Il ne gronda plus cette fois, mais sa gueule s’ouvrit comme un piège étincelant et il se dressa à demi.
— King ! cria Patricia. Stop, King !
Il me semblait entendre une voix inconnue, tellement celle-ci était chargée de volonté, imprégnée d’assurance, certaine de son pouvoir. Dans le même instant, Patricia assena de toutes ses forces un coup sur le front de la bête fauve.
Le lion tourna la tête vers la petite fille, battit des paupières et s’allongea tranquillement.
— Votre main, vite, me dit Patricia.
Je fis comme elle voulait. Ma paume se trouva posée sur le cou de King, juste au défaut de la crinière.
— Ne bougez plus, dit Patricia.
Elle caressa en silence le mufle entre les deux yeux. Puis elle m’ordonna :
— Maintenant, frottez la nuque.
Je fis comme elle disait.
— Plus vite, plus fort, commanda Patricia.
Le lion tendit un peu le mufle pour me flairer de près, bâilla, ferma les yeux. Patricia laissa retomber sa main. Je continuai à caresser rudement la peau fauve. King ne bougeait pas.
— C’est bien, vous êtes amis, dit Patricia gravement.
Mais aussitôt elle se mit à rire, et l’innocente malice que j’aimais tant la rendit à la gaieté de l’enfance.
— Vous avez eu une grande peur, pas vrai ? me demanda-t-elle.
— La peur est toujours là, dis-je.
Au son de ma voix, le grand lion ouvrit un œil jaune et le fixa sur moi.
— N’arrêtez pas de lui frotter le cou et continuez à parler, vite, me dit Patricia.
Je répétai :
— La peur est toujours là… toujours là… toujours là…
Le lion m’écouta un instant, bâilla, s’étira (je sentis sous ma main les muscles énormes et noueux onduler), croisa les pattes de devant et demeura immobile.
— Bien, dit Patricia. Maintenant il vous connaît. L’odeur, la peau, la voix… tout. Maintenant on peut s’installer et causer.
Je ralentis peu à peu le mouvement de ma main sur le cou du lion, la laissai reposer, la retirai.
— Mettez-vous ici, dit Patricia.
Elle montrait un carré d’herbes sèches, situé à un pas des griffes de King. Je pliai les genoux pouce par pouce, m’appuyai au sol et m’assis enfin aussi lentement que cela me fut possible.
Le lion fit glisser son mufle de mon côté. Ses yeux allèrent une fois, deux fois, trois fois à mes mains, à mes épaules, à mon visage. Il m’étudiait. Alors, avec une stupeur émerveillée, où, instant par instant, se dissipait ma crainte, je vis dans le regard que le grand lion du Kilimandjaro tenait fixé sur moi, je vis passer des expressions qui m’étaient lisibles, qui appartenaient à mon espèce, que je pouvais nommer une à une : la curiosité, la bonhomie, la bienveillance, la générosité du puissant.
— Tout va bien, tout va très bien…, chantonnait Patricia.
Elle ne s’adressait plus à King : sa chanson était la voix de son accord avec le monde. Un monde qui ne connaissait ni barrières ni cloisons. Et ce monde par l’intermédiaire, l’intercession de Patricia, il devenait aussi le mien. Je découvrais, avec un bonheur où le sentiment de sécurité n’avait plus de place, que j’étais comme exorcisé d’une incompréhension et d’une terreur immémoriales. Et que l’échange, la familiarité qui s’établissaient entre le grand lion et l’homme montraient qu’ils ne relevaient pas chacun d’un règne interdit à l’autre, mais qu’ils se trouvaient placés, côte à côte, sur l’échelle unique et infinie des créatures. »
Chapitre III.
« Elle me tendit une dizaine d’images. On y voyait, tantôt pelotonné entre les bras grêles d’une fillette qui semblait être une petite sœur de Patricia, tantôt sur son épaule, tantôt sur ses genoux, tantôt accroché au biberon qu’elle lui donnait, on voyait le plus touchant petit animal qui se puisse imaginer, un peu pataud, les yeux mal ouverts, la tête carrée.
— C’est vraiment King ? » demandai-je malgré moi.
Bullit fourragea dans ses cheveux qui avaient eu le temps de sécher et se dressèrent soudain en tous sens. Il dit, embarrassé par l’attendrissement qui enrouait sa voix déjà rauque :
— Même pour moi, il est difficile de croire que ce bout de bestiole…
— Je n’ai jamais rien vu d’aussi gentil, désarmé, aussi affectueux », murmura Sybil.
Seule, Patricia ne disait rien. D’ailleurs, elle ne regardait pas les photographies.
— J’aurais bien aimé le soigner alors, reprit Sybil, mais Patricia m’en a toujours empêchée. Si j’essayais de toucher le bébé-lion, elle avait des crises de colère épouvantables.
Pour un instant, le visage de Patricia, si paisible ce soir, retrouva la violence que je lui avais vue dans le cirque de brousse, sous l’arbre aux longues branches.
— King était à moi », dit-elle.
Je lui demandai très vite : « Et là, qu’est-ce qui se passe ?
— Il s’agissait d’une image où, d’un paquet de laine, émergeait la moitié d’un museau rond aux yeux clos et avec deux petites oreilles d’un dessin exquis.
— Il avait pris froid. Je l’ai mis dans mon sweater », dit Patricia.
Elle semblait sur le point de se détendre, mais comme j’allais lui poser une nouvelle question, elle dit sèchement :
— Excusez-moi, j’étais trop petite. J’ai oublié.
C’était faux. Je le savais par les confidences que Patricia m’avait faites alors qu’elle était couchée entre les pattes de King. L’enfance du lionceau, Patricia en gardait tous les détails dans sa mémoire. Mais elle ne voulait pas se souvenir des jours où il dépendait entièrement d’elle, alors que le grand fauve, en cet instant, loin de son atteinte, rôdait en pleine liberté dans la nuit africaine. »
Chapitre V.
J’ai lu ce passage à mes étudiants, en leur précisant que Kessel avait sans doute mal observé & mal réfléchi. En effet, il est impossible que de la bouse seule soit assez solide. Elle est forcément mélangée à de la boue. Voyez cet article instructif sur les maisons masaï également appelées « manyattas » (le mot est employé plus loin dans le roman).
« — Venez vite, me cria Patricia. Ils commencent.
Elle m’entraîna le long de la faible pente jusqu’au sommet de l’éminence. Le sol en était plat et avait la forme d’un ovale grossier. Sur son pourtour étaient plantées des barrières d’épineux en deux rangées, traversées par des chicanes. À l’intérieur de l’enceinte, s’étalait une masse jaunâtre, dense, gluante et d’une senteur ignoble. C’était de la bouse de vache à demi liquide.
Des hommes, des femmes et des enfants noirs trituraient, piétinaient, malaxaient, brassaient cette immonde matière afin de lui donner un peu plus de consistance. Patricia s’adressa à eux dans leur propre langue. La surprise de l’entendre chez une petite fille blanche saisit d’abord ces figures farouches. Puis même les plus fermées, les plus cruelles prirent une expression adoucie. Les femmes poussèrent des rires aigus et les enfants des cris de joie.
Je cherchai des yeux Oriounga, mais ne vis aucun des trois moranes. Le vieil Ol’Kalou cependant était là. Je le saluai. Il me reconnut et dit :
— Kouahéri.
Puis il fit signe aux siens de reprendre leur tâche.
La vague fétide se répandit plus forte, plus épaisse. Je reculai instinctivement et retins ma respiration. Mais Patricia n’était pas le moins du monde incommodée. Cette petite fille qui, la veille, avait laissé derrière elle, lorsqu’elle avait quitté ma hutte, un délicat sillage de savon et d’eau de lavande (on pouvait encore le sentir sur elle), cette petite fille à l’odorat si subtil qu’elle reconnaissait chaque effluve et chaque fragrance de brousse, était en train de humer, les yeux brillants de plaisir, l’odeur répugnante. Elle ressemblait à ces enfants nés, élevés dans un château, mais qui ont grandi avec ceux de la ferme et qui prennent plus de joie aux soins les plus rebutants des écuries et des étables qu’aux divertissements de leur condition.
— Ils sont vraiment malins, vous savez, les Masaï, dit Patricia qui voulait me faire partager son exaltation. Ils sont vraiment intelligents. Faire des maisons avec de la bouse de vache ! Vous comprenez : ils ne vivent jamais à la même place, ils n’ont pas une pelle, pas un outil, rien. Alors, ils ont inventé ça. Leur troupeau reste tout un jour, toute une nuit là où ils veulent camper. Après, ils pétrissent, ils préparent.
— Et après ? Demandai-je.
— Vous allez voir, dit Patricia. Tenez, ils commencent.
Quelques hommes dressaient autour de la mare gluante des claies couronnées par des arceaux de branchages qui, grâce à leurs épines, s’accrochaient les unes aux autres. Elles s’infléchissaient en ovale, selon le dessin du terre-plein qui dominait la petite colline. En très peu de temps une tonnelle ajourée courut le long de la plateforme. Elle était très basse (elle n’arrivait qu’à mi-corps de ceux qui la plantaient) et toute hérissée de ronces.
— Maintenant ! Maintenant ! cria Patricia. Regardez !
Le vieil Ol’Kalou avait donné un ordre. Et tous, hommes, femmes et enfants s’étaient mis, certains avec leurs paumes, certains avec des outres – qui servaient à l’ordinaire pour le lait et pour l’eau – à puiser la matière molle et tiède qu’ils avaient pétrie et à la répandre sur les branchages qu’ils avaient façonnés. Cette pâte brunâtre encore liquide et d’une pestilence affreuse coulait, s’égouttait, s’agglutinait le long des claies et devenait un mur, collait aux arceaux et formait un toit. Et les hommes, les femmes, les enfants, consolidaient ces premiers éléments aussi vite qu’il leur était possible en les arrosant, les épaississant par de nouveaux jets de bouse malaxée.
— Le soleil en quelques heures va tout durcir. N’est-ce pas merveilleux ? » dit Patricia. »
Chapitre VI.
« Un ululement suraigu retentit et un autre et un autre encore. Ils semblaient venir de tous côtés en même temps et emplir tout l’espace de leur stridence. Un troupeau de buffles qui broutait au fond de la plaine s’ébranla, terrifié, et se dispersa en tous sens. Derrière l’un d’eux venait Kihoro. Par ses clameurs sauvages, il le dirigeait vers notre abri. Le buffle passa le long du fourré, grondant, naseaux écumeux et martelant le sol de ses sabots. Patricia alors ôta sa main de la crinière de King et fit entendre ce hissement dont je me souvenais si bien et qui avait failli jeter le grand lion contre moi. King, d’une seule détente, s’envola par-dessus le fourré. Et soudain j’eus devant les yeux l’image même que j’avais vue dans un des livres où j’avais appris à lire et qui avait hanté toute mon enfance : un buffle lancé dans un galop frénétique, avec, pour cavalier, un lion dont les crocs labouraient sa nuque bossue.
Le couple fabuleux avait disparu dans les fourrés et la poussière. Kihoro nous avait rejoints. Mais Patricia tenait encore son regard fixé du côté où le buffle avait emporté King accroché à ses flancs. Aucun des traits de Patricia ne rappelait ceux de son père. Mais combien ils se ressemblaient tous deux en cet instant ! Ou plutôt, comme je retrouvais sur le visage tendre et lisse de la petite fille l’expression même qu’avait Bullit quand il revivait avec souffrance et passion le temps où il tuait sans merci ni répit !
Patricia mit soudain une oreille contre le sol, écouta…
— Fini, » dit-elle en se relevant.
Je vis en pensée la chute du buffle vidé de son sang.
— Vous qui aimez tant les bêtes, dis-je à Patricia, vous n’avez pas de peine pour celle-là ?
— La petite fille me considéra avec étonnement et répondit :
— Il faut bien que les lions mangent pour vivre.
Je me souvins des petits guépards qui se nourrissaient à la carcasse du zèbre.
— C’est vrai, dis-je. Et King doit avoir une famille.
Patricia devint d’un seul coup toute blanche et toute raide. Sa bouche prit une inflexion pitoyable. Je crus qu’elle allait gémir. Mais elle se contint et fixa sur moi un regard où je ne pus rien déchiffrer.
— Pourquoi pas ? » dit-elle. »
Chapitre VIII.
Extrait 1. « Bullit arrêta la voiture face aux éléphants serrés en une seule masse de nuques, d’épaules et d’échines colossales, leurs trompes convulsées comme des serpents furieux. Et ce fut seulement à la seconde même où de toutes ces trompes jaillit la même stridence enragée et où la phalange formidable se mit en branle que Bullit fit pivoter la Land Rover et la lança à toute vitesse sur une bonne piste qu’une chance merveilleuse me sembla ouvrir soudain parmi les buissons, mais que lui, à coup sûr, avait depuis longtemps repérée, et aménagée.
J’ignore quelle expression pouvait avoir mon visage après cette aventure mais, le considérant, Bullit et Patricia échangèrent un regard de connivence. Puis Bullit se pencha vers la petite fille et lui parla à l’oreille. Patricia approuva vivement de la tête tandis que ses yeux étincelaient de malice. »
Extrait 2. « Regardez notre ami ! cria Patricia. C’est le plus méchant, le plus courageux ! Il va charger.
Sa voix retentissait encore que la bête fonça.
La stupeur m’interdit tout autre sentiment. Je n’aurais jamais cru qu’une telle masse et portée par des pattes si courtes et difformes fût capable de cette détente subite et de cette vélocité. Mais Bullit était sur ses gardes. Il donna le coup d’accélérateur et le coup de volant qu’il fallait. Pourtant, la bête lancée comme par une catapulte manqua de si près notre voiture découverte que j’entendis son chuintement furieux. Eus-je peur alors ? Comment le saurais-je ? Tout était si rapide et mouvant et saccadé. Les deux autres rhinocéros chargèrent à leur tour. Entre ces fronts baissés de monstres, la Land Rover virait sur une aile, reculait, tournoyait, bondissait. Une défaillance du moteur, une fausse manœuvre et nous étions transpercés, éventrés, empalés par les cornes tranchantes. Mais Bullit menait le jeu avec tant d’assurance ! Les rangers hurlaient avec tant d’allégresse ! Et Patricia riait si bien, de ce rire merveilleux, cristallin, qui, dans les cirques, monte des travées d’enfants comme un carillon de joie…
Les bêtes se fatiguèrent plus vite que la machine. L’un après l’autre, les rhinocéros abandonnèrent l’attaque. Ils se massèrent en un seul bloc, les flancs soulevés par des halètements colossaux sur leurs énormes pattes qui tremblaient, mais les cornes toujours dardées vers nous.
— À bientôt, les copains ! » cria Bullit. »
Chapitre IX.
Extrait 1. « Il ouvrit lentement la portière, posa lentement ses pieds sur le sol, alla lentement à King. Il se planta devant lui et dit, en détachant les mots :
— Alors, garçon, tu veux voir qui est le plus fort ? Comme dans le bon temps ? C’est bien ça ?
Et King avait les yeux fixés sur ceux de Bullit et comme il avait le gauche un peu plus rétréci et fendu que le droit, il semblait en cligner. Et il scandait d’un grondement très léger chaque phrase de Bullit. King comprenait.
— Allons, tiens-toi bien, mon garçon », cria soudain Bullit.
Il fonça sur King. Le lion se dressa de toute sa hauteur sur ses pattes arrière et avec ses pattes avant enlaça le cou de Bullit. Cette fois, il ne s’agissait pas d’une caresse. Le lion pesait sur l’homme pour le renverser. Et l’homme faisait le même effort afin de jeter bas le lion. Sous la fourrure et la peau de King, on voyait la force onduler en longs mouvements fauves. Sous les bras nus de Bullit, sur son cou dégagé saillaient des muscles et des tendons d’athlète. Pesée contre pesée, balancement contre balancement, ni Bullit ni King ne cédaient d’un pouce. Assurément, si le lion avait voulu employer toute sa puissance ou si un accès de fureur avait soudain armé ses reins et son poitrail de leur véritable pouvoir, Bullit, malgré ses étonnantes ressources physiques, eût été incapable d’y résister un instant. Mais King savait – et d’une intelligence égale à celle de Bullit – qu’il s’agissait d’un jeu. Et de même que Bullit, quelques instants plus tôt avait poussé sa voiture à la limite seulement où King pouvait la suivre, de même le grand lion usait de ses moyens terribles juste dans la mesure où ils lui permettaient d’équilibrer les efforts de Bullit.
Alors, Bullit changea de méthode. Il enveloppa de sa jambe droite une des pattes de King et la tira en criant :
— Et de cette prise-là. qu’est-ce que tu dis, mon fils ?
L’homme et le lion roulèrent ensemble. Il y eut entre eux une mêlée confuse et toute sonore de rires et de grondements. Et l’homme se retrouva étendu, les épaules à terre, sous le poitrail du lion. Maintenant Bullit reprenait souffle et King attendait, et son œil le plus étroit, le plus étiré semblait le moquer doucement. Soudain, d’une seule torsion, Bullit se plaqua face au sol, ramena les genoux sous son ventre, prit appui sur les deux paumes, arqua le dos et, secousse par secousse, il souleva dans un effort herculéen le grand lion du Kilimandjaro qui, les pattes ballantes, se laissait faire.
— Hourra, père ! Hourra pour vous ! » criait Patricia. »
Extrait 2. La petite fille porta à ses lèvres une main pliée en forme de cornet et poussa cette modulation singulière par laquelle j’avais entendu Kihoro appeler King.
À l’intérieur du triangle, deux rugissements brefs éclatèrent et les deux lionnes sortirent des buissons, le poil hérissé, les crocs avides. La distance qui les séparait de Patricia, elles pouvaient, elles allaient la franchir d’un saut. Que faisait Kihoro ? Qu’attendait-il ?
Mais un autre rugissement retentit si puissant qu’il couvrit tous les sons de la savane et un bond prodigieux enleva King par-dessus les fourrés et le porta là où il l’avait voulu : juste entre ses femelles enragées et Patricia.
La plus grande, la plus belle des lionnes et la plus hardie fit un saut de côté pour contourner le flanc de King. Il se jeta sur elle et la renversa d’un coup d’épaule. Elle se releva d’un élan et revint à la charge. King lui barra encore le chemin et, cette fois, sa patte, toutes griffes dehors, s’abattit sur la nuque de la grande lionne, lacéra la peau et la chair. Le sang jaillit sur le pelage fauve. La bête blessée hurla de douleur et d’humiliation, recula. King, grondant, la poussa davantage et, pas à pas, la força de regagner l’abri des buissons où l’autre lionne était déjà terrée.
La modulation d’appel s’éleva de nouveau dans l’air brûlant de la savane. King s’approcha de Patricia qui n’avait pas bougé.
Elle frissonnait légèrement. Je le vis quand elle leva une main et la posa contre le mufle de King, entre les yeux d’or. Le tremblement cessa. Les ongles de la petite fille remuèrent doucement sur la peau du lion. Alors King se coucha et Patricia s’étendit au creux de son ventre, embrassée par ses pattes. Elle passa un doigt sur celle qui portait des traces toutes fraîches de sang. Et son regard défiait la haie d’épineux derrière laquelle gémissaient sourdement les femelles de King, maîtrisées, honteuses et battues.
Ensuite, même ces plaintes rauques se turent. Les lionnes s’étaient résignées. Le silence écrasant de midi régna d’une seul coup sur la savane. »
L’innocente Patricia, si elle est désexualisée, disons « délolitaisée », rappelle quand même, hissée sur son lion et dominant la nature sauvage, sinon la figure de la sorcière chevauchant un bouc, celle de Cybèle hissée sur son ou ses lions, comme le montre cette sculpture du musée du Louvre. Selon Wikipédia, la déesse-mère d’origine phrygienne est « abandonnée à sa naissance et recueillie par un léopard ou un lion ». […] « Principalement associée à la fertilité, elle incarnait aussi la nature sauvage, symbolisée par les lions qui l’accompagnent ». Dans l’extrait suivant, le mot « sorcière » est utilisé…
Chapitre X.
« Et puis, je faillis crier d’épouvante : sur les pas de la petite fille, une forme sombre et mince se déplaçait rapidement au ras des herbes, précédée par une tête triangulaire et plate qui brillait au soleil. Est-ce que les charmes de Patricia s’étendaient aux reptiles ? Et Kihoro – fût-il le meilleur tireur du monde – pouvait-il toucher cette cible ondoyante, furtive ? J’étais prêt à céder à la panique, à héler le trappeur borgne, à courir vers Patricia… que sais-je. Mais la petite fille s’arrêta auprès d’une gazelle et la forme noire se redressa lentement. Elle devint alors un corps d’homme, nu et beau, muni d’une lance et couronné d’une chevelure profilée comme un casque et qui avait la couleur de l’argile.
Je criai :
— Patricia, prenez garde ! Oriounga !
Est-ce que la voix m’avait manqué ? Est-ce que le vent était contraire ? Mon avertissement n’atteignit pas la petite fille. Il ne réussit qu’à effaroucher une bande d’antilopes, à faire galoper quelques zèbres qui passaient près de moi. Et déjà il était trop tard. Le morane avait rejoint Patricia.
Je retins ma respiration. Mais il n’arriva rien. Simplement Oriounga et la petite fille continuèrent leur chemin ensemble. Oriounga, aussi, était habitué aux bêtes sauvages et peut-être possédait-il également les maîtres mots.
Le soleil était beaucoup plus haut et plus chaud dans le ciel quand Patricia revint, seule. Elle me demanda en riant :
— Vous avez vu le morane ?
— Oui (et ma gorge était sèche). Eh bien ?
— Il a passé la nuit aux environs de notre bungalow, dans le bois, à guetter que je sorte, dit Patricia.
— Pourquoi ?
— Pour être sûr de me suivre et de me parler, dit Patricia.
— Qu’est-ce qu’il voulait ?
— Savoir si je suis la fille du grand lion ou bien une sorcière, dit Patricia qui riait de nouveau.
— Et vous lui avez répondu ?
— Qu’il devine », dit Patricia.
Elle me considéra en clignant de l’œil et dit :
— Vous le saviez, vous, qu’il se cachait hier, près de la maison de King, et qu’il a vu toute l’histoire avec les lionnes ?
— C’est vrai, dis-je.
— Pourquoi ne m’avez-vous pas prévenue ? » demanda la petite fille.
Je ne répondis pas. Patricia cligna de l’autre œil.
— Oh ! je le sais, dit-elle. Vous avez peur de lui pour moi. Mais vous avez tort. Il ne peut rien. Je suis une femme blanche. »
Chapitre XII.
« En effet, ce n’était pas d’une bête crevée qu’émanait la puanteur, mais d’un homme à l’agonie. Et l’homme était le vieil Ol’Kalou.
Il ne pouvait plus reconnaître personne. La gangrène dont l’horrible parfum flottait sur la brousse achevait son ouvrage. Mais il vivait encore. Des frissons secouaient ses membres décharnés et faisaient pour un instant lever l’essaim de mouches collé à sa plaie en putrescence. Sa gorge émettait les chuintements réguliers du râle.
— Qu’est-ce que cela veut dire ? m’écriai-je. Tout le monde assure qu’il est mort.
— Mais il est mort puisqu’il ne peut plus vivre, dit Patricia.
Il n’y avait pas trace d’émotion dans sa voix et ses grands yeux fixés sur Ol’Kalou étaient paisibles.
— Mais les siens auraient pu le soigner, dis-je, ou le garder tout au moins jusqu’à la fin.
— Pas les Masaï , dit Patricia.
Elle eut une fois de plus, sur le visage, cette expression de condescendance qui lui venait quand elle avait à m’enseigner des notions dont elle pensait qu’elles étaient les plus naturelles et les plus évidentes.
— Quand il meurt un homme ou une femme dans la manyatta, son esprit y reste, et il est très méchant pour tout le clan, dit Patricia. Et il faut tout de suite brûler la manyatta et s’en aller. Alors, pour éviter tant d’ennuis, la personne qui va mourir, on la jette dans un buisson. Comme ce vieux.
— La voix de la petite fille était sans pitié ni crainte. Où et comment Patricia aurait-elle eu l’occasion et le temps d’apprendre le sens de la mort ?
— Bientôt, il ne sentira même plus mauvais, reprit Patricia. Les vautours et les chiens de brousse vont venir. »
Chapitre XIII.
« Bullit interrogea des yeux Waïnana, debout à ses côtés. Le nouveau chef du clan répéta en swahili les paroles du morane. Il parlait avec lenteur et application. Sybil comprit ce qu’il disait.
— John ! s’écria-t-elle. Il demande Patricia pour femme.
Bullit se releva sans hâte. Il enveloppa d’un bras les épaules de Sybil et lui dit très doucement :
— Ne vous effrayez pas, chérie. Ce n’est pas une insulte. Au contraire, c’est un honneur. Oriounga est leur plus beau morane.
— Et qu’est-ce que vous allez répondre ? demanda Sybil dont les lèvres blanchies remuaient difficilement.
— Qu’il n’est pas encore un homme et que nous verrons plus tard. Et comme ils quittent le Parc à la fin de cette semaine…
Il se tourna vers Waïnana, lui parla en swahili et Waïnana transmit le message à Oriounga.
Sybil grelottait, maintenant, malgré la chaleur accablante. Elle dit à Patricia d’une voix inégale et proche de l’hystérie :
— Lève-toi, voyons. Ne reste pas à genoux devant un sauvage.
Patricia obéit. Ses traits étaient paisibles mais ses yeux aux aguets. Elle attendait encore quelque chose.
Oriounga fixa sur elle un regard insensé, arracha de son front la crinière léonine, l’éleva très haut sur la pointe de sa lance et jeta vers le ciel une sorte d’invocation frénétique. Puis son cou s’affaissa, resurgit, ondula, vertèbre par vertèbre et, les membres désossés, le bassin comme rompu, les jointures disloquées, il reprit sa ronde. Les autres guerriers le suivirent, brisant leur corps à la même cadence. Contre leurs flancs, les petites filles aux lèvres écumantes et aux yeux perdus menaient la même danse, la même convulsion.
Patricia eut un mouvement vers leur file. Les deux mains de Sybil s’agrippèrent à elle.
— Allons-nous-en, John, tout de suite ! cria la jeune femme. Je vais être malade. »
Chapitre XIV.
Extrait 1. « — Tire , criait Bullit désarmé à Kihoro qui tenait à pleines mains les deux canons de son fusil.
— Je ne peux pas, disait Kihoro. Le Masaï est caché par le lion.
Car il ne pouvait pas venir à la pensée du vieil homme borgne qui avait servi de nourrice et de garde à Patricia depuis qu’elle avait vu le jour, au pisteur infaillible qui lui avait apporté King encore vagissant et aveugle, au descendant des Wakamba qui haïssait le morane et pour sa race et pour sa personne, non, il ne pouvait pas lui venir à la pensée, en toute justice, en toute vérité, que Bullit lui désignât une autre cible qu’Oriounga.
Bullit, alors, arracha le fusil des mains de Kihoro. Et toute son attitude montrait qu’il ignorait encore quel serait son plus prochain mouvement. Et puis il vit l’homme sous le fauve. Et, bien que cet homme fût un noir, c’est-à-dire une peau abjecte sur une chair sans valeur et que ce noir eût lui-même voulu et poursuivi sa perte, Bullit fut saisi, et au fond de sa moelle par la solidarité instinctive, originelle, imprescriptible, venue du fond des temps. Dans l’affrontement de la bête et de l’homme, c’est pour l’homme qu’il avait à prendre parti.
Et Bullit se rappela dans le même instant, et sans même le savoir, le contrat qu’il avait passé avec la loi et avec lui-même lorsqu’il avait accepté d’être le maître et le gardien de cette brousse consacrée. Il devait protéger les animaux en toutes circonstances, excepté celle où un animal menaçait la vie d’un homme. Alors, il n’y avait plus de choix. Il l’avait dit lui-même : à la bête la plus noble, son devoir était de préférer l’homme le plus vil. »


 3 week_ago
50
3 week_ago
50















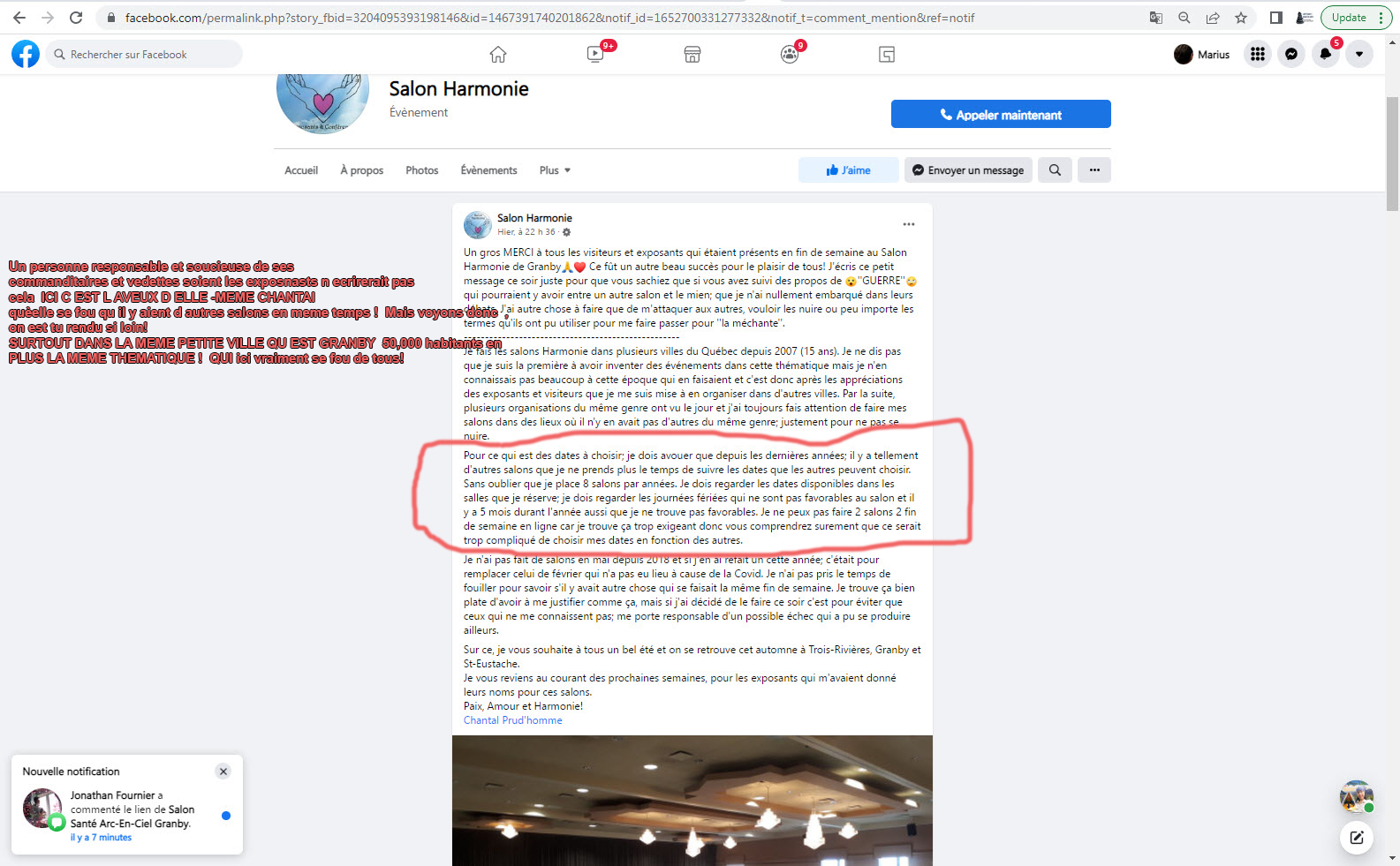

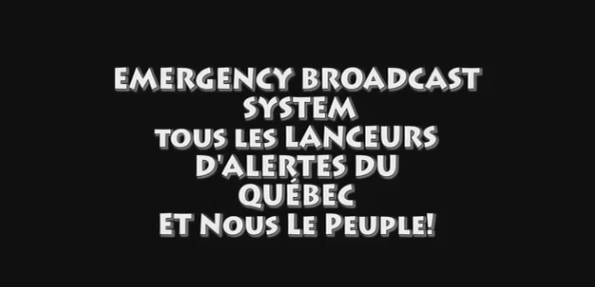
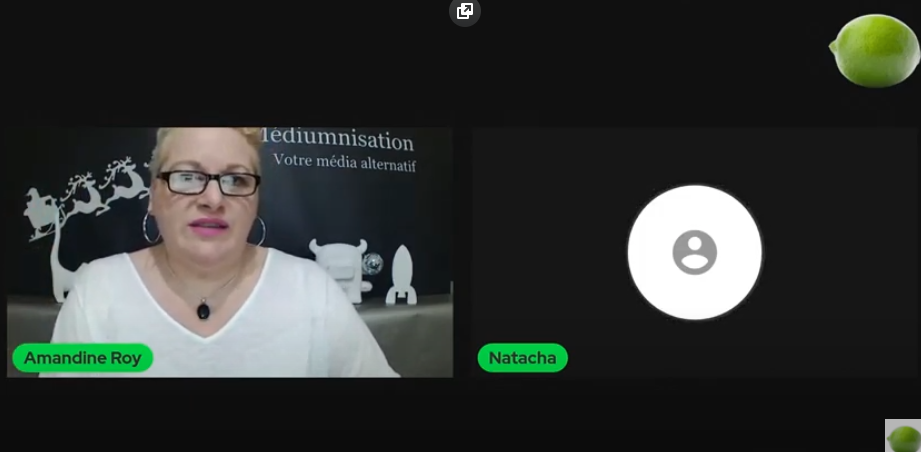






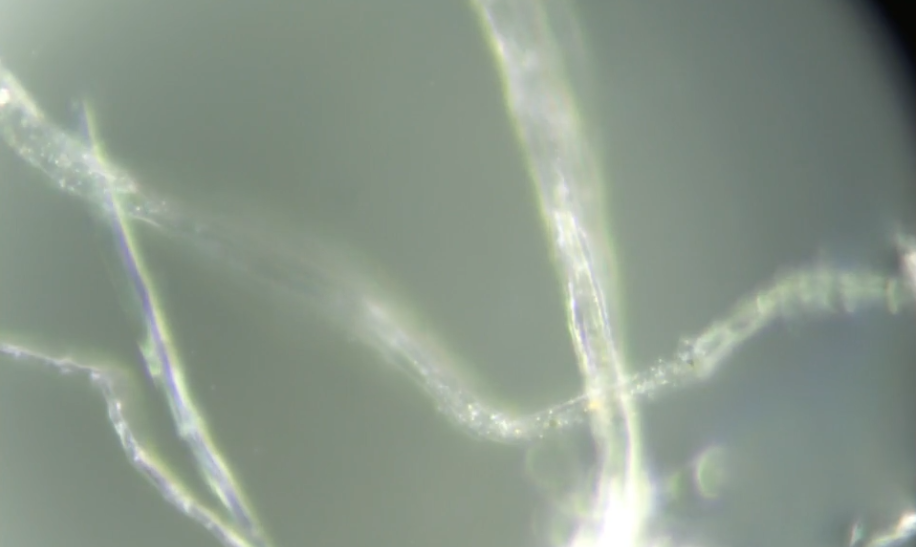

 French (CA)
French (CA)