NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
Ce livre est au programme du thème de Culture générale et expression en BTS 2025-2026 : « Les animaux et nous : imaginer, connaître, comprendre l’animal ». Je l’avais déjà lu une première fois dans mon enfance, sans doute en collection édulcorée, mais j’avais quasiment oublié que je l’avais relu et considérablement annoté dans les années 90, sur un exemplaire de l’édition Presses Pocket (1990) demeuré sur mes étagères. Impossible de retrouver dans mes archives pour quelles classes j’avais fait cette lecture très active, qui n’a laissé aucune trace sur mon ordi, mais j’avais annoté des exemples nombreux de style indirect libre, très pratique pour plonger le lecteur dans la psyché du loup. Dans ma mémoire, c’est surtout en classe de 4e que je voyais ça, à l’époque où l’on enseignait encore le français. Après avoir lu ou relu trois livres de la liste du BO, c’est finalement celui-ci qui m’a paru le plus abordable pour mon public. Il n’y a rien de daté dans l’écriture qui puisse les rebuter ; on est dans le loup et on observe des hommes, Indiens ou trappeurs, qui sont tellement décalés par rapport aux types d’hommes qui peuplent actuellement les villes de notre pays, que rien ne peut paraître démodé. C’est juste une autre humanité. Le livre est fort bien traduit par Philippe Sabathe, avec une préface et des commentaires de Maurice Mourier. Je me contenterai de citer de larges extraits utilisables en classe de BTS. Je n’ai rien lu d’autre de cet auteur fascinant, dont la vie est atypique parmi les auteurs académiques. À l’instar de Herman Melville ou Joseph Conrad, il est issu d’une famille laborieuse, et connaît une vie d’aventures dont il témoigne dans ses livres, d’où l’absence de blabla. Pour les extraits j’utiliserai non pas la traduction Sabathe, mais celle disponible sur Wikisource, signée Louis Postif & Paul Gruyer, de 1923, qui est extrêmement différente, peut-être traduite d’une édition jeunesse raccourcie, car il manque de nombreux passages. Les étudiants anglophones pourront tenter la VO. Le titre original est « White Fang », « fang » signifiant « croc ».
Préface de Maurice Mourier
Maurice Mourier explique la structure étonnante du livre, avec sa première partie consacrée à des trappeurs traqués par des loups. Pour lui, cela inverse le principe des « grandes comparaisons homériques » : « En somme, tout se passe dans ce livre comme si London, au rebours d’Homère et de la plupart de ceux qui l’ont suivi, bâtissait sa comparaison de la manière suivante : « De même que seul l’homme calme et avisé, fortifié par des années d’un combat douteux contre la sauvagerie, implacable des êtres et des choses, peut survivre dans le Grand Nord, ainsi, le noble quart-de-chien, Croc-Blanc devra franchir toutes sortes d’étapes initiatiques, et lutter pour son salut dans toutes sortes d’épreuves, avant d’acquérir sur le tard, sagesse et bonheur… » On l’aura compris, le preux chevalier, dans ce roman d’apprentissage nordique, n’a littéralement pas figure humaine. C’est un incertain mélange, instable et explosif, de chien et de loup, dont le sort, à l’égal de celui de Perceval, le jeune « valet » niais et aventureux du roman en vers de Chrétien de Troyes, passionne le lecteur, au moins pour deux raisons, l’une évidente, l’autre cachée : son animalité, et son métissage » (p. 9).
Première partie : The Wild
Attention : l’édition Wikisource de 1923 ne reprend pas la division du livre en 5 grandes parties, qui figure dans la version originale, laquelle présente des titres à chacune de ces parties, que la traduction Sabathe ne reprend pas. Je vais donc les reprendre, pour faciliter la compréhension, en les citant en anglais.
Chapitre I, La piste de la viande
« Devant les chiens, sur de larges raquettes, peinait un homme et, derrière le traîneau, un autre homme. Dans la boîte qui était sur le traîneau, en gisait un troisième, dont le souci était fini. Celui-là, le Wild l’avait abattu, et si bien qu’il ne connaîtrait jamais plus le mouvement et la lutte. Le mouvement répugne au Wild et la vie lui est une offense. Il congèle l’eau, pour l’empêcher de courir à la mer ; il glace la sève sous l’écorce puissante des arbres, jusqu’à ce qu’ils en meurent, et plus férocement encore, plus implacablement, il s’acharne sur l’homme, pour le soumettre à lui et l’écraser. Car l’homme est le plus agité de tous les êtres, jamais en repos et jamais las, et le Wild hait le mouvement. »
Chapitre II, La louve

Chapitre III, Le cri de la faim
« Mais le chien, au lieu de lui obéir, fit un bond en avant et se sauva, en courant de toutes ses forces, ses harnais traînant derrière lui.
Tout là-bas, sur la piste, la louve l’attendait. En s’approchant d’elle, il parut soudain hésiter et ralentit sa course. Il la regardait fixement, avec crainte et désir à la fois. Elle semblait l’aguicher et lui sourire de toutes ses dents, puis fit un pas vers lui, en manière d’avance. N’a-qu’une-Oreille se rapprocha, mais en se tenant encore sur ses gardes, la tête dressée, les oreilles et la queue droites.
Quand il l’eut jointe, il essaya de frotter son nez contre le sien ; mais elle se détourna, avec froideur, et fit un pas en arrière. Elle répéta plusieurs fois sa manœuvre, comme pour l’entraîner loin de ses compagnons humains. À un moment (on eût dit qu’une vague conscience du sort qui l’attendait flottait dans sa cervelle de chien), N’a-qu’une-Oreille, s’étant retourné, regarda derrière lui ses deux camarades de trait, le traîneau renversé et les deux hommes qui l’appelaient. Mais la louve lui ayant tendu son nez, pour qu’il s’y frottât, il en oublia aussitôt toute autre idée et se reprit à la suivre au bout de quelques minutes, dans un prude et nouveau recul qu’elle effectua. » […]
« Puis, comme machinalement, ses yeux retombaient sur lui-même, et il examinait son corps avec une attention bizarre, qui ne lui était pas habituelle. Il tâtait ses muscles et les faisait jouer, s’intéressant prodigieusement à leur mécanisme. À la lueur du foyer, il ouvrait, étendait ou refermait les phalanges de ses doigts, émerveillé de l’obéissance et de la souplesse de sa main qui, avec brusquerie ou douceur, trépidait à sa volonté, jusqu’au bout des ongles. Et, comme fasciné, il se prenait d’un incommensurable amour pour ce corps admirable, auquel il n’avait, jusque-là, jamais prêté attention, d’une tendresse infinie pour cette chair vivante, destinée bientôt à repaître des brutes, à être mise en lambeaux. Qu’était-il désormais ? Un simple mets pour des crocs affamés, une subsistance pour d’autres estomacs, l’égal des élans et des lapins dont il avait tant de fois, lui-même, fait son dîner. »
Deuxième partie : Born of the Wild
Chapitre I, La bataille des crocs
« Les loups couvrirent dans cette journée un grand nombre de milles, sans briser, dans ces incidents, leur formation serrée. À l’arrière, boitaient les plus faibles, les très jeunes comme les très vieux. Les plus robustes marchaient en tête. Tous, tant qu’ils étaient, ils ressemblaient à une armée de squelettes. Mais leurs muscles d’acier paraissaient une source inépuisable d’énergie. Mouvements et contractions se succédaient, sans répit, sans fin que l’on pût prévoir, et sans effort apparent ni fatigue. La nuit et le jour qui suivirent, ils continuèrent leur course. Ils couraient à travers la vaste solitude de ce monde désert, où ils vivaient seuls, cherchant une autre vie à dévorer, pour perpétuer la leur.
Ils traversèrent des plaines basses et franchirent une douzaine de petites rivières glacées, avant de trouver ce qu’ils quêtaient. Ils tombèrent enfin sur des élans. Ce fut un gros mâle qu’ils rencontrèrent d’abord. Voilà, à la bonne heure ! de la viande et de la vie, que ne défendaient point des feux mystérieux et des flammes volant en l’air. Larges sabots et andouillers palmés, ils connaissaient cela. Jetant au vent toute patience et leur prudence coutumière, ils engagèrent aussitôt le combat. Celui-ci fut bref et féroce. Le grand élan fut assailli de tous côtés. Vainement, les roulant dans la neige, il assénait aux loups des coups adroits de ses sabots, ou les frappait de ses vastes cornes, en s’efforçant de leur fendre le crâne ou de leur ouvrir le ventre. La lutte était pour lui sans issue. Il tomba sur le sol, la louve pendue à sa gorge, et sous une nuée de crocs, accrochés partout où son corps pouvait livrer prise, il fut dévoré vif, tout en combattant et avant d’avoir achevé sa dernière riposte. » […]
« Le loup de trois ans, c’était sa première affaire d’amour, perdit la vie dans l’aventure. Les deux vainqueurs, quand il fut mort, regardèrent la louve qui, sans bouger, souriait dans la neige. Mais le vieux loup borgne était le plus roué des deux survivants. Il avait beaucoup appris. Le grand loup gris, détournant la tête, était occupé justement à lécher une blessure qui saignait à son épaule. Son cou se courbait, pour cette opération, et la courbe en était tournée vers le vieux loup. De son œil unique, celui-ci saisit l’opportunité du moment. S’étant baissé pour prendre son élan, il sauta sur la gorge qui s’offrait à ses crocs et referma sur elle sa mâchoire. La déchirure fut large et profonde, et les dents crevèrent au passage la grosse artère. Le grand loup gris eut un grondement terrible et s’élança sur son ennemi, qui s’était rapidement reculé. Mais déjà la vie fuyait hors de lui, son grondement s’étouffait et n’était plus qu’une toux épaisse. Ruisselant de sang et toussant, il combattit encore quelques instants. Puis ses pattes chancelèrent, ses yeux s’assombrirent à la lumière et ses sursauts devinrent de plus en plus courts.
La louve, pendant ce temps, toujours assise sur son derrière, continuait à sourire. Elle était heureuse. Car ceci n’était rien d’autre que la bataille des sexes, la lutte naturelle pour l’amour, la tragédie du Wild, qui n’était tragique que pour ceux qui mouraient. Elle était, pour les survivants, aboutissement et réalisation.
Lorsque le grand loup gris ne bougea plus, le vieux borgne, Un-Œil (ainsi l’appellerons-nous désormais), alla vers la louve. Il y avait, dans son allure, de la fierté de sa victoire et de la prudence. Il était prêt à une rebuffade, si elle venait, et ce lui fut une agréable surprise de voir que les dents de la louve ne grinçaient pas vers lui avec colère. Son accueil, pour la première fois, lui fut gracieux. Elle frotta son nez contre le sien et condescendit même à sauter, gambader et jouer en sa compagnie, avec des manières enfantines. Et lui, tout vieux et tout sage qu’il fût, comme elle il fit l’enfant et se livra à maintes folies, pires que les siennes » […]
« Le sentier où il courait était étroit et bordé, de chaque côté, par des taillis de jeunes sapins. Il rattrapa la petite tache blanche et bond par bond l’atteignit. Il était déjà dessus. Un bond de plus, et ses dents s’y enfonçaient. Mais, à cet instant précis, la petite tache blanche s’éleva en l’air, droit au-dessus de sa tête, et il reconnut un lapin-de-neige qui, pendu dans le vide, à un jeune sapin, bondissait, sautait, cabriolait en une danse fantastique.
Un-Œil, à ce spectacle eut un recul effrayé. Puis il s’aplatit sur la neige, en grondant des menaces à l’adresse de cet objet, dangereux peut-être et inexplicable. Mais la louve, étant arrivée, passa avec dédain devant le vieux loup. S’étant, ensuite, tenue tranquille un moment, elle s’élança vers le lapin qui dansait toujours en l’air. Elle sauta haut, mais pas assez pour atteindre la proie convoitée, et ses dents claquèrent les unes contre les autres, avec un bruit métallique. Elle sauta, une seconde fois, puis une troisième.
Un-Œil, s’étant relevé, l’observait. Irrité de ces insuccès, lui-même il bondit dans un puissant élan. Ses dents se refermèrent sur le lapin et il l’attira à terre avec lui. Mais, chose curieuse ! le sapin n’avait point lâché le lapin. Il s’était, à sa suite, courbé vers le sol et semblait menacer le vieux loup. Un-Œil desserra ses mâchoires et, abandonnant sa prise, sauta en arrière, afin de se garer de l’étrange péril. Ses lèvres découvrirent ses crocs, son gosier se gonfla pour une invective, et chaque poil de son corps se hérissa, de rage et d’effroi. Simultanément, le jeune sapin s’était redressé et le lapin, à nouveau envolé, recommença à danser dans le vide.
La louve se fâcha et, en manière de reproche, enfonça ses crocs dans l’épaule du vieux loup. Celui-ci, de plus en plus épouvanté de l’engin inconnu, se rebiffa et recula plus encore, après avoir égratigné le nez de la louve. Alors indignée de l’offense, elle se jeta sur son compagnon qui, en hâte, essaya de l’apaiser et de se faire pardonner sa faute. Elle ne voulut rien entendre et continua vertement à le corriger, jusqu’à ce que, renonçant à l’attendrir, il détournât la tête et, en signe de soumission, offrît de lui-même son épaule à ses morsures.
Le lapin, durant ce temps, continuait à danser en l’air, au-dessus d’eux.
La louve s’assit dans la neige et le vieux loup qui, maintenant, avait encore plus peur de sa compagne que du sapin mystérieux, se remit à sauter vers le lapin. L’ayant ressaisi dans sa gueule, il vit l’arbre se courber, comme précédemment, vers la terre. Mais, en dépit de son effroi, il tint bon et ses dents ne lâchèrent point le lapin. Le sapin ne lui fit aucun mal. Il voyait seulement, lorsqu’il remuait, l’arbre remuer aussi et osciller sur sa tête. Dès qu’il demeurait immobile, le sapin, à son tour, ne bougeait plus. Et il en conclut qu’il était plus prudent de se tenir tranquille. Le sang chaud du lapin, cependant lui coulait dans la gueule et il le trouvait savoureux.
Ce fut la louve qui vint le tirer de ses perplexités. Elle prit le lapin entre ses mâchoires, et, sans s’effarer du sapin qui oscillait et se balançait au-dessus d’elle, elle arracha sa tête à l’animal aux longues oreilles. Le sapin reprit, à l’instar d’un ressort qui se détend, sa position naturelle et verticale, où il s’immobilisa, et le corps du lapin resta sur le sol. Un-Œil et la louve dévorèrent alors, à loisir, le gibier que l’arbre mystérieux avait capturé pour eux.
Tout alentour étaient d’autres sentiers et chemins, où des lapins pendaient en l’air. Le couple les inspecta tous. La louve acheva d’apprendre à son compagnon ce qu’étaient les pièges des hommes et la meilleure méthode à employer pour s’approprier ce qui s’y était pris. »
Chapitre II, La tanière
« Il s’arrêta à l’orée du couloir d’entrée de la tanière, surpris d’entendre venir jusqu’à lui des sons faibles et singuliers, qui certainement n’étaient pas émis par la louve. Ils lui semblaient suspects, quoiqu’il ne pût dire qu’ils lui étaient totalement inconnus.
Il avança, en rampant sur le ventre, avec précaution. Mais, comme il débouchait dans la caverne, la louve lui signifia, par un énergique grognement, d’avoir à se tenir à distance. Il obéit, intéressé au suprême degré par les petits cris qu’il entendait, auxquels se mêlaient comme des ronflements et des gémissements étouffés.
S’étant roulé en boule, il dormit jusqu’au matin. Dans le clair-obscur de la tanière, il aperçut alors, entre les pattes de la louve et pressés tout le long de son ventre, cinq petits paquets vivants, informes et débiles, vagissants, et dont les yeux étaient encore fermés à la lumière.
Quoique ce spectacle ne lui fût pas nouveau, dans sa longue carrière, ce n’en était pas moins chaque fois, pour le vieux loup, un nouvel étonnement. La louve le regardait avec inquiétude et ne perdait de vue aucun de ses mouvements. Elle grondait sourdement, à tout moment, haussant le ton dès qu’il faisait mine d’avancer. Quoique pareille aventure ne lui fût jamais advenue, son instinct, qui était fait de la mémoire commune de toutes les mères-loups et de leur successive expérience, lui avait enseigné qu’il y avait des pères-loups qui se repaissaient de leur impuissante progéniture et dévoraient leurs nouveau-nés. C’est pourquoi elle interdisait à Un-Œil d’examiner de trop près les louveteaux qu’il avait procréés.
À l’instinct ancestral de la mère-loup en correspondait un autre chez le vieux loup, qui était commun à tous les pères-loups. C’était qu’il devait incontinent, et sans se fâcher, tourner le dos à sa jeune famille et aller quérir, là où il le fallait, la chair nécessaire à sa propre subsistance et à celle de sa compagne ».
Chapitre III, Le louveteau gris
« C’est par le toucher que le louveteau, avant que ses yeux se fussent ouverts, acquit la première notion des êtres et des choses. Il connut ainsi ses deux frères et ses deux sœurs. En tâtonnant, il commença à jouer avec eux, sans les voir. Déjà aussi, il apprenait à gronder et son petit gosier, qu’il faisait vibrer pour émettre des sons, semblait grincer, lorsqu’il se mettait en colère.
Par le toucher, le goût et l’odorat, il connut sa mère, source de chaleur, de fluide nourriture et de tendresse. Il sentait surtout qu’elle avait une langue mignonne et caressante, qu’elle passait sur son doux petit corps, pour l’adoucir encore plus. Et elle s’en servait pour le ramener sans cesse contre elle, plus profondément, et l’endormir.
Ainsi se passa, en majeure partie, le premier mois de la vie du louveteau. Puis ses yeux s’ouvrirent et il apprit à connaître plus nettement le monde qui l’entourait.
Ce monde était baigné d’obscurité, mais il l’ignorait, car il n’avait jamais vu d’autre monde. La lumière que ses yeux avaient perçue était infiniment faible, mais il ne savait pas qu’il y eût une autre lumière. Son monde aussi était très petit. Il avait pour limites les parois de la tanière. Le louveteau n’en éprouvait nulle oppression, puisque le vaste monde du dehors lui était inconnu.
Il avait, cependant, rapidement découvert que l’une des parois de son univers, l’entrée de la caverne, par où filtrait la lumière, différait des autres. Il avait fait cette découverte, encore inconscient de sa propre pensée, avant même que ses yeux se fussent ouverts et eussent regardé devant eux. La lumière avait frappé ses paupières closes, produisant, à travers leur rideau, de légères pulsations des nerfs optiques, où s’étaient allumés de petits éclairs de clarté, d’une impression délicieuse. Vers la lumière avait, en une attraction irrésistible, aspiré chaque fibre de son être vivant, vers elle s’était tourné son corps, comme la substance chimique de la plante vire d’elle-même vers le soleil ». […]
« Comme elle chassait, de son côté, vers la branche droite du torrent, dans les parages où gîtait le lynx, elle avait rencontré une piste tracée par le vieux loup et vieille d’un jour. L’ayant suivie, elle avait trouvé, à son extrémité, d’autres empreintes, imprimées par le lynx, et les vestiges d’une bataille dans laquelle le félin avait eu la victoire. C’était de son compagnon, avec quelques os, tout ce qui subsistait. Les traces du lynx, qui continuaient au delà, lui avaient fait découvrir la tanière de l’ennemi. Mais, ayant reconnu, à divers indices, que celui-ci y était revenu, elle n’avait pas osé s’y aventurer.
Et toujours, depuis, la louve évitait la branche droite du torrent, car elle savait que dans la tanière se trouvait une portée de petits et elle connaissait le lynx pour une féroce créature, d’un caractère intraitable, et un terrible combattant. Oui, certes, c’était bien, pour une demi-douzaine de loups, de pourchasser un lynx et de le repousser au faîte d’un arbre, crachant et se hérissant. Un combat singulier était une tout autre affaire, surtout quand une mère-lynx avait derrière elle une jeune famille affamée à défendre et à nourrir. Un-Œil venait de l’apprendre à ses dépens.
Mais le Wild a ses lois et l’heure devait arriver où, pour le salut de son louveteau gris, la louve, poussée elle aussi par l’implacable instinct de la maternité, affronterait la tanière dans les rochers et la colère de la mère-lynx ».
Chapitre IV, Le mur du monde
« D’autres forces contraires étaient aussi en gestation chez le louveteau, dont la principale était la poussée de croître et de vivre. L’instinct et la loi commandaient d’obéir. Croître et vivre lui inculquaient la désobéissance, car la vie, c’est la recherche de la lumière, et nulle défense ne pouvait tenir contre ce flux qui montait en lui, avec chaque bouchée de viande qu’il avalait, chaque bouffée d’air aspirée. Si bien qu’à la fin crainte et obéissance se trouvèrent balayées, et le louveteau rampait vers l’ouverture de la caverne.
Différent des autres murs dont il avait fait l’expérience, le mur de lumière semblait reculer devant lui, à mesure qu’il en approchait. Nulle surface dure ne froissait le tendre petit museau qu’il avançait prudemment. La substance du mur semblait perméable et bienveillante. Il entrait dedans, il se baignait dans ce qu’il avait cru de la matière.
Il en était tout confondu. À mesure qu’il rampait à travers ce qui lui avait paru une substance solide, la lumière devenait plus luisante. La crainte l’incitait à revenir en arrière, mais la poussée de vivre l’entraînait en avant. Soudain, il se trouva au débouché de la caverne. Le mur derrière lequel il s’imaginait captif avait sauté devant lui et reculé à l’infini. En même temps, l’éclat de la lumière se faisait cruel et l’éblouissait, tandis qu’il était comme ahuri par cette abrupte et effrayante extension de l’espace. Automatiquement, ses yeux s’ajustèrent à la clarté et mirent au point la vision des objets dans la distance accrue. Et non seulement le mur avait glissé devant ses yeux, mais son aspect s’était aussi modifié. C’était maintenant un mur tout bariolé, se composant des arbres qui bordaient le torrent, de la montagne opposée, qui dominait les arbres, et du ciel, qui dominait la montagne. » […]
« C’était la joie d’un début. Né pour être un chasseur de viande (quoiqu’il l’ignorât), il tomba à l’improviste sur de la viande, dès son premier pas dans l’univers. Une chance imprévue, issue d’un pas de clerc de sa part, le mit en présence d’un nid de ptarmigans, pourtant admirablement caché, et le fit, à la lettre, choir dedans. Il s’était essayé à marcher sur un arbre déraciné, dont le tronc était couché sur le sol. L’écorce pourrie céda sous ses pas. Avec un jappement angoissé, il culbuta sur le revers de l’arbre et brisa dans sa chute les branches feuillues d’un petit buisson, au cœur duquel il se retrouva par terre, au beau milieu de sept petits poussins de ptarmigans. Ceux-ci se mirent à piailler et le louveteau, d’abord, en eut peur. Bientôt il se rendit compte de leur petitesse et il s’enhardit. Les poussins s’agitaient. Il posa sa patte sur l’un d’eux et les mouvements s’accentuèrent. Ce lui fut une satisfaction. Il flaira le poussin, puis le prit dans sa gueule ; l’oiseau se débattit et lui pinça la langue avec son bec. En même temps, le louveteau avait éprouvé la sensation de la faim. Ses mâchoires se rejoignirent. Les os fragiles craquèrent et du sang chaud coula dans sa bouche. Le goût en était bon. La viande était semblable à celle que lui apportait sa mère, mais était vivante entre ses dents et, par conséquent, meilleure. Il dévora donc le petit ptarmigan, et ainsi des autres, jusqu’à ce qu’il eût mangé toute la famille. Alors il se pourlécha les lèvres, comme il avait vu faire à sa mère, puis il commença à ramper, pour sortir du nid. »
Chapitre V, La loi de la viande
« Le louveteau éprouvait pour sa mère un respect considérable. Elle était savante à capturer la viande et jamais elle ne manquait de lui en apporter sa part. De plus elle n’avait peur de rien. Il ne se rendait pas compte qu’elle avait plus appris et en connaissait plus que lui, d’où sa plus grande bravoure, et ne voyait que la puissance supérieure qui était en elle. Elle le forçait aussi à l’obéissance et, plus il prenait de l’âge, moins elle était patiente envers lui. Aux coups de nez et aux coups de pattes avaient succédé de cuisantes morsures. Et pour cela encore, il la respectait. » […]
« Il commença à accompagner sa mère dans ses chasses et à y jouer sa partie. Il apprit férocement à tuer et à se nourrir de ce qu’il avait tué. Le monde vivant se partageait pour lui en deux catégories. Dans la première, il y avait lui et sa mère. Dans la seconde, tous les autres êtres qui vivaient et se mouvaient. Ceux-ci se classaient, à leur tour, en deux espèces. Ceux qui, comme lui-même et sa mère, tuaient et mangeaient ; ceux qui ne savaient pas tuer ou tuaient faiblement. De là surgissait la loi suprême. La viande vivait sur la viande, la vie sur la vie. Il y avait les mangeurs et les mangés. La loi était Mange ou sois Mangé.
Sans se la formuler, sans la raisonner, ni y penser même, le louveteau vivait cette loi. Il avait mangé les petits du ptarmigan. Le faucon avait mangé la mère-ptarmigan, puis aurait voulu le manger lui aussi. Devenu plus fort, c’est lui qui avait souhaité manger le faucon. Il avait mangé le petit du lynx et la mère-lynx l’aurait mangé, si elle n’avait pas été elle-même tuée et mangée. À cette loi participaient tous les êtres vivants. La viande dont il se nourrissait, et qui lui était nécessaire pour exister, courait devant lui sur le sol, volait dans les airs, grimpait aux arbres ou se cachait dans la terre. Il fallait se battre avec elle pour la conquérir et, s’il tournait le dos, c’était elle qui courait après lui. Chasseurs et chassés, mangeurs et mangés, chaos de gloutonnerie, sans merci et sans fin, ainsi le louveteau n’eût-il pas manqué de définir le monde, s’il eût été tant soit peu philosophe, à la manière des hommes.
Mais la vie et son élan avaient aussi leurs charmes. Développer et faire jouer ses muscles constituait pour le louveteau un plaisir sans fin. Courir sus après une proie était une source d’émotions et de frémissements délicieux. Rage et bataille donnaient de la joie. La terreur même et le mystère de l’Inconnu avaient leur attirance.
Puis toute peine portait en elle sa rémunération, dont la première était celle de l’estomac plein et d’un bon sommeil reposant aux chauds rayons du soleil. Aussi le louveteau ne querellait-il pas la vie, qui dans le fait seul qu’elle existe trouve sa raison d’être, ni l’hostilité ambiante du monde qui l’entourait. Il était plein de sève, très heureux et tout fier de lui-même. »
Troisième partie : The Gods of the Wild
Chapitre I, Les faiseurs de feu
« Le louveteau n’avait jamais vu d’homme, et pourtant l’instinct de l’homme était en lui. Dans l’homme il reconnaissait obscurément l’animal qui avait combattu et vaincu tous les autres animaux du Wild. Ce n’étaient pas seulement ses yeux qui regardaient, mais ceux de tous ses ancêtres, prunelles qui avaient, durant des générations, encerclé dans l’ombre et la neige d’innombrables campements humains, épié de loin, sur l’horizon, ou de plus près, dans l’épaisseur des taillis, l’étrange bête à deux pattes qui était le seigneur et maître de toutes les choses vivantes.
Cet héritage moral et surnaturel, fait de crainte et de luttes accumulées, pendant des siècles, étreignait le louveteau, trop jeune encore pour s’en dégager. Loup adulte, il eût pris rapidement la fuite. Tel qu’il était, il se coucha, paralysé d’effroi, acceptant déjà la soumission que sa race avait consentie, le premier jour où un loup vint s’asseoir au feu de l’homme, pour s’y chauffer. » […]
Le baptême
Pour ce bref paragraphe, je cite la version originale, suivie des 2 traductions, pour se rendre compte de la différence. Il semble que, sur ce bref passage, la traduction Sabathe s’écarte davantage de l’original. Mais pour la plupart des passages, les deux traductions sont tellement éloignées, que pour repérer le bon passage sur Wikisource, cela me prend du temps, car en plus, la répartition en paragraphes est fort différente ! Sur d’autres passages, j’ai vérifié que Sabathe ajoute carrément des phrases qui ne sont pas dans l’original ! Tire-t-il à la ligne pour augmenter son salaire ? Mais pour d’autres passages, au contraire, c’est dans la version Wikisource que manquent des paragraphes entiers que Sabathe traduit. Il pourrait s’agir d’une édition différente, une réédition de Jack London ? Ceci n’est pas précisé dans notre édition.
Version originale : « This be the sign of it, Gray Beaver went on. « It is plain that his mother is Kiche. But his father was a wolf. Wherefore is there in him little dog and much wolf. His fangs be white, and White Fang shall be his name. I have spoken. He is my dog. For was not Kiche my brother’s dog ? And is not my brother dead ?" » »
Traduction Wikisource : « — Ceci prouve cela, reprit Castor-Gris. Il est clair que sa mère est Kiche. Mais, une fois de plus, son père est un loup. C’est pourquoi il y a en lui peu du chien et beaucoup du loup. Ses crocs sont blancs, et White Fang (Croc-Blanc) doit être son nom. J’ai parlé. C’est mon chien. Kiche n’était-elle pas la chienne de mon frère ? Et mon frère n’est-il pas mort ? »
Traduction Sabathe : « Celui-là, répéta Castor gris. C’est certainement le petit de Kiche, et son père est certainement un loup. Il n’est chien que par sa mère, et sa mère n’est chienne que par sa mère aussi. C’est un petit loup. Je l’appellerai Croc-Blanc. Kiche n’appartenait-elle pas à mon frère ? Et mon frère n’est-il pas mort ? » […]
« Femmes et enfants apportaient de nouveaux bouts de bois et d’autres branches à l’Indien. C’était évidemment là l’affaire du moment. Le louveteau s’approcha jusqu’à toucher le genou de Castor-Gris, oubliant, telle était sa curiosité, que celui-ci était un terrible animal-homme. Soudain, il vit entre les mains de Castor-Gris, comme un brouillard qui s’élevait des morceaux de bois et de la mousse. Puis une chose vivante apparut, qui brillait et qui tournoyait, et était de la même couleur que le soleil dans le ciel.
Croc-Blanc ne connaissait rien du feu. La lueur qui en jaillissait l’attira, comme la lumière du jour l’avait, dans sa première enfance, conduit vers l’entrée de la caverne, et il rampa vers la flamme. Il entendit Castor-Gris éclater de rire au-dessus de sa tête. Le son du rire, non plus, n’était pas hostile. Alors il vint toucher la flamme avec son nez et, en même temps, sortit sa petite langue pour la lécher.
Pendant une seconde, il demeura paralysé. L’Inconnu, qui l’avait guetté parmi les bouts de bois et la mousse, l’avait férocement saisi par le nez. Puis il sauta en arrière, avec une explosion de glapissements affolés « Ki-yis ! Ki-yis ! Ki-yis ! »
Kiche, en l’entendant, se mit à bondir au bout de son bâton, en grondant, furieuse, parce qu’elle ne pouvait venir au secours du louveteau. Mais Castor-Gris riait à gorge déployée, tapant ses cuisses avec ses mains et contant l’histoire à tout le campement, jusqu’à ce que chacun éclatât, comme lui, d’un rire inextinguible. Quant à Croc-Blanc, assis sur son derrière, il criait, de plus en plus éperdu : « Ki-yis ! Ki-yis ! » et seul, abandonné de tous, faisait au milieu des animaux-hommes une pitoyable petite figure.
C’était le pire mal qu’il avait encore connu. Son nez et sa langue avaient été tous deux mis à vif par la chose vivante, couleur de soleil, qui avait grandi entre les mains de Castor-Gris. Il cria, cria interminablement, et chaque explosion nouvelle de ses hurlements était accueillie par un redoublement d’éclats de rire des animaux-hommes. Il tenta d’adoucir avec sa langue la brûlure de son nez, mais les deux souffrances, se juxtaposant, ne firent qu’en produire une plus grande, et il cria plus désespérément que jamais.
À la fin, la honte le prit. Il connut ce qu’était le rire et ce qu’il signifiait. Il ne nous est pas donné de nous expliquer comment certains animaux comprennent la nature du rire humain et connaissent que nous rions d’eux. Ce qui est certain, c’est que le louveteau eut la claire notion que les animaux-hommes se moquaient de lui et qu’il en eut honte. »
Chapitre II, La servitude
« Il appartenait aux animaux-hommes, comme tous les chiens du campement leur appartenaient. Ses actions étaient à eux, son corps était à eux, pour être battu et piétiné, et pour le supporter sans récrimination. Telle fut la leçon vite apprise par lui. Elle fut dure, étant donné ce qui s’était déjà développé, dans sa propre nature, de force personnelle et d’indépendance. Mais, tandis qu’il prenait en haine cet état de choses nouveau, il apprenait en même temps, et sans le savoir, à l’aimer. C’était, en effet, le souci de sa destinée remis en d’autres mains, un refuge pour les responsabilités de l’existence. Et cela constituait une compensation, car il est toujours plus aisé d’appuyer sa vie sur une autre que de vivre seul.
Il n’arriva pas sans révoltes à s’abandonner ainsi corps et âme, à rejeter le sauvage héritage de sa race et le souvenir du Wild. Il y eut des jours où il rampait sur la lisière de la forêt et y demeurait immobile, écoutant des voix lointaines qui l’appelaient. Puis il s’en retournait vers Kiche, inquiet et malheureux, pour gémir doucement et pensivement près d’elle, pour lui lécher la face, en semblant se plaindre et l’interroger. » […]
Sournoisement, par des voies cachées, aussi bien que par la force des pierres volantes, des coups de bâton et des claques de la main, les chaînes du louveteau rivaient autour de lui leur réseau. Les aptitudes inhérentes à son espèce, qui lui avaient, dès l’abord, rendu possible de s’acclimater au foyer de l’homme, étaient susceptibles de perfection. Elles se développèrent dans la vie du camp, au milieu des misères dont elle était faite, et lui devinrent secrètement chères avec le temps. Mais tout ce qui le préoccupait encore, pour le moment, était le chagrin d’avoir perdu Kiche, l’espoir qu’elle reviendrait et la soif de recouvrer un jour la libre existence qui avait été la sienne. »
Chapitre III, Le paria
« Il se trouva de la sorte proscrit parmi la population du camp.
Tous les jeunes chiens suivaient envers lui la conduite de Lip-Lip et joignaient leurs persécutions à celles de son ennemi. Peut-être sentaient-ils obscurément la différence originelle qui le séparait d’eux, sa naissance dans la forêt sauvage, et cédaient-ils à cette inimitié instinctive que le chien domestique éprouve pour le loup. » […] On rapprochera bien sûr ce passage de la fable de La Fontaine « Le Loup et le Chien ».
Chapitre IV, La piste des dieux
« Il arriva ainsi à la place de la tente de Castor-Gris et, au beau milieu du sol, il s’assit, puis pointa son nez vers la lune. Parmi les spasmes qui lui contractaient le gosier, il ouvrit sa gueule béante, et une clameur en jaillit, qui venait de son cœur brisé, qui disait sa solitude et son effroi, son chagrin d’avoir perdu Kiche, toutes ses peines et toutes ses misères passées, et son appréhension aussi des dangers de demain. Ce fut, pour la première fois, le long et lugubre hurlement du loup, lancé par lui, à pleine gorge. » […]
« Le louveteau tremblait, en attendant le châtiment qui allait immanquablement tomber sur lui. Il y eut, au-dessus de sa tête, un mouvement de la main de Castor-Gris. Il se courba, d’un geste instinctif. Le coup ne s’abattit pas. Alors il se risqua à lever son regard. Castor-Gris séparait en deux le morceau de suif ! Castor-Gris lui offrait un des deux morceaux ! Très doucement et non sans quelque défiance, il flaira d’abord le suif, puis le mangea. Castor-Gris ordonna de lui apporter de la viande et, tandis qu’il mangeait, le garda contre les autres chiens.
Ainsi repu, Croc-Blanc s’étendit aux pieds de Castor-Gris, regardant avec amour le feu qui le réchauffait, clignant des yeux et tout somnolent, certain désormais que le lendemain ne le trouverait pas errant à l’abandon, à travers la noire forêt, mais dans la compagnie des animaux-hommes, et côte à côte avec les dieux auxquels il s’était donné. »
Chapitre V, Le pacte
« Le louveteau avait vu les chiens du camp travailler sous le harnais. Aussi ne fut-il point trop effarouché lorsqu’on l’attela pour la première fois. On lui passa autour du cou un collier rembourré de mousse et que deux lanières reliaient à une courroie qui se croisait sur sa poitrine et sur son dos. À cette courroie était attachée une longue corde, qui servait à tirer le traîneau.
Six autres chiens composaient l’attelage avec lui. Ils étaient nés au début de l’année et, par conséquent, âgés de neuf à dix mois, tandis que le louveteau n’en comptait que huit. Chaque bête était reliée au traîneau par une corde indépendante, fixée à un anneau. Il n’y avait pas deux cordes de la même dimension, et la différence de longueur de chacune d’elles correspondait, au minimum, à la longueur du corps d’un chien. Le traîneau était un « toboggan » en écorce de bouleau, et son avant se relevait, comme fait la pointe d’un sabot, afin de l’empêcher de plonger dans la neige. La charge était répartie également sur toute la surface du véhicule, d’où les chiens rayonnaient en éventail.
La différence de longueur des cordes empêchait les chiens de se battre entre eux, car celui qui aurait voulu le faire ne pouvait s’en prendre utilement qu’au chien qui le suivait et, en se retournant vers lui, il s’exposait en même temps au fouet du conducteur, qui n’eût point manqué de le cingler en pleine figure. S’il prétendait, au contraire, attaquer le chien qui le précédait, il tirait plus vivement le traîneau et, comme le chien poursuivi en faisait autant, pour n’être point atteint, tout l’attelage, entraîné par l’exemple, accélérait son allure.
Mit-Sah était, comme son père, un homme sage. Il n’avait pas été sans remarquer les persécutions dont Croc-Blanc était victime de la part de Lip-Lip. Mais alors Lip-Lip avait un autre maître et Mit-Sah ne pouvait faire plus que de lui lancer quelques pierres. Ayant acquis maintenant Lip-Lip, il commença à assouvir sur lui sa vengeance en l’attachant au bout de la plus longue corde. Lip-Lip en devint, du coup, le leader de la troupe. C’était, en apparence, un honneur. En réalité, loin de commander aux autres chiens, il devenait le but de leurs persécutions et de leur haine.
La troupe ne voyait de lui, en effet, que le large panache de sa queue et ses pattes de derrière, qui détalaient sans répit, spectacle beaucoup moins intimidant que n’était auparavant celui de sa crinière hérissée et de ses crocs étincelants. Les chiens, en l’apercevant toujours dans cette posture, ne manquèrent pas, dans leur raisonnement, de conclure qu’il avait peur d’eux et qu’il les fuyait, ce qui leur donna immédiatement l’envie de lui courir sus. » […]
Chapitre VI, La famine
« Vers la mi-été, Croc-Blanc eut une épreuve. Comme il trottait seul, un jour, silencieux comme de coutume, et examinait une nouvelle tente, qui s’était élevée pendant son absence, sur la lisière du camp, il tomba en plein sur Kiche.
S’étant arrêté, il la regarda. Son souvenir d’elle était vague, mais non effacé. À son aspect, elle retroussa sa lèvre, avec son ancien grondement de menace. Alors la mémoire revint, plus claire, au louveteau. Son enfance oubliée, et toutes les remembrances qui s’associaient à ce grondement qui lui était familier, se précipitèrent à l’esprit de Croc-Blanc. Avant qu’il connût les dieux, Kiche avait été pour lui le pivot de l’univers. Le flot des anciens sentiments et de l’intimité passée surgit en lui. Il fit vers elle un bond joyeux. Elle le reçut avec ses crocs aigus, qui lui ouvrirent la joue jusqu’à l’os. Le louveteau ne comprit pas et se recula en arrière, tout démonté et fort intrigué.
Kiche, cependant, n’était pas coupable. Une mère-louve n’est pas créée pour se souvenir de ses louveteaux, de ceux d’un an, ni de ceux qui précèdent. Aussi ne reconnut-elle pas Croc-Blanc. Ce n’était pour elle qu’une bête étrangère et un intrus. Sa présente portée lui interdisait de tolérer aucun animal à proximité.
Un des petits louveteaux vint gambader autour de Croc-Blanc. Ils étaient demi-frères, mais ils l’ignoraient tous deux. Croc-Blanc flaira curieusement le petit, mais il fut aussitôt attaqué par Kiche, qui lui déchira la face, une seconde fois. Il recula encore plus loin.
Les vieux souvenirs, et toutes les idées qui s’y associaient, moururent à nouveau et retombèrent au tombeau d’où elles avaient ressuscité. Croc-Blanc regarda Kiche, qui était en train de lécher son petit et qui s’en arrêtait, de temps à autre, pour gronder et menacer. Elle était devenue sans intérêt pour lui. Il avait appris à vivre loin d’elle et il l’oublia tout à fait. Il n’y eut plus, dans sa pensée, place pour elle, exactement comme elle n’avait plus, dans la sienne, gardé place pour lui.
Il restait là, immobile, tout étourdi, livrant une dernière bataille à ses souvenirs bouleversés, lorsque Kiche, pour la troisième fois, renouvela son attaque, bien décidée à l’expulser loin de son voisinage. Croc-Blanc se laissa volontairement chasser. C’était une loi de sa race que les mâles ne doivent pas combattre contre les femelles, et Kiche en était une. Aucune déduction de la vie ni du monde ne lui avait enseigné cette loi. Il la connaissait, immédiate et impérative, par ce même instinct qui avait mis en lui la crainte de l’Inconnu et celle de la mort. » […]
« Tandis que les dieux en étaient réduits à manger le cuir de leurs mocassins et de leurs moufles, les chiens dévoraient les harnais dont on les avait déchargés, et jusqu’à la lanière des fouets. Puis les chiens se mangèrent les uns les autres et les dieux, à leur tour, mangèrent les chiens. Les plus débiles et les moins beaux étaient mangés les premiers. Ceux qui survivaient regardaient et comprenaient. Quelques-uns parmi les plus hardis, croyant faire preuve de sagesse, abandonnèrent les feux des dieux et s’enfuirent dans les forêts. Ils y succombèrent de faim ou furent dévorés par les loups.
Dans cette misère, Croc-Blanc se coula lui aussi parmi les bois. L’entraînement de son enfance le rendait plus apte que les autres chiens à la vie sauvage et le guidait dans ses actions. Il s’adonna plus spécialement à la chasse des menues bestioles et reprit ses affûts à l’écureuil, dont il guettait les mouvements sur les arbres, attendant, avec une patience aussi infinie que sa faim, que le prudent petit animal s’aventurât sur le sol. Il s’élançait alors de sa cachette, comme un gris projectile, incroyablement rapide, et ne manquait jamais son but. Si vif que fût l’envol de l’écureuil, il était trop lent encore.
Mais si réussie que fût cette chasse, il n’y avait pas assez d’écureuils pour engraisser, ou simplement nourrir Croc-Blanc. Il chassa plus petit, ne dédaigna pas de déterrer les souris-des-bois et n’hésita pas à livrer bataille à une belette, aussi affamée que lui et bien plus féroce.
Au moment où la famine atteignait son point culminant, il s’en revint vers les feux des dieux. Il s’arrêta à quelque distance des tentes, épiant, de la forêt, ce qui se passait dans le camp, évitant d’être découvert et dépouillant les pièges des Indiens du gibier qu’il y trouvait capturé. Il spolia même un piège appartenant à Castor-Gris et où un lapin était pris, tandis que son ancien maître était à errer dans la forêt. Il se reposait souvent, couché sur le sol, si grande était sa faiblesse et tellement le souffle lui manquait.
Il rencontra, un jour, un jeune loup, maigre et demi-mort de besoin. S’il n’avait pas été affamé lui-même, Croc-Blanc aurait pu se joindre à lui et, peut-être, aller reprendre place dans la troupe sauvage de ses frères. Mais, étant donné la situation présente, il courut sur le jeune loup, le tua et le mangea. » […]
Quatrième partie : The Superior Gods
Chapitre I, L’ennemi de sa race
« Mais les chiens ne purent jamais prendre l’habitude de le laisser tranquille au campement. Chaque soir, en hurlant, ils s’élançaient à l’attaque, oublieux de la leçon de la nuit précédente, et la nouvelle leçon qu’ils recevaient était destinée à être aussi vite oubliée. La haine qu’ils ressentaient pour Croc-Blanc avait d’ailleurs des racines plus profondes dans la dissemblance qu’ils sentaient exister entre eux et lui. Cette seule cause aurait suffi à la faire naître. Comme lui sans doute, ils étaient des loups domestiqués. Mais, domestiqués depuis des générations, ils avaient perdu l’accoutumance du Wild, dont ils n’avaient conservé qu’une notion, celle de son Inconnu, de son Inconnu terrible et toujours menaçant. C’était le Wild, dont il était demeuré plus proche, qu’ils haïssaient dans leur compagnon. Celui-ci le personnifiait pour eux ; il en était le symbole. Et, quand ils découvraient leurs dents en face de lui, ils se défendaient, en leur pensée, contre les obscures puissances de destruction qui les environnaient, dans l’ombre de la forêt, qui les épiaient sournoisement, au delà de la limite des feux du campement. » […]
« Ce fut à Fort Yukon que Croc-Blanc vit les premiers hommes blancs. Comparés aux Indiens qu’il avait connus, ils lui semblèrent des êtres d’une autre espèce, une race de dieux supérieurs. Son impression fut qu’ils possédaient un plus grand pouvoir, et c’est dans le pouvoir que réside la divinité des dieux.
Ce fut un sentiment qu’il éprouva, plus qu’il ne raisonna cette impression. De même que, dans son enfance, l’ampleur des tentes, élevées par les premiers hommes qu’il avait rencontrés, avait frappé son esprit comme une manifestation de puissance, de même encore il était frappé maintenant par les maisons qu’il voyait et qui étaient construites, comme le fort lui-même, de bûches massives. Voilà qui était de la puissance. Le pouvoir des dieux blancs était supérieur à celui des dieux qu’il avait adorés jusque-là, supérieur même à celui de Castor-Gris, de ceux-ci le plus puissant, et qui ne semblait plus, parmi les dieux à peau blanche, qu’un petit dieu enfant. » […]
« Toujours Croc-Blanc était chargé d’allumer la querelle avec les chiens étrangers. Il y réussissait facilement. Car, pour eux, plus encore que pour ses compagnons, il était le Wild sauvage, abandonné et trahi par eux, et qu’ils craignaient obscurément de voir les reprendre. Venus du doux monde du Sud vers les rives du Yukon, sur la sombre et redoutable Terre du Nord, ils ne pouvaient résister longtemps à l’inconsciente impulsion qui les poussait à s’élancer sur Croc-Blanc. Si amollis qu’ils fussent par l’accoutumance des villes, et si oublieux du passé de leurs ancêtres, si lointaine que fût en eux la notion du Wild, ils la sentaient soudain tressaillir au fond de leur être, dès qu’ils se trouvaient en présence de la créature hybride qu’était Croc-Blanc. Devant le loup qui était en lui et qui leur apparaissait tout à coup, dans la claire lumière du jour, ils se souvenaient de l’ancien ennemi.
Il était pour eux une proie légitime, comme eux-mêmes, pour lui, en étaient une. »
Chapitre II, Le Dieu fou
« Les quelques hommes blancs qui se trouvaient à Fort Yukon vivaient depuis longtemps dans la contrée. Ils se dénommaient eux-mêmes, avec orgueil, les Sour-Doughs, parce qu’ils préparaient, sans levure, un pain légèrement acidulé. Ils ne professaient que du dédain pour les autres hommes blancs qu’amenaient les vapeurs, et qu’ils désignaient sous le nom de Chechaquos, parce que ceux-ci faisaient, au contraire, lever leur pain pour le cuire. » […]
« L’un d’eux surtout, parmi ces hommes, s’intéressait à ce genre de sport. Au premier coup de sifflet du steamboat, il arrivait en courant, et, lorsque le dernier combat était terminé, il remontait vers le fort, la face comme alourdie du regret que le massacre eût déjà pris fin. Chaque fois qu’un inoffensif chien du Sud avait été terrassé et jetait son râle d’agonie sous les crocs de la troupe ennemie, incapable de contenir sa joie, il se mettait à gambader et à pousser des cris de bonheur. Et, toujours aussi, il lançait vers Croc-Blanc un dur regard d’envie pour tout le mal dont celui-ci était l’auteur.
Cet antipathique individu avait été baptisé Beauty par les autres hommes du Fort. Beauty-Smith était le seul nom qu’on lui connaissait dans la région. Nom qui était, bien entendu, une antithèse, car celui qui le portait n’était rien moins qu’une beauté. » […]
« Beauté, en somme, était un vrai monstre. Ce dont il n’était pas responsable, assurément, et ne pouvait être blâmé, n’ayant pas moulé lui-même l’argile dont il était pétri.
Dans le fort, il faisait la cuisine pour les autres hommes, lavait la vaisselle et était chargé de tous les gros travaux. On ne le méprisait pas ; on le tolérait, par humanité et parce qu’il était utile. On en avait peur aussi. Il y avait toujours à craindre, dans une de ses rages de lâche, un coup de fusil dans le dos ou du poison dans le café. Mais personne ne savait préparer comme lui le fricot et, quel que fût l’effroi qu’il inspirait, Beauté était bon cuisinier.
Tel était l’homme qui délectait ses regards des féroces prouesses de Croc-Blanc et n’eut plus bientôt qu’un désir, le posséder. Il commença par faire des avances au louveteau, qui feignit de les ignorer. Puis, les avances devenant plus pressantes, celui-ci se hérissa, montra les dents et prit du large. Croc-Blanc n’aimait pas cet homme, dont l’odeur était mauvaise. Il pressentait que le mal était en lui. Il craignait sa main étendue et l’affectation de ses paroles mielleuses. Il le haïssait. » […]
« Il fut ensuite attaché à une chaîne qui défiait ses dents et ce fut en vain qu’il s’évertua à arracher le cadenas qui reliait cette chaîne à une grosse poutre.
Quelques jours après, Castor-Gris, devenu un parfait alcoolique et en pleine banqueroute, quitta le Porcupine pour refaire à rebours son long voyage sur le Mackenzie. Croc-Blanc demeurait, sur le Yukon, la propriété d’un homme plus qu’à demi fou et le type achevé de la brute. Mais qu’est-ce qu’un loup peut bien comprendre à la folie ? Pour Croc-Blanc, son nouveau maître était un dieu sinistre, mais toujours un dieu. Tout ce qu’il savait, c’est qu’il devait se soumettre à sa volonté, obéir à son désir, se plier à sa fantaisie. » […]
Chapitre III, Le règne de la haine
« De ce jour, tout le désir de Croc-Blanc fut de voir des hommes se réunir autour de son enclos. Car cette réunion signifiait un combat, et c’était la seule voie qui lui restait pour extérioriser sa force de vie, pour exprimer la haine que Beauty-Smith lui avait savamment inculquée. Et de ses capacités combatives Beauty-Smith n’avait pas trop préjugé, car il demeurait invariablement le vainqueur.
Trois chiens, dans une de ces rencontres, furent successivement abattus par lui. Dans une autre, un loup adulte, nouvellement enlevé au Wild, fut projeté, d’une seule poussée, à travers la porte de l’enclos. Une troisième fois, il eut à combattre contre deux chiens, simultanément. Ce fut sa plus rude bataille. Mais il finit par les tuer tous deux et faillit lui-même en crever. » […]

Combat de chien et de loup. Partie IV, Chapitre 4 « L’étreinte de la mort ».
© Charles Livingston Bull / Wikicommons
Chapitre IV, L’étreinte de la mort
Voici le dernier combat de Croc-Blanc, au terme duquel il est sauvé in extremis par son 3e et dernier maître.
« La prise n’était pas bien placée ; elle était trop bas vers la poitrine ; mais elle était solide. Croc-Blanc, avec une exaspération frénétique, s’efforça de secouer ces dents resserrées sur lui, ce poids qu’il sentait pendu à son cou. Ses mouvements, maintenant, n’étaient plus libres ; il lui semblait qu’il avait été happé par une chausse-trappe. Tout son être s’en révoltait, au point de tomber en démence. La peur de mourir avait tout à coup surgi en lui, une peur aveugle et désespérée.
Il se mit à virer, tourner, courir à droite, courir à gauche, tant pour se persuader qu’il était toujours vivant que pour tenter de détacher les cinquante pounds que traînait sa gorge. Le bull-dog se contentait, à peu de chose près, de conserver son emprise. Quelquefois, il tentait de reprendre pied, pendant un moment, afin de secouer Croc-Blanc à son tour. Mais, l’instant d’après, Croc-Blanc l’enlevait à nouveau et l’emportait à sa suite, dans ses mouvements giratoires.
Cherokee s’abandonnait consciemment à son instinct. Il savait que sa tâche consistait à tenir dur et il en éprouvait de petits frissons joyeux. Il fermait béatement les yeux et, sans se raidir, se laissait ballotter, de-ci, de-là, avec abandon, indifférent aux heurts auxquels il était exposé. Croc-Blanc ne s’arrêta que lorsqu’il fut exténué. Il ne pouvait rien contre son adversaire. Jamais pareille aventure ne lui était arrivée. Il se coucha sur ses jarrets, pantelant et cherchant son souffle.
Le bull-dog, sans relâcher son étreinte, tenta de le renverser complètement. Croc-Blanc résista à cet effort ; mais il sentit que les mâchoires qui le tenaillaient, par un imperceptible mouvement de mastication, portaient plus haut leur emprise. Patiemment, elles travaillaient à se rapprocher de sa gorge. Dans un mouvement spasmodique, il réussit à mordre lui-même le cou gras de Cherokee, là où il se rattache à l’épaule. Mais il se contenta de le lacérer, pour lâcher prise ensuite. Il ignorait la mastication de combat et sa mâchoire, au surplus, n’y était point apte.
Un changement se produisit, à ce moment, dans la position des deux adversaires. Le bull-dog était parvenu à rouler Croc-Blanc sur le dos et, toujours accroché à son cou, lui était monté sur le ventre. Alors Croc-Blanc, se ramassant sur son train de derrière, s’était mis à déchirer à coups de griffes, à la manière d’un chat, l’abdomen de son adversaire. Cherokee n’eût pas manqué d’être éventré s’il n’eût rapidement pivoté sur ses dents serrées, hors de la portée de cette attaque imprévue.
Mais le destin était inexorable, inexorable comme la mâchoire qui, dès que Croc-Blanc demeurait un instant immobile, continuait à monter le long de la veine jugulaire. Seules, la peau flasque de son cou et l’épaisse fourrure qui la recouvrait sauvaient encore de la mort le jeune loup. Cette peau formait un gros rouleau dans la gueule du bull-dog et la fourrure défiait toute entame de la part des dents. Cependant Cherokee absorbait toujours plus de peau et de poil et, de la sorte, étranglait lentement Croc-Blanc, qui respirait et soufflait de plus en plus difficilement.
La bataille semblait virtuellement terminée. Ceux qui avaient parié pour Cherokee exultaient et offraient de ridicules surenchères. Ceux, au contraire, qui avaient misé sur Croc-Blanc étaient découragés et refusaient des paris à dix pour un, à vingt pour un. On vit alors un homme s’avancer sur la piste du combat. C’était Beauty-Smith. Il étendit son doigt dans la direction de Croc-Blanc, puis se mit à rire, avec dérision et mépris.
L’effet de ce geste ne se fit pas attendre. Croc-Blanc, en proie à une rage sauvage, appela à lui tout ce qui lui restait de forces et se remit sur ses pattes. Mais, après avoir traîné encore autour du cercle les cinquante pounds qu’il portait, sa colère tourna en panique. Il ne vit plus que la mort adhérente à sa gorge et, trébuchant, tombant, se relevant, enlevant son ennemi de terre, il lutta vainement, non plus pour vaincre, mais pour sauver sa vie. Il tomba à la renverse, exténué, et le bulldog en profita pour enfouir dans sa gueule un bourrelet de peau et de poil encore plus gros. La strangulation complète était proche. Des cris, des applaudissements s’élevèrent, à la louange du vainqueur. On clama : « Cherokee ! Cherokee ! » Cherokee répondit en remuant le tronçon de sa queue, mais sans se laisser distraire de sa besogne. Il n’y avait aucune relation de sympathie entre sa queue et ses mâchoires massives. L’une pouvait s’agiter joyeusement, sans que les autres détendissent leur implacable étau.
Une diversion inattendue survint, sur ces entrefaites. Un bruit de grelots résonna, mêlé à des aboiements de chiens de traîneau. Les spectateurs tournèrent la tête, craignant de voir arriver la police. Il n’en était rien. Le traîneau venait, à toute vitesse, de la direction opposée à celle du fort et les deux hommes qui le montaient rentraient, sans doute, de quelque voyage d’exploration. Apercevant la foule ils arrêtèrent leurs chiens et s’approchèrent, afin de se rendre compte du motif qui réunissait tous ces gens.
Celui qui conduisait les chiens portait moustache. L’autre, un grand jeune homme, était rasé à fleur de peau. Il était tout rouge du sang que l’air glacé et la rapidité de la course lui avaient fait affluer au visage.
Croc-Blanc continuait à agoniser et ne tentait plus de lutter. Seuls, des spasmes inconscients le soulevaient encore, par saccades, en une résistance machinale, qui s’éteindrait bientôt, avec son dernier souffle. Beauty-Smith ne l’avait pas perdu de vue, une seule minute ; même les nouveaux venus ne lui avaient pas fait tourner la tête. Lorsqu’il s’aperçut que les yeux de son champion commençaient à se ternir, quand il se rendit compte que tout espoir de vaincre était perdu, l’abîme de brutalité où se noyait son cerveau submergea le peu de raison qui lui demeurait. Perdant toute retenue, il s’élança férocement sur Croc-Blanc, pour le frapper. Il y eut des cris de protestation et des sifflets, mais personne ne bougea.
Beauty-Smith persistait à frapper la bête, à coups de souliers ferrés, lorsqu’un remous se produisit dans la foule. C’était le grand jeune homme qui se frayait un passage, écartant les gens, à droite et à gauche, sans cérémonie ni douceur. Lorsqu’il parvint sur l’arène, Beauty-Smith était justement en train d’envoyer un coup de pied à Croc-Blanc et, une jambe levée, se tenait en équilibre instable sur son autre jambe. L’instant était bon et le grand jeune homme en profita pour appliquer à Beauty-Smith un maître coup de poing, en pleine figure. Beauté fut soulevé du sol, tout son corps cabriola en l’air, puis il retomba violemment à la renverse, sur la neige battue. Se tournant ensuite vers la foule, le grand jeune homme cria :
— Vous êtes des lâches ! Vous êtes des brutes !
Il était en proie à une indicible colère, à une colère sainte. Ses yeux gris avaient des lueurs métalliques et des reflets d’acier, qui fulguraient vers la foule. Beauty-Smith, s’étant remis debout, s’avança vers lui, reniflant et apeuré. Le nouveau venu, sans attendre de savoir ce qu’il voulait et ignorant l’abjection du personnage, pensa que Beauté désirait se battre. Il se hâta donc de lui écraser la face d’un second coup de poing avec un :
— Vous êtes une brute !
Beauty-Smith, renversé à nouveau, jugea que le sol était la place la plus sûre qu’il y eût pour lui et il resta couché, là où il était tombé, sans plus essayer de se relever.
— Venez ici, Matt, et aidez-moi ! dit le grand jeune homme à son compagnon, qui l’avait suivi dans le cercle.
Les deux hommes se courbèrent vers les combattants. Matt soutint Croc-Blanc, prêt à l’emporter dès que les mâchoires de Cherokee se seraient détendues. Mais le grand jeune homme tenta en vain, avec ses mains, d’ouvrir la gueule du bull-dog. Il suait, tirait, soufflait, en s’exclamant, entre chaque effort :
— Brutes !
La foule commença à grogner et à murmurer. Les plus hardis protestèrent qu’on venait les déranger dans leur amusement. Mais ils se taisaient dès que le grand jeune homme, quittant son occupation, les fixait des yeux et les interpellait :
— Brutes ! Ignobles brutes !
— Tous vos efforts ne servent de rien, Mister Scott, dit Matt à la fin. Vous ne pourrez les séparer en vous y prenant ainsi.
Ils se relevèrent et examinèrent les deux bêtes, toujours rivées l’une à l’autre.
— Il ne saigne pas beaucoup, prononça Matt, et ne va pas mourir encore.
— La mort peut survenir dans un instant, répondit Scott. Là ! Voyez-vous ? Le bull-dog a remonté encore un peu sa morsure.
Il frappa Cherokee sur la tête, durement et plusieurs fois. Les dents, pour cela, ne se desserrèrent point. Cherokee remuait son tronçon de queue ; ce qui voulait dire qu’il comprenait la signification des coups, mais aussi qu’il savait être dans son droit et accomplir strictement son devoir, en refusant de lâcher sa prise.
— Allons ! Quelqu’un de vous ne viendra-t-il pas nous aider ? cria Scott à la foule, en désespoir de cause.
Mais son appel demeura vain. On se moqua de lui, on lui donna de facétieux conseils, on le blagua, avec ironie.
Il fouilla dans l’étui qui pendait à sa ceinture et en tira un revolver, dont il s’efforça d’introduire le canon entre les mâchoires de Cherokee. Il taraudait si dur qu’on entendait distinctement le crissement de l’acier contre les dents. Les deux hommes étaient à genoux, courbés sur les deux bêtes. Tim Keenan s’avança vers eux, sur l’arène, et, s’étant arrêté devant Scott, lui toucha l’épaule en disant :
— Ne brisez pas ses dents, étranger !
— Alors c’est son cou que je lui briserai ! répondit Scott, en continuant son mouvement de va-et-vient avec le canon du revolver.
— Je dis : Ne brisez pas ses dents ! répéta le maître de Cherokee, d’un ton plus solennel encore.
Mais son bluff fut inutile et Scott ne se laissa pas démonter. Il leva les yeux vers son interlocuteur et lui demanda froidement
— Votre chien ?
Tim Keenan émit un grognement affirmatif.
— Alors, venez à ma place et brisez sa prise.
Tim Keenan s’irrita :
— Étranger, je n’ai pas pour habitude de me mêler des choses que je ne saurais faire. Je serais impuissant à ouvrir ce cadenas.
— En ce cas, ôtez-vous de là et ne m’embêtez pas. Je suis occupé.
Scott avait déjà réussi à insinuer le canon du revolver sur un des côtés de la mâchoire. Il manœuvra, tant et tant, qu’il atteignit l’autre côté. Après quoi, comme il eût fait avec un levier, il desserra peu à peu les dents du bull-dog. Matt sortait, à mesure, de la gueule entr’ouverte, le bourrelet de peau et de poil de Croc-Blanc.
— Préparez-vous à recevoir votre chien, ordonna Scott, d’un ton péremptoire, à Tim Keenan, qui était demeuré debout, sans s’éloigner.
Tim Keenan obéit et, se penchant, saisit fortement Cherokee, qu’une dernière pesée du revolver décrocha complètement. Le bull-dog se débattait avec vigueur.
— Tirez-le au large ! commanda Scott.
Tim Keenan et Cherokee, l’un traînant l’autre, s’éloignèrent parmi la foule.
Croc-Blanc fit, pour se relever, plusieurs efforts inutiles. Comme il était arrivé à se remettre sur ses pattes, ses jarrets, trop faibles, le trahirent et il s’affaissa mollement. Ses yeux étaient mi-clos et leur prunelle toute terne ; sa gueule était béante et la langue pendait, gonflée et inerte. Il avait l’aspect d’un chien qui a été étranglé à mort. Matt l’examina.
— Il est à bout. Mais il respire encore. »
Chapitre V, L’indomptable
« Matt retourna son pouce vers Croc-Blanc.
— Loup ou chien, c’est tout un ; celui-ci a déjà été apprivoisé.
— Non !
— Je dis oui. N’a-t-il pas déjà porté des harnais ? Regardez à cette place, vous y verrez la marque qu’ils ont laissée sur sa poitrine.
— Matt, vous avez raison. C’était un chien de traîneau, avant que Beauty-Smith eût acquis l’animal.
— Et je ne vois pas d’obstacle à ce qu’il le redevienne.
— Qu’est-ce qui vous le fait penser ? demanda Scott avec vivacité.
Mais, ayant considéré Croc-Blanc, il reprit un air désolé.
— Nous l’avons depuis deux semaines déjà et, s’il a fait des progrès, c’est en sauvagerie.
— Il faudrait que vous me laissiez agir à mon gré. Il y a une chance encore que nous n’avons pas courue. C’est de le lâcher pour un moment.
Scott eut un geste d’incrédulité.
— Oui, je sais, reprit Matt. Vous avez essayé déjà de le détacher, sans seulement parvenir à vous en approcher. Mais voilà, vous n’aviez pas de gourdin.
— Alors, tentez le coup vous-même.
Le conducteur de chiens prit un solide bâton et s’avança vers Croc-Blanc enchaîné, qui se mit aussitôt à observer le gourdin avec la même attention que prête un lion en cage à la cravache de son dompteur.
— Regardez-moi ses yeux, dit Matt. C’est un bon signe. Il n’est pas bête et se garde bien de s’élancer sur moi. Non, non, il n’est pas sot.
Et comme l’autre main de l’homme s’approchait de son cou, Croc-Blanc se hérissa, gronda, mais se coucha par terre. Il fixait cette main du regard, sans perdre de vue celle qui tenait le gourdin suspendu, menaçant, au-dessus de sa tête. Matt détacha la chaîne du collier et revint en arrière.
Croc-Blanc pouvait à peine croire qu’il était libre. Bien des mois s’étaient écoulés depuis qu’il appartenait à Beauty-Smith et, durant cette période, il n’avait jamais connu un moment de liberté. On le détachait seulement lorsqu’on le menait au combat et, celui-ci terminé, on l’enchaînait derechef.
Il ne savait que faire de lui. Peut-être quelque nouvelle diablerie des dieux se préparait-elle à ses dépens. Il se mit à marcher lentement, précautionneusement, se tenant sans cesse sur ses gardes. Ce qui se passait là était sans précédent. À tout hasard il s’écarta des deux hommes qui l’observaient et se dirigea, à pas comptés, vers la cabane, où il entra. Rien n’arriva. Sa perplexité ne fit qu’augmenter. Il ressortit, fit une douzaine de pas en avant et regarda ses dieux, intensément.
— Ne va-t-il pas s’échapper ? interrogea Scott.
Matt eut un mouvement des épaules.
— C’est à risquer. C’est le seul moyen de nous renseigner.
— Pauvre bête ! murmura Scott, avec pitié. Ce qu’elle attend, c’est quelque signe d’humaine bonté. »
Chapitre VI, Le maître d’amour
Cette scène est à étudier en parallèle avec une scène du Lion de Joseph Kessel.
« Le dieu finit par jeter la viande dans la neige, aux pieds de Croc-Blanc, qui la flaira avec attention, sans la regarder. Les yeux étaient toujours pour le dieu. Rien n’arriva encore. Le dieu lui offrit un second morceau. Il refusa à nouveau de le prendre et, de nouveau, le dieu le lui jeta. Ceci fut répété un grand nombre de fois. Mais un moment arriva où le dieu refusa de jeter le morceau. Il le garda dans sa main et, fermement, le lui présenta.
La viande était bonne, et Croc-Blanc avait faim. Pas à pas, avec d’infinies précautions, il s’approcha. Puis il se décida. Sans quitter le dieu du regard, les oreilles couchées, le poil involontairement dressé en crête sur son cou, un sourd grondement roulant dans son gosier, afin d’avertir qu’il se tenait sur ses gardes et ne prétendait pas être joué, il allongea la tête et prit le morceau, le mangea. Rien n’arriva. Morceau par morceau, il mangea toute la viande et, toujours, rien n’arrivait. Le châtiment était encore différé.
Croc-Blanc lécha ses babines et attendit. Le dieu s’avança et parla à nouveau, avec bonté. Puis il étendit la main. La voix inspirait la confiance, mais la main inspirait la crainte. Croc-Blanc se sentait tiraillé violemment par deux impulsions opposées. Il se décida pour un compromis, grondant et couchant ses oreilles, mais ne mordant pas. La main continua à descendre, jusqu’à toucher l’extrémité de ses poils, tout hérissés. Il recula et elle le suivit, pressant davantage contre lui. Il frissonnait et voulait se soumettre, mais il ne pouvait oublier en un jour tout ce que les dieux lui avaient fait souffrir. Puis la main s’éleva et redescendit alternativement, en une caresse. Il suivit ses mouvements, en se taisant et en grondant tour à tour, car les véritables intentions du dieu n’apparaissaient pas nettement encore. La caresse se fit plus douce ; elle frotta la base des oreilles et le plaisir éprouvé s’en accrut ». […]
« C’était le commencement de la fin, de la fin, pour Croc-Blanc, de son ancienne vie et du règne de la haine. Une autre existence, immensément belle, était pour lui à son aurore. Il faudrait sans doute, de la part de Weedon Scott, beaucoup de soins et de patience pour la réaliser. Car Croc-Blanc n’était plus le louveteau, issu du Wild sauvage, qui s’était donné Castor-Gris pour seigneur, et dont l’argile était prête à prendre la forme qu’on lui destinerait. Il avait été formé et durci dans la haine ; il était devenu un être de fer, de prudence et de ruse. Il lui fallait maintenant refluer tout entier, sous la pression d’une puissance nouvelle, qui était l’Amour. Weedon Scott s’était donné pour tâche de réhabiliter Croc-Blanc, ou plutôt de réhabiliter l’humanité du tort qu’elle lui avait fait. C’était pour Scott une affaire de conscience. La dette de l’homme envers l’animal devait être payée.
Tout d’abord Croc-Blanc ne vit en son nouveau dieu qu’un dieu préférable à Beauty-Smith. C’est pourquoi, une fois détaché, il resta. Et, pour prouver sa fidélité, il se fit de lui-même le gardien du bien de son maître. Tandis que les chiens du traîneau dormaient, il veillait et rôdait autour de la maison. Le premier visiteur nocturne qui se présenta pour voir Scott dut livrer combat à Croc-Blanc, avec un gourdin, jusqu’à ce que Scott vînt le secourir. Bientôt Croc-Blanc apprit à juger les gens. L’homme qui venait droit et ferme vers la porte de la maison, on pouvait le laisser passer, tout en le surveillant jusqu’au moment où, la porte s’étant ouverte, il avait reçu le salut du maître. Mais l’homme qui se présentait sans faire de bruit, avec une démarche oblique et hésitante, regardant avec précaution et semblant chercher le secret, celui-là ne valait rien. Il n’avait qu’une chose à faire, s’enfuir en vitesse et sans demander son reste.
Scott continuait, chaque jour, à choyer et à caresser Croc-Blanc, qui prit goût, de plus en plus, à ses caresses. Quand la main le touchait, il grondait toujours, mais c’était l’unique son que put émettre son gosier, la seule note que sa gorge eût appris à proférer. Il eût voulu l’adoucir, mais il n’y parvenait pas. Et pourtant, dans ce grondement, l’oreille attentive de Scott arrivait à discerner comme un ronron. Lorsque son dieu était près de lui, Croc-Blanc ressentait une joie ardente ; si le dieu s’éloignait, l’inquiétude lui revenait, un vide s’ouvrait en lui et l’oppressait comme un néant. Dans le passé, il avait eu pour but unique son propre bien-être et l’absence de toute peine. Il en allait, maintenant, différemment. Dès le lever du jour, au lieu de rester couché dans le coin bien chaud et bien abrité, où il avait passé la nuit, il s’en venait attendre, sur le seuil glacé de la cabane, durant des heures entières, le bonheur de voir la face de son dieu, d’être amicalement touché par ses doigts et de recevoir une affectueuse parole. Sa propre incommodité ne comptait plus. La viande, la viande même, passait au second plan, et il abandonnait son repas commencé, afin d’accompagner son maître, s’il le voyait partir pour la ville. » […] « Pareillement, il tolérait Matt, comme étant une propriété de son maître. C’était Matt qui, le plus souvent, lui donnait sa nourriture ; mais Croc-Blanc devinait que cette nourriture lui venait de son maître. Ce fut Matt aussi qui tenta le premier de lui mettre des harnais et de l’atteler au traîneau, en compagnie des autres chiens. Matt n’y réussit pas. Il ne se soumit qu’après l’intervention personnelle de Scott. Ensuite il accepta, par l’intermédiaire de Matt, la loi du travail, qui était la volonté de son maître. Il ne fut satisfait, toutefois, qu’après avoir repris, en dépit de Matt qui ignorait ses capacités, son ancien rôle de chef de file. » […]
« Puis, dans la prochaine lettre qu’il écrivit à Scott, il ajouta un post-scriptum à ce sujet.
Weedon Scott se trouvait à Circle City. lorsqu’il lut : « Ce damné loup ne veut plus travailler ; il ne prétend pas manger. Je ne sais que faire de lui. Il voudrait connaître ce que vous êtes devenu et je ne sais comment le lui dire. Je crois qu’il est en train de mourir. »
Les renseignements étaient exacts. Croc-Blanc, s’il lui arrivait de sortir, se laissait rosser, à tour de rôle, par tous les chiens de l’attelage. Dans la cabane, il gisait sur le plancher, près du poêle, sans accepter de nourriture. Que Matt lui parlât gentiment ou jurât après lui, c’était tout un. Il se contentait de tourner vers l’homme ses tristes yeux, puis laissait retomber sa tête sur ses pattes de devant et ne bougeait plus.
Alors une nuit vint où Matt, qui lisait à mi-voix, en faisant remuer ses lèvres, tressaillit. Croc-Blanc avait sourdement gémi, puis s’était dressé, les oreilles levées vers la porte, et écoutait intensément. Un moment après, un bruit de pas se fit entendre et, la porte s’étant ouverte, Weedon Scott entra. Les deux hommes se serrèrent la main. Puis Scott regarda autour de lui.
— Où est le loup ? demanda-t-il.
Il découvrit Croc-Blanc, qui s’était à nouveau étendu près du poêle et qui n’avait pas bondi vers lui, comme eût fait un chien ordinaire.
— Sainte fumée ! s’exclama Matt, regardez s’il remue la queue. Ça n’arrête pas.
Weedon Scott appela Croc-Blanc, qui vint aussitôt, sans exubérance. Mais une incommensurable immensité emplissait ses yeux, comme une lumière. Scott s’accroupit sur ses talons, bien en face de lui, et commença à lui caresser savamment la base des oreilles, le cou, les épaules, toute l’épine dorsale. Croc-Blanc reprit son grondement doux ; puis, portant subitement sa tête en avant, il alla l’enfouir entre le bras et les côtes de son maître, cachant son bonheur et se dodelinant. » […]
Cinquième partie : The Tame (= « le domestiqué »)
Chapitre I, Le long voyage
« Quand le jour fatal fut proche, Croc-Blanc, par la porte ouverte, vit le dieu d’amour déposer sa valise sur le plancher et y emballer divers objets. Il y eut aussi des allées et venues. L’atmosphère paisible de la cabane fut perturbée. Le doute n’était plus possible pour Croc-Blanc ; son dieu s’apprêtait à fuir, une seconde fois, et, comme la première, il l’abandonnerait derrière lui.
Alors, la nuit qui suivit, il fit retentir le long hurlement des loups. Ainsi avait-il hurlé, dans son enfance, quand, après avoir fui dans le Wild, il était revenu au campement indien et l’avait trouvé disparu, quelques tas de détritus marquant seuls la place où s’élevait, la veille, la tente de Castor-Gris. Aujourd’hui comme jadis, il pointait son museau vers les froides étoiles et leur disait son malheur.
Les deux hommes, dans la cabane, venaient de se mettre au lit.
— Il recommence à ne plus vouloir de nourriture, dit Matt derrière sa cloison.
Scott s’agita dans son lit et grogna. Matt continua :
— Si j’en juge par sa conduite passée, je ne serais pas étonné que maintenant il ne meure pour de bon.
— Ferme ! cria Scott dans l’obscurité. Vous bavardez, pire qu’une femme !
Le lendemain, Croc-Blanc ne prétendit pas quitter les talons de son maître et continua à observer les bagages étendus sur le plancher. Deux gros sacs de toile et une boîte étaient venus rejoindre la valise. Dans une toile cirée, Matt roulait les couvertures de Scott et ses vêtements de fourrure. Puis deux Indiens arrivèrent, qui mirent les bagages sur leurs épaules et les emportèrent, sous la conduite de Matt, chargé lui-même de la valise et des couvertures.
Lorsque Matt fut revenu, le maître vint à la porte de la cabane et, appelant Croc-Blanc, le fit entrer.
— Vous, pauvre diable, dit-il, en frottant doucement les oreilles de l’animal, sachez que je vais partir pour un long voyage, où vous ne pourrez me suivre. Donnez-moi encore un grondement ami, un grondement d’adieu. Ce sera le dernier.
Mais Croc-Blanc refusa de gronder. Après un regard pensif vers les yeux du dieu, il cacha sa tête entre le bras et les côtes de Scott.
— Hé ! Il siffle ! cria Matt.
Du Yukon s’élevait le meuglement d’un steamboat.
— Coupez court à vos adieux, Mister Scott ! Sortez par la porte de devant et fermez-la vivement. J’en ferai autant avec celle de derrière.
Les deux portes claquèrent en même temps, avec un bruit sec, scandé bientôt par un gémissement lugubre et un sanglot, suivis de longs reniflements.
— Matt, vous prendrez bien soin de lui, dit Scott, comme ils descendaient la pente de la colline. Vous m’écrirez et me ferez savoir comment il se conduit.
— Je n’y manquerai pas. Mais écoutez ceci…
Les deux hommes s’arrêtèrent. Croc-Blanc hurlait comme font les chiens quand leurs maîtres sont morts. Il vociférait sa désespérance. Sa clameur montait en notes aiguës et précipitées ; puis elle retombait, en un trémolo misérable, comme prête à s’éteindre, pour éclater à nouveau en explosions successives.
L’Aurora était le premier bateau de l’année qui quittait le Klondike. Ses ponts étaient bondés de chercheurs d’or qui s’en retournaient, les uns après fortune faite, les autres en pitoyable détresse, tous aussi ardents à repartir qu’ils avaient été enragés à venir.
Près de l’échelle du bord, Scott serrait la main de Matt, qui se préparait à redescendre à terre. Mais Matt, sans répondre à cette étreinte, restait les yeux fixés sur quelque chose qu’il voyait à deux pas de lui, derrière le dos de Scott. Scott se retourna. Assis sur le pont, Croc-Blanc attendait. »
Chapitre II, La terre du Sud
« Une voiture attendait. Un homme et une femme s’approchèrent. Puis les bras de la femme se levèrent et entourèrent vivement le cou du maître. C’était là un acte hostile, Croc-Blanc se mit à gronder avec rage.
— All right ! mère, dit Scott, s’écartant aussitôt et empoignant l’animal. Il a cru que vous me vouliez du mal et c’est une chose qu’il ne peut supporter.
— Je ne pourrai donc vous embrasser, mon fils, qu’en l’absence de votre chien ! dit-elle en riant, quoiqu’elle fût encore pâle et défaite de la frayeur qu’elle avait éprouvée.
— Nous lui apprendrons bientôt à se mieux comporter.
Et comme Croc-Blanc, l’œil fixe, continuait à gronder :
— Couché, Sir ! Couché !
L’animal obéit, à contrecœur.
— Maintenant, mère !
Scott ouvrit ses bras, sans quitter du regard Croc-Blanc, toujours hérissé et qui fit mine de se redresser.
— À bas ! À bas ! répéta Scott.
Croc-Blanc se laissa retomber. Il surveilla des yeux, avec anxiété, la répétition de l’acte hostile. Aucun mal n’en résulta, pas plus que de l’embrassade, qui se produisit ensuite, du dieu inconnu. » […]
« D’admirer tout ce beau paysage Croc-Blanc n’eut point le loisir, car la voiture avait à peine pénétré dans le domaine qu’un gros chien de berger, au museau pointu et aux yeux brillants, l’assaillait, fort irrité et à bon droit, contre l’intrus.
Le chien, se jetant entre lui et le maître, se mit en devoir de le chasser. Croc-Blanc, hérissant son poil, s’élançait déjà pour sa mortelle et silencieuse riposte, lorsqu’il s’arrêta brusquement, les pattes raides, troublé et se refusant au contact. Le chien était une femelle, et la loi de sa race interdisait à Croc-Blanc de l’attaquer. L’instinct du loup reparaissait et son devoir était de lui obéir. Mais il n’en était pas de même de la part du chien de berger. Son instinct, à lui, était la haine ardente du Wild. Croc-Blanc était un loup, le maraudeur héréditaire qui faisait sa proie des troupeaux et qu’il convenait, depuis des générations, de combattre. »
Chapitre III, Le domaine du dieu
« Plus avant dans la journée, il eut la chance de rencontrer un autre poulet, qui se promenait près de l’écurie. Un des grooms courut au secours de la volaille. Ignorant du danger qu’il courait, il prit pour toute arme un léger fouet de voiture. Au premier coup, Croc-Blanc, qu’un gourdin aurait peut-être fait reculer, laissa le poulet pour l’homme. Tandis que le fouet le cinglait à nouveau, il sauta silencieusement à la gorge du groom, qui tomba à la renverse en criant : « Mon Dieu ! », puis lâcha son fouet pour se couvrir la gorge avec ses bras. Les avant-bras saignants et lacérés jusqu’à l’os, il se releva et tenta de gagner l’écurie. L’opération eût été malaisée si Collie n’eût fait, à ce moment, son entrée en scène. Elle s’élança, furibonde, sur Croc-Blanc. C’était bien elle qui avait raison ; les faits le prouvaient et justifiaient ses préventions, en dépit de l’erreur des dieux, qui ne savaient pas. Le brigand du Wild continuait ses anciens méfaits. »
« Lorsque, le matin, Scott sortit, cinquante poules blanches de Leghorn, dont les cadavres étaient restés à dévorer, accueillirent son regard, soigneusement alignées par le groom, sur le perron de la maison.
Le maître siffla, surpris et plein d’admiration pour ce chef-d’œuvre, et Croc-Blanc accourut, qui le regardait dans les yeux, sans honte aucune. Loin d’avoir conscience de son crime, il marchait avec orgueil, comme s’il avait accompli une action méritoire et digne d’éloges. Scott se pinça les lèvres, navré de sévir, et parla durement. Il n’y avait que colère dans sa voix. Puis, s’étant emparé de Croc-Blanc, il lui tint le nez sur les poulets assassinés et, en même temps, le gifla lourdement.
Lorsque Croc-Blanc était, autrefois, giflé par Castor-Gris ou par Beauty-Smith, il en éprouvait une souffrance physique. Maintenant, s’il arrivait qu’il le fût par le dieu d’amour, le coup, quoique plus léger, entrait plus profondément en lui. La moindre tape lui semblait plus dure à supporter que, jadis, la pire bastonnade. Car elle signifiait que le maître était mécontent. Jamais plus il ne courut après un poulet.
Bien plus, Scott l’ayant conduit, dans le poulailler même, au milieu des poulets survivants, Croc-Blanc, en voyant sous son nez la vivante nourriture, fut sur le point, tout d’abord, de céder à son instinct. Le maître refréna de la voix cette impulsion et, dès lors, Croc-Blanc respecta le domaine des poulets ; il ignora leur existence. Et comme le juge Scott semblait douter que cette conversion fût définitive, Croc-Blanc fut enfermé, tout un après-midi, dans le poulailler. Il ne se passa rien. Croc-Blanc se coucha et finit par s’endormir. S’étant réveillé, il alla boire, dans l’auge, un peu d’eau. Puis, ennuyé de se voir captif, il prit son élan, bondit sur le toit du poulailler et sauta dehors. Calmement, il vint se présenter à la famille, qui l’observait du perron de la maison, et le juge Scott, le regardant en face, prononça seize fois, avec solennité :
— Croc-Blanc, vous valez mieux que je ne pensais. » […]
« Trottant derrière la voiture, il suivait son maître à San José, qui était la ville la plus proche. Là se trouvaient des boutiques de boucher, où la viande pendait sans défense. À cette viande il était interdit de toucher. Beaucoup de gens s’arrêtaient en le voyant, l’examinaient avec curiosité et, ce qui était le pire, le caressaient. Tous ces périlleux contacts de mains inconnues, il devait les subir. Après quoi les gens s’en allaient, comme satisfaits de leur propre audace. Parfois, certains petits garçons, sur les routes avoisinant Sierra Vista, se faisaient un jeu, quand il passait, de lui lancer des pierres. Il savait qu’il ne lui était pas permis de les poursuivre ; mais l’idée de justice qui était en lui souffrait de cette contrainte. Un jour, le maître sauta hors de la voiture, son fouet en main, et administra une correction aux petits garçons, qui désormais n’assaillirent plus Croc-Blanc avec leurs cailloux. Croc-Blanc en fut fort satisfait. » […]
Chapitre IV, L’appel de l’espèce
Encore une fois, la version Wikisource est bien plus brève que la version Sabathe ; de longs passages de la version originale sont absents de Wikisource.
« Les mois passèrent. La nourriture, à Sierra Vista, était abondante, et le travail était nul. Croc-Blanc, gras et prospère, vivait heureux. Non seulement il se trouvait matériellement sur la Terre du Sud, mais l’existence s’épanouissait pour lui comme un été. Aucun entourage hostile ne l’enveloppait plus. Le danger, le mal et la mort ne rôdaient plus dans l’ombre ; la menace de l’Inconnu et sa terreur s’étaient évanouies. Seule, Collie n’avait pas pardonné le meurtre des poulets et décevait toutes les tentatives de Scott pour la réconcilier avec Croc-Blanc. »
Je reprends ici un paragraphe de la VO absent de la VF Wikisource, mais que j’ai repéré dans la version Sabathe : « « White Fang n’avait jamais été très démonstratif. À part se blottir contre lui et pousser un gémissement dans son grognement d’amour, il n’avait aucun moyen d’exprimer son amour. Pourtant, il lui fut donné de découvrir un troisième moyen. Il avait toujours été sensible au rire des dieux. Le rire le rendait fou, le rendait frénétique de rage. Mais il n’était pas capable d’être en colère contre le maître qu’il aimait. Et lorsque ce dieu choisissait de se moquer de lui de manière bon enfant et taquine, il était déconcerté. Il pouvait sentir la vieille colère le piquer et le brûler, cherchant à remonter en lui, mais elle se heurtait à l’amour. Il ne pouvait pas être en colère, mais il devait faire quelque chose. Au début, il resta digne, et le maître rit encore plus fort. Puis il essaya d’être encore plus digne, et le maître rit encore plus fort qu’avant. Finalement, le maître le fit rire au point de lui faire perdre sa dignité. Ses mâchoires s’entrouvrirent légèrement, ses lèvres se relevèrent un peu, et une expression interrogative, plus empreinte d’amour que d’humour, apparut dans ses yeux. Il avait appris à rire » (traduction par Deepl). […]
« Croc-Blanc se retourna vers la femme du maître et saisit avec ses dents le bas de sa robe, tirant sur la fragile étoffe jusqu’à ce qu’il l’eût déchirée. Alice poussa un cri de frayeur.
— J’espère qu’il n’est pas devenu enragé, dit la mère de Scott. J’ai toujours répété à mon fils que notre chaud climat ne valait rien pour un animal venu de l’Arctique.
Croc-Blanc maintenant s’était tu et ne grondait plus. Il demeurait immobile, la tête levée, et regardant en face la famille qui le fixait. Des spasmes muets lui secouaient la gorge, et tout son corps se convulsait, comme s’il eût tenté d’exprimer l’inexprimable.
— On croirait, dit Beth, qu’il essaie de parler !
À ce moment, la parole vint à Croc-Blanc, sous la forme d’un aboiement éclatant. Ce fut le second et le dernier de sa vie. Mais il s’était fait comprendre. » […]
« Elle l’entraîna, un jour, dans une longue course, à travers prés et bois. Le maître, guéri, devait cette après-midi, monter à cheval. Croc-Blanc ne l’ignorait pas. Le cheval attendait, tout sellé, à la porte de la maison, Croc-Blanc hésita tout d’abord. Mais un sentiment plus profond que la loi des dieux qu’il avait apprise, plus impérieux que sa propre volonté, le dominait. Et, lorsqu’il vit Collie qui le mordillait et folâtrait devant lui, la balance pencha vers elle. Il tourna le dos et la suivit. Le maître se promena seul, ce jour-là, cependant que, dans les bois, Croc-Blanc courait côte à côte avec Collie, comme sa mère Kiche et le vieil Un-Œil avaient jadis couru de compagnie, dans les forêts silencieuses de la Terre du Nord. »
Chapitre V, Le sommeil du loup
« Un chirurgien fut, sur-le-champ, mandé par téléphone. L’aube blanchissait les fenêtres lorsque l’homme de l’art arriva.
— Sincèrement, il a une chance sur mille d’en revenir, prononça-t-il après une heure et demie d’examen. Une patte cassée ; trois côtes brisées, dont une au moins a perforé le poumon ; sans parler de tout son sang qu’il a perdu et de probables lésions internes. Sans doute a-t-il été projeté en l’air. Je passe sur les trois balles qui l’ont traversé de part en part. Une chance sur mille est trop d’optimisme. Il n’en a pas une sur dix mille.
— De cette unique chance rien ne doit être négligé, répliqua le juge Scott. Faites fonctionner, s’il le faut, les rayons X. Tentez n’importe quoi et ne regardez pas à la dépense. Weedon, télégraphiez à San Francisco et mandez le docteur Nichols. Ce n’est pas pour vous offenser, chirurgien… Mais, vous comprenez, tout doit être fait pour lui.
Le chirurgien sourit avec indulgence.
— Je comprends, dit-il. Vous devez le soigner comme un être humain, un enfant malade. Je reviendrai à dix heures. Observez sa température.
Croc-Blanc fut donc admirablement soigné. Quelqu’un ayant proposé d’engager une infirmière professionnelle, les filles de Scott repoussèrent avec indignation cette idée. Si bien que Croc-Blanc gagna la chance sur dix mille, à peine accordée par le chirurgien. Mais celui-ci n’avait jamais soigné que des êtres civilisés, descendant de civilisés, et toute autre était la vitalité de Croc-Blanc, qui venait directement du Wild. Son erreur de jugement ne fut donc pas blâmée. » […]
« Croc-Blanc fut remis sur ses pattes, dont les muscles, peu à peu, commencèrent à jouer, et c’était à qui le soutiendrait. Tremblant et se balançant, escorté comme un roi, il parvint à gagner la pelouse. Après qu’il s’y fut reposé, le cortège poursuivit sa route et le conduisit jusqu’à l’écurie.
Là, sur le seuil, était étendue Collie, entourée d’une demi-douzaine de petits chiens qui s’ébattaient au soleil. Croc-Blanc les contempla, avec des yeux étonnés. Collie gronda vers lui et il se tint à distance.
Tandis qu’une des femmes maintenait Collie dans ses bras, le maître, avec son pied, aida l’un des petits chiens à venir vers Croc-Blanc. Il se hérissa soupçonneusement ; mais le maître lui assura que tout allait bien, quoique Collie, par ses grondements, protestât du contraire. Le petit chien se mit à gambader autour de lui. Il coucha ses oreilles et l’observa avec curiosité. Puis leurs nez se touchèrent et il sentit la chaude petite langue sur son museau. Il tira la sienne et, sans savoir exactement pourquoi, il lécha la figure du petit.
Les dieux, à ce spectacle, s’étaient mis à applaudir et poussaient des cris de plaisir. Croc-Blanc en fut tout décontenancé. Ensuite, sa faiblesse l’ayant repris, il se coucha, et les autres petits chiens vinrent à leur tour, au grand mécontentement de Collie, l’entourer en folâtrant.
Par un reste de son ancienne sauvagerie solitaire, son premier mouvement fut de repousser les importuns. Puis, parmi les applaudissements des dieux, il se décida, d’un air grave, à leur permettre de grimper et de jouer sur son dos et sur ses flancs. Et, tandis que les petits chiens continuaient leurs bouffons ébats et leurs luttes joyeuses, patiemment, les yeux mi-clos, il s’endormit au soleil. »
FIN
L’illustration de vignette, ainsi que deux autres, sont de Charles Livingston Bull (1874-1932), illustrateur de l’édition originale, si j’ai bien compris, et grand illustrateur animalier.
– Parmi les adaptations trouvables sur Internet, voici Le Retour de Croc-Blanc (1974) de Lucio Fulci, avec de belles courses poursuites de traîneau à chiens.
– On trouve aussi, avec une définition très grumeleuse, Croc-Blanc (White Fang), un film américain réalisé par Randal Kleiser, sorti en 1991, qui semble plus proche du récit de London.
– TF1 avait proposé en 1992 un dessin animé en 26 épisodes La Légende de Croc-Blanc pour les nenfants, très éloigné du récit original.


 3 week_ago
76
3 week_ago
76














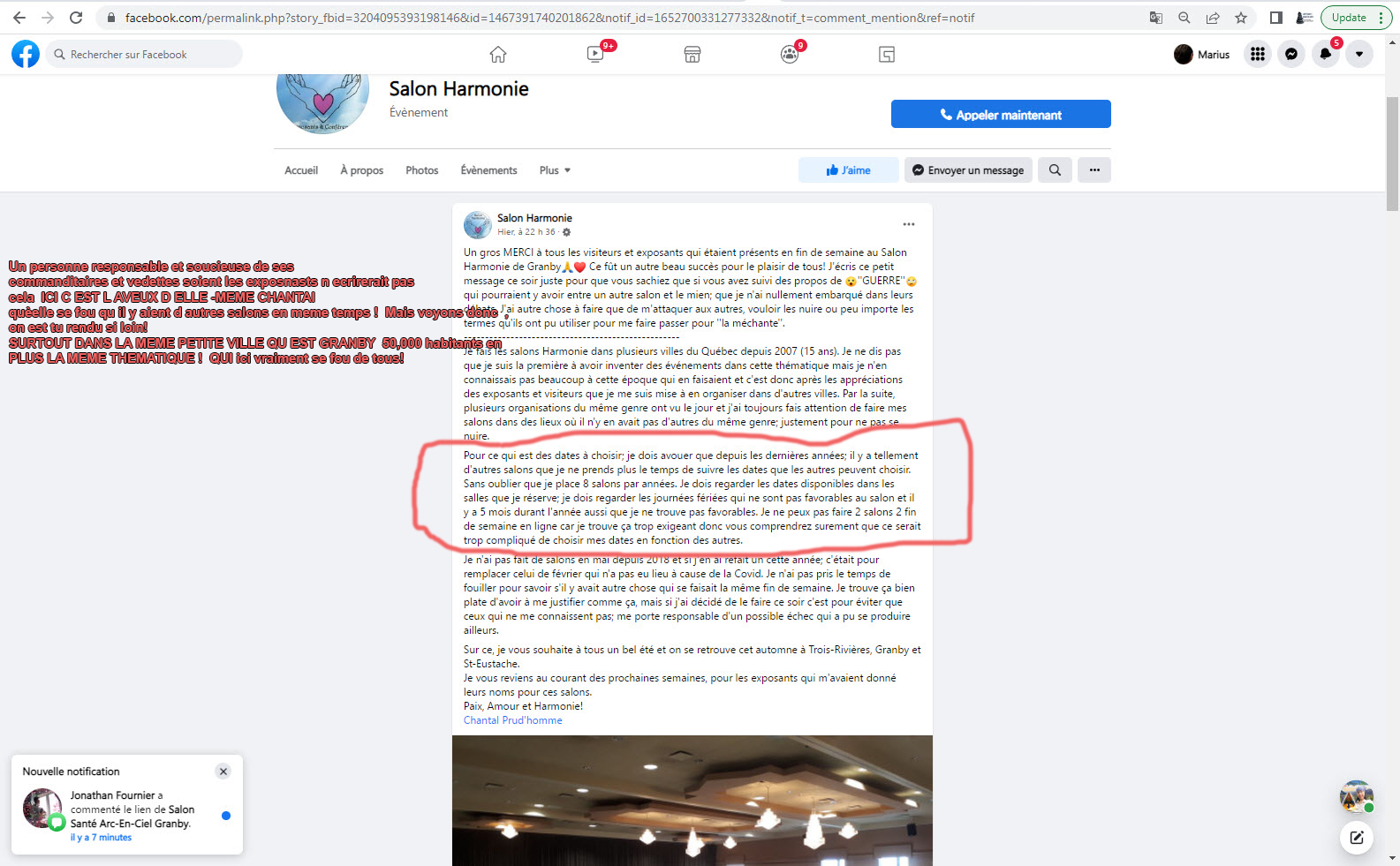

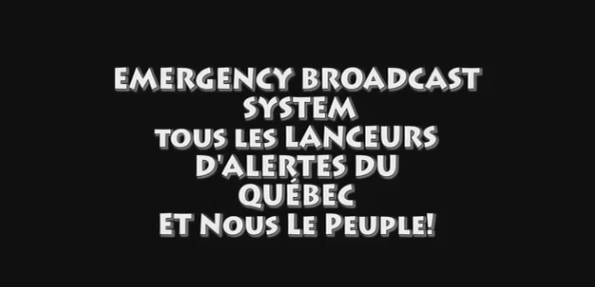
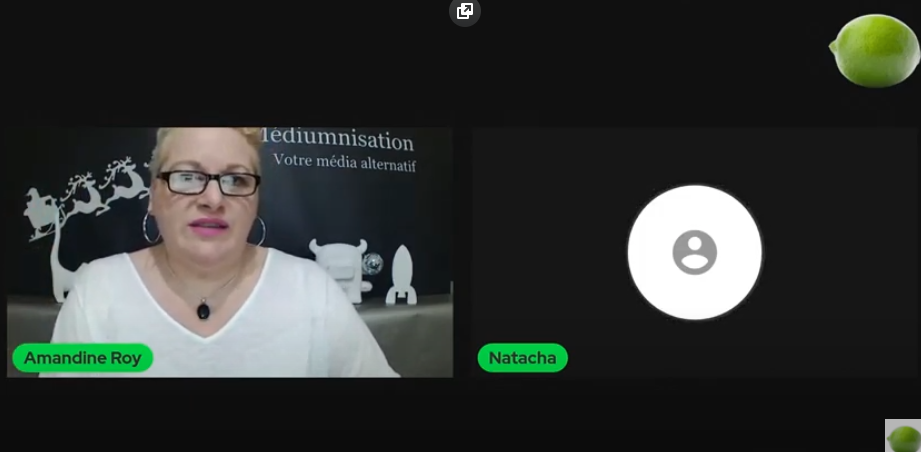






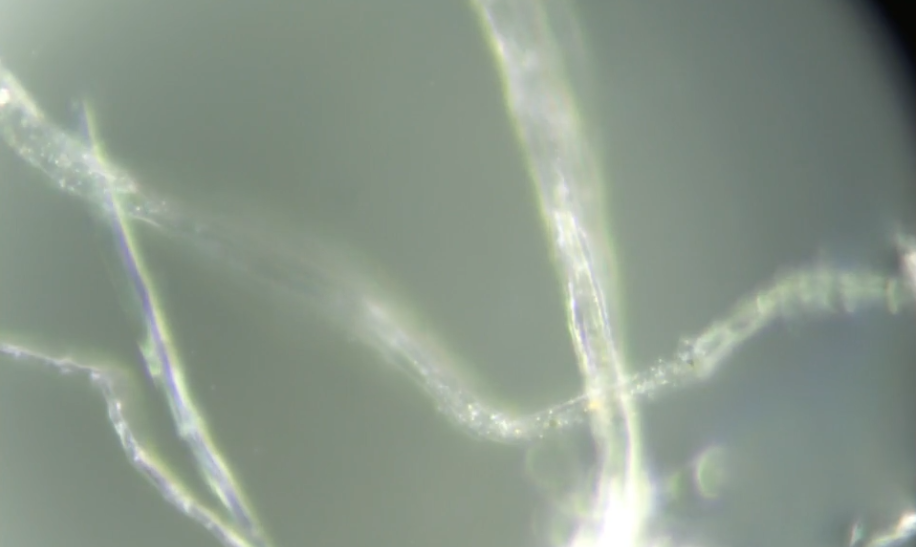

 French (CA)
French (CA)