NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
Entre 1972 et 1993, les terres agricoles de Martinique et de Guadeloupe sont massivement contaminées par le chlordécone. Ce pesticide, conçu aux États-Unis dans les années 1950, y est interdit dès 1976. Trois ans plus tard, l’Organisation mondiale de la santé le classe comme cancérogène, perturbateur endocrinien et toxique pour l’environnement. Malgré cela, la France […]
Entre 1972 et 1993, les terres agricoles de Martinique et de Guadeloupe sont massivement contaminées par le chlordécone. Ce pesticide, conçu aux États-Unis dans les années 1950, y est interdit dès 1976. Trois ans plus tard, l’Organisation mondiale de la santé le classe comme cancérogène, perturbateur endocrinien et toxique pour l’environnement.
Malgré cela, la France en autorise l’usage dans les Antilles jusqu’en 1993, officiellement pour lutter contre le charançon du bananier. En réalité, il s’agissait de préserver un ordre économique capitaliste, fondé sur la monoculture d’exportation, l’exploitation des terres et l’accumulation des profits par une minorité blanche : les békés, descendants des colons esclavagistes, qui concentrent encore aujourd’hui l’essentiel du pouvoir économique dans ces territoires.
Ce maintien, en pleine connaissance de cause, n’est pas une erreur ou une négligence. C’est un empoisonnement organisé, prolongé, délibéré. Les terres contaminées ne sont pas abstraites : elles abritent des communautés entières. Sacrifier un territoire, c’est toujours sacrifier une population. Protéger un territoire, c’est reconnaître la dignité de celles et ceux qui y vivent. Cette hiérarchie dans la protection dit tout de la hiérarchie imposée entre les vies.
Ce scandale ne relève pas d’une simple inégalité : il manifeste une logique d’effacement. Les Antillais ne sont pas marginalisés : ils sont rendus invisibles, déshumanisés, effacés des dispositifs de protection, de réparation, de reconnaissance. Notre article.
Pour aller plus loin : Pesticides : un danger majeur pour la biodiversité et notre santé
Racisme environnemental : désigner la structure de l’abandon
Pour comprendre la portée du scandale, il faut le lire à travers le prisme du racisme environnemental. Ce concept, né aux États-Unis dans les années 1980, désigne « l’ensemble des politiques, pratiques et décisions environnementales qui entraînent des conséquences négatives disproportionnées sur certains groupes, selon leur race ou leur origine sociale ».
Comme l’écrit le philosophe martiniquais Malcolm Ferdinand, auteur d’Une écologie décoloniale, «C’est une minorité qui a choisi le chlordécone, et qui a imposé à l’ensemble d’un peuple de vivre en milieu contaminé. » Il ne s’agit ni d’ignorance, ni de mauvaise gestion, mais d’une gouvernance coloniale des nuisances, où le droit à un environnement sain est réparti selon des critères raciaux. À géographie inégale, justice inégale.
Le chlordécone incarne aussi un déni de toute démocratie environnementale : moins d’une dizaine de décideurs, dans les sphères étatiques, industrielles et administratives, ont imposé une contamination à des territoires entiers. Sans information, sans consentement, sans recours. Un scandale que LFI dénonçait dès 2018, réclamant une commission d’enquête parlementaire.
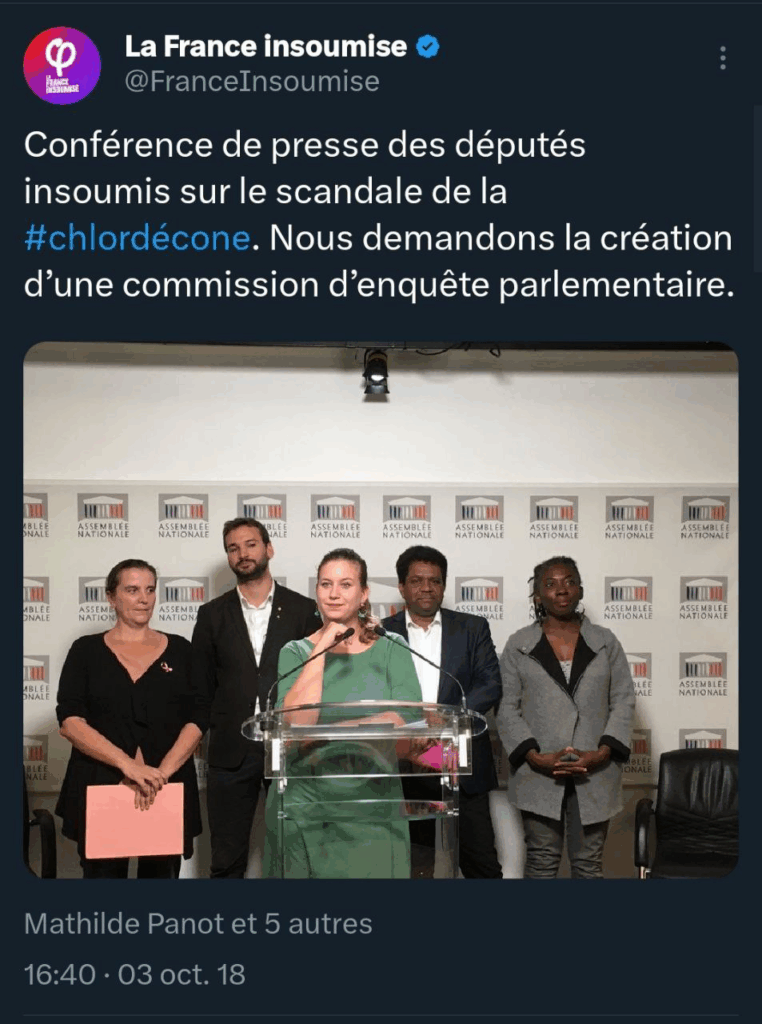
Une reconnaissance à géométrie coloniale
Le 31 mars 2025, le Comité européen des droits sociaux rend sa décision sur la réclamation collective déposée par la FIDH, la LDH et le collectif Kimbé Rèd FWI. Il y est écrit :
« La Charte sociale européenne ne peut être considérée comme étant de facto applicable à la Guadeloupe et à la Martinique. Il en résulte une situation dans laquelle les citoyens de ces territoires bénéficient d’un niveau de protection des droits sociaux nettement inférieur, en termes de droit européen des droits humains, par rapport à leurs concitoyens métropolitains. »
Ce constat reconnaît une discrimination structurelle, tout en refusant d’en tirer les conséquences juridiques. Il acte que les Antilles ne bénéficient pas des mêmes garanties que l’Hexagone, notamment face aux risques présentés par le chlordécone. C’est là une reconnaissance implicite de la colonialité : la perpétuation des logiques coloniales dans les dispositifs contemporains de pouvoir, de droit et de gestion des vies.
En janvier 2023, la justice française prononce un non-lieu dans l’affaire du chlordécone. Ce refus de juger les responsables prolonge la mécanique du mépris. Il confirme que les Antilles ne sont pas des territoires oubliés : ce sont des territoires activement exclus de la protection. Déjà à ce moment-là, La France Insoumise pointait « l’empoisonnement des Antilles », et en 2024, le député Insoumis Jean-Philippe Nilor dénonçait ce scandale.
Depuis les marges : pour une écologie décoloniale
Dans les territoires colonisés, l’environnement n’a jamais été conçu comme un bien commun à préserver, mais comme un stock à piller. Ce rapport instrumental, racialisé à la nature, est le socle de l’écocide colonial.
Le scandale du chlordécone révèle les logiques néocoloniales qui structurent la société antillaise : une économie d’exportation, une gouvernance sans consultation, une hiérarchisation raciale des vies. Ce n’est pas un dysfonctionnement. C’est le fonctionnement normal d’une République postcoloniale.
Face à cela, les commissions, les indemnisations partielles et les excuses symboliques ne suffisent pas. Il faut, comme le propose Malcolm Ferdinand, engager une écologie décoloniale : une écologie ancrée dans les luttes, dans les corps contaminés, dans les savoirs populaires et les territoires dominés. Une écologie qui reconnaît que la catastrophe n’est pas une anomalie : elle est la norme du monde colonial.
Cette logique ne s’arrête pas aux Antilles. Elle traverse d’autres territoires marqués par l’abandon, la contamination, la dépossession. Partout où les territoires sont jugés négligeables, les vies qui y sont attachées le sont aussi. Les visages changent, les frontières varient, mais le système reste : celui d’un monde où certaines vies sont considérées comme sacrifiables.
Conclure depuis la lutte contre le chlordécone
Le scandale du chlordécone est plus que sanitaire. C’est la matérialisation d’un racisme d’État, d’un empoisonnement organisé, assumé, où des territoires entiers ont été sacrifiés — et avec eux, des vies humaines. Ce n’est pas un oubli, c’est un choix. Ce n’est pas un accident, c’est un système.
Il ne suffit pas d’y opposer des excuses symboliques ou des dispositifs de façade. Il faut reconnaître l’architecture politique qui a rendu possible cette catastrophe, et s’attaquer à ce qui la perpétue : la colonialité du droit, la hiérarchie des vies, le capitalisme racial.
Car sacrifier un territoire, c’est toujours sacrifier une population. Protéger un territoire, c’est reconnaître la dignité de celles et ceux qui y vivent. Là où l’environnement est détruit, c’est toujours une humanité qu’on désigne comme négligeable.
Ils ne sont pas marginalisés : ils sont rendus invisibles, déshumanisés, effacés.
Et ce qui s’est joué aux Antilles se rejoue ailleurs, sous d’autres formes, dans d’autres langues. Du fleuve Oyapock à Mayotte, des littoraux kanaks aux terres palestiniennes, une même logique d’occupation, de contamination, de dépossession traverse les géographies de l’oppression. Les visages changent, les frontières varient, mais la structure reste : celle d’un monde où certaines vies sont considérées comme sacrifiables.
Ce qu’il nous faut, ce n’est pas une gestion de crise. C’est une justice. Une justice écologique, décoloniale, antiraciste, réparatrice. Une écologie depuis les marges, depuis les luttes, depuis les peuples. Pas de justice écologique sans justice antiraciste. Pas d’écologie réelle sans décolonisation.
Par Fanny Da Costa


.png) 3 day_ago
12
3 day_ago
12

























 French (CA)
French (CA)